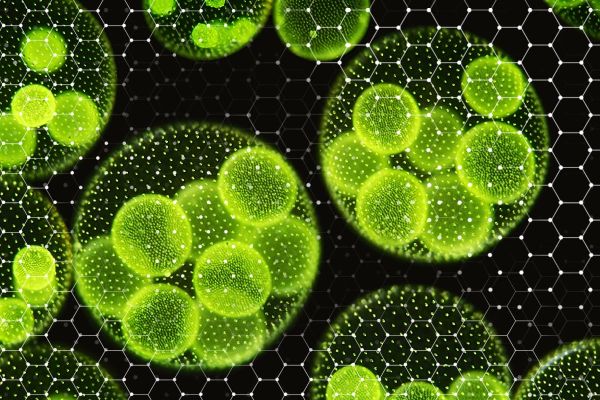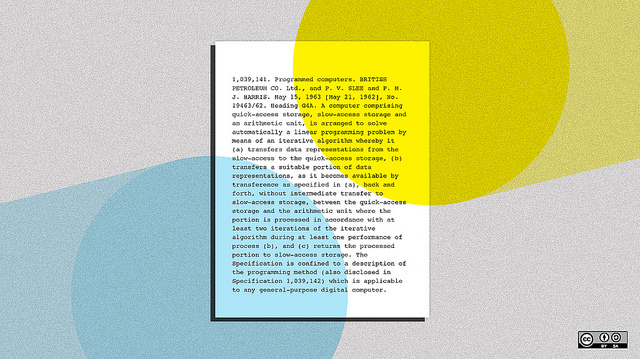Les accords de partage des avantages écorchés par la vérité du terrain
Par Robert Ali Brac de la Perrière - Auteur de « Semences paysannes, plantes de demain », éditions ECLM, 2014.
Publié le 02/07/2024
Depuis 1992, l’accès à la biodiversité est encadré par la Convention sur la diversité biologique signée à Rio (Brésil). Elle consacre la souveraineté des États sur leurs ressources. Afin de lutter contre toute biopiraterie, un régime de demande d’accès à cette biodiversité et surtout de partage des avantages a été instauré. Quel est l’efficacité de ce système ? Les avantages sont-ils partagés ? Ou s’agissait-il dès le départ d’un marché de dupes ?

Depuis quelques temps, les actualités sur la numérisation du vivanti, la propriété industrielle et les techniques de modification génétique s’entrecroisent vers une artificialisation croissante du vivant et l’appropriation qui l’accompagne. Parmi les craintes évoquées, celle que des opérateurs économiques s’approprient des ressources qui sont sous la gestion par des tiers, souvent des populations qui les ont identifiées ou sélectionnées. De telles populations n’ont pas forcément un régime de propriété sur ces produits. Parmi les « solutions » pour répondre aux craintes de biopiraterie par les multinationales, le système de partage des avantages est souvent mis en avant. Inf’OGM publie ici une contextualisation historique (forcément non exhaustive) de ce partage des avantages par Robert Ali Brac de la Perrière. Un rappel qui permet de comprendre pourquoi cette solution fut, dès sa mise en œuvre, vouée à un échec certain.
Un marché de dupes pour les communautés paysannes ?
En 1992, la transgenèse était encore tâtonnante dans les labos et le brevet sur le vivant n’avait pas encore franchi l’Atlantique. Les effets de la déréglementation du secteur bancaire étaient à peine perceptibles. Mais deux ans plus tard, en 1994, les accords de Marrakech ouvrent la voie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La globalisation du néo-libéralisme amplifiera le pouvoir prédateur de multinationales géantes et l’affaiblissement de la puissance publique avec pour conséquences l’accaparement des terres, des ressources, et le réchauffement climatique de la planète. Dans ce contexte, le partage des avantages est-il un marché de dupes ?
C’est le questionnement légitime des communautés paysannes qui protègent, entretiennent et renouvèlent la diversité du vivant dans leurs champs et sur leurs territoires. La Convention sur la diversité biologique (CDB) a été bâtie sur un dogme trinitaire :
1) la conservation de la biodiversité,
2) son utilisation durable,
3) le partage des bénéfices liés à l’utilisation des « ressources génétiques »iii.
Comment l’asymétrie dans le rapport de force qui était déjà prégnante à la fin du siècle dernier entre les États du Sud, riches en biodiversité, et ceux du Nord, pourvus en techno-sciences, allait impacter leurs droits lors des tractations d’accès et partage des avantages (APA) ? Comment le régime que le Protocole de Nagoya de 2010 a instauré pour réglementer la bio-prospection et le commerce des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles tient-il compte de leurs intérêts ?
Ces questions sont d’autant plus d’actualité qu’aujourd’hui la numérisation des ressources génétiques et l’appropriation par brevet des éléments composant la biodiversité s’accélèrent. Au fur et à mesure de l’effondrement de la biodiversité globale, presque toute capacité de contrôle par les États est empêchée. De plus, alors que le marché du vivant se conclue sous la houlette de l’État, les luttes politiques et économiques plus larges auxquelles sont confrontées les communautés paysannes sont facilement occultées dans les négociations. Enfin, plus fondamentalement, l’approche marchande du vivant par les droits de propriété industrielle est difficilement compatible avec les lois traditionnelles, les pratiques coutumières et les normes sociales. Il est dès lors intéressant de suivre les batailles des légalistes, ceux qui jouent le jeu avec opiniâtreté. Les expériences les plus emblématiques sont certainement portées par l’Afrique du Sud.
Quels objectifs ? Quels principes ?
Comme le résume la meilleure spécialiste sud-africaine en biopolitique, R. Wynberg, en 2023, « l’accès et le partage des avantages (APA) est une approche centrale pour lutter contre la biopiraterie : l’appropriation illicite de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles sans consentement ni compensation, souvent liée à l’octroi de brevets. Les accords de partage des avantages sont destinés à favoriser une plus grande justice sociale et économique, à créer des incitations à la conservation de la biodiversité et à renforcer les droits des communautés autochtones et locales »iv.
En effet, en 1992, les accords de Rio instaurent la souveraineté des États sur les ressources biologiques. Basiquement, cela implique la fin du libre accès à « un patrimoine commun de l’humanité » et désormais le marchandage sur le vivant sera la règle. Les ressources génétiques sont appropriables et les États sont responsables de cette propriété, dont il peuvent faire retomber les produits financiers aux populations s’ils le veulent. Les entreprises et les chercheurs souhaitant prospecter un organisme, qu’il soit un animal, une plante ou un microbe, doivent contracter avec l’autorité du pays qui détient ces ressources. L’accès, de même qu’un accord de transfert de matériel, se négocient contre le partage « juste et équitable » des bénéfices tirés de l’utilisation des ressources collectées. Si les grands principes déclinés par le Protocole de Nagoya depuis 2010 peuvent être résumés de manière aussi simple, leur mise en œuvre concrète est jalonnée d’obstacles, comme on va le voir au travers d’exemples.
En Afrique du Sud, des exemples d’APA non respectés sauf bagarre juridique
En 1992, l’Afrique du Sud est en plein basculement. Nelson Mandela a été libéré en 1990. Il deviendra le premier Président de la république non ségrégationniste, en 1994 : un renversement tectonique du pouvoir détenu depuis deux siècles par l’hégémonie blanche à la tête de l’économie la plus puissante d’Afrique répondant aux canons du développement industriel des pays occidentaux. La révolution arc-en-ciel se décline dans les accords APA d’une manière originale. Sitôt le régime raciste mis à bas, deux ans après la signature des accords de Rio, les négociations voient émerger un nouvel acteur : les communautés autochtones opprimées pendant l’apartheid. Cette ouverture politique sans précédent aux communautés paysannes soutenues par des ONG et universitaires très au fait des négociations internationales explique pourquoi l’Afrique du Sud possède l’architecture réglementaire APA « la plus développée, la plus complexe et la plus étendue avec des dizaines d’accords de partage des avantages négociés et plus de 130 permis délivrés à ce jour par le gouvernement national ».
La loi sud-africaine inclue à la fois le bio-commerce (c’est-à-dire la collecte, la transformation et la commercialisation de produits dérivés de la biodiversité) et la bio-prospection des échantillons de ressources génétiques. Elle met en place un système de permis pour toutes les activités liées à l’utilisation de la biodiversité indigène – de la récolte des ressources à la recherche, au commerce et à la transformation. Elle exige que des accords de partage des avantages soient négociés comme condition à l’approbation du permis de prospection. Deux plantes emblématiques illustrent l’âpreté des négociations : hoodia (le cactus coupe-faim) et le thé rouge rooibos.
Hoodia : la connaissance paysanne contre l’obésité
Au début des années 1960, le centre de recherche sud-africain CSIR a obtenu un brevet pour les propriétés coupe faim et coupe soif de l’hoodia, plante du désert. Des accords commerciaux ont été conclus avec la société britannique Phytopharm et le géant pharmaceutique Pfizer pour développer un médicament contre l’obésité. Toutefois, ces accords ont été dans un premier temps conclus sans le consentement, la connaissance ou la participation des San autochtones, bien que leurs connaissances soient à la base de la recherche. En réponse à une intervention de l’ONG Biowatch South Africa et à un tollé général, le tout premier accord de partage des bénéfices en Afrique du Sud a été finalisé en 2003 entre le CSIR et le South African San Council, représentant les trois communautés San indigènes d’Afrique du Sud (‡Khomani, !Xun et Khwe) : le CSIR and South African San Council Benefit-sharing Agreement (2004).
Des problèmes de sécurité et d’efficacité ont finalement conduit à l’arrêt du projet Hoodia de Phytopharm et Pfizer, mais il n’en reste pas moins qu’il a créé un précédent important. Certes, le Conseil des San d’Afrique du Sud a reçu des avantages monétaires, mais qui se sont avérés relativement insignifiants (environ 50 000 USD). Cette affaire a montré que le partage des avantages avec les populations autochtones, s’il est possible, n’est pas spontané. Les bénéfices que les organisations San tirent du Hoodia, par exemple, ne représentent qu’une fraction – entre 0,03 % et 1,2 % – des ventes nettes du produit (Wynberg, 2004). Les termes de l’accord – bien qu’aujourd’hui obsolètes – sont également discutables. Les bénéfices réalisés par Phytopharm et ses partenaires restent intacts, tandis qu’il est interdit au Conseil des San d’utiliser ses connaissances traditionnelles sur le Hoodia dans tout autre produit commercialisable. Comme l’indique R. Wynberg dans son analyse, plusieurs cas montrent qu’une telle interdiction est courante : « L’ensemble de ces cas suggère que si les accords ont conduit à certains avantages financiers, c’est une approche « business as usual » qui prévaut, qui ne transfère pas le pouvoir et ne permet pas une approche de la commercialisation basée sur la communauté ou possédée par elle. Le contrôle reste dévolu à deux éléments clés : la terre, dont la propriété reste fortement orientée vers les partenaires industriels et la monopolisation des marchés par la culture ; et la propriété intellectuelle qui […] montre une augmentation du nombre de brevets et d’autres formes de propriété intellectuelle qui restent dissociées du partage des bénéfices avec les détenteurs de connaissances, les gardiens de la biodiversité et les propriétaires de ressources. »
Rooibos : la chaîne de valeur d’un thé rouge sans théine
En 2010, l’utilisation apparemment illégale du rooibos dans la recherche et le développement est devenue le point central des accusations de biopiraterie, initiées par une campagne médiatique menée par deux ONG, Natural Justice et la Déclaration de Berne. Cette campagne faisait suite à cinq demandes de brevets déposées par une filiale du géant de la consommation Nestlé pour l’utilisation du rooibos et du miel sauvage dans le traitement des inflammations et des affections de la peau et des cheveux. Un accord de partage des bénéfices a ensuite été finalisé en 2014 entre Nestlé Afrique du Sud, le Conseil sud-africain des San et le Conseil national des Khoisan. Les deux conseils reçoivent 3 % des ventes nettes d’un produit innovant de machine de distribution de thé, partagés à parts égales entre eux. Ce calendrier est à l’image de la règle générale qu’est la biopiraterie : autorisation non demandée, transfert de matériel sans accord. L’exception a lieu lorsque des ONG, ou parfois un État, soulèvent un cas emblématique.
Passant en revue les accords des deux dernières décennies, Rachel Wyberg conclut « il est possible que les accords et les approches en matière d’APA permettent de renforcer les droits fonciers et les droits aux ressources, et de soutenir les pratiques coutumières qui renforcent la conservation et l’utilisation durable, mais cela s’est rarement, voire jamais, produit ». Par quel miracle cela se produira-t-il alors dans les nombreux pays où les communautés locales n’ont pas la même capacité d’organisation et le même soutien de l’État pour participer à la négociation ?
Tirpaa : l’autre version des APA, tout aussi déficiente
Un autre miroir aux alouettes a été installé au sein du Traité Internationale sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation (Tirpaa). On l’appelle le « Fonds de partage des avantages ». Quoique l’APA ne s’applique pas pour la ressource génétique spécifique des plantes couvertes par le Traité, « une mise en œuvre concertée et solidaire avec le protocole de Nagoya est encouragée »v. Sous l’impulsion de l’industrie semencière, le Traité, entré en vigueur en 2004, a extrait des règles générales de la CDB (et donc du Protocole de Nagoya) 64 espèces les plus utiles à l’agriculture et à l’alimentation : riz, blé, maïs, pomme de terre… Construit autour d’un système multilatéral d’échange, la promesse d’un partage des avantages induit ici aussi une perte de souveraineté des États. Une partie des revenus générés par les bénéfices provenant des variétés qui ont été développées en utilisant du matériel biologique couvert par le Traité est déposée dans un fonds qui permettrait « le soutien des agriculteurs dans la gestion durable de la diversité phytogénétique, et l’accès à un large éventail de semences adaptées à leurs nécessités ». Or, dans la réalité, très peu d’argent a été récolté : seulement 26 millions d’euros investis dans des projets en 15 ans.
La provenance de cet argent est majoritairement des contributions volontaires de certains États et très minoritairement des bénéfices de l’industrievi. Ces contributions ne représentent même pas 2 millions d’euros par an, soit à peine le budget d’un unique projet de recherche européen… Pour maintenir l’illusion des bénéfices qui seraient partagés via ce système multilatéral, certains pays industrialisés ont décidé de verser ce qui s’apparente à une aumône à la place de leur industrie semencière, peut-être pour les en dispenser. Seule la Norvège a créé un instrument de reversement systématique d’une partie des bénéfices des ventes des semences (sans en distinguer les variétés).
Comble du paradoxe, avec ce peu d’argent, les projets financés permettent surtout aux scientifiques et aux obtenteurs d’utiliser le pool génétique mondial du Traité pour entreprendre des recherches en vue du développement de nouvelles variétés. Le Fonds de partage des bénéfices a ainsi soutenu le développement de modèles commerciaux qui améliorent les chaînes de valeur des semences locales de variétés améliorées, notamment la production, la multiplication, l’enregistrement, la distribution et la commercialisation d’une diversité de semences « de qualité ». Plus de 26 000 identificateurs numériques d’objets (DOI) ont été attribués dans le cadre des projets, en permettant ainsi l’accès aux informations sur les semences et autres matériels de culture pour la recherche, la formation et la sélection végétale. De toute évidence « le soutien des agriculteurs dans la gestion durable de la diversité » est resté, jusqu’ici, un vœu pieu.
APA et OMS : les pathogènes des ressources à partager
Un déploiement récent de l’instrument APA s’intéresse à l’accès aux pathogènes. Les négociations en cours du PABS (Pathogen access and benefit sharing) à l’Organisme mondiale de la santé (OMS) soulignent une préoccupation nouvelle : accéder sans entrave aux variants émergents des pathogènes en situation pandémique. L’épisode dramatique du Covid à une échelle planétaire pousse en effet à réviser les principes des APA pour les microbes. On se rappelle que le premier cas du variant Omicron du SARS-COV2 a été détecté sur des malades du Botswana en novembre 2021. Un grand nombre de mutations inédites rendent Omicron plus transmissible que ses prédécesseurs. Quand il sera classé comme préoccupant deux semaines plus tard par l’OMS, l’accès rapide aux séquences génétiques, l’analyse des données, la phylogénétique et la fourniture d’informations pour la prise de décision sont des éléments clés de la réponse pandémique. Dans la chaîne qui assure la gestion globale de la pandémie le nombre de parties prenantes se multiplie. L’opérationnalité d’un partage juste et équitable des bénéfices tirés des données génétiques d’un variant devient compliqué. Aussi, les industries pharmaceutiques sont férocement opposées aux systèmes APA, car cela ralentirait les échanges rapides des pathogènes dans les situations d’urgence (et donc des bénéfices tirés de tests et vaccins adaptés). Elles demandent donc l’accès libre aux pathogènes et leurs données génétiques. Les compensations, négociées par la suite, seraient constituées de mesures médicales essentielles, comme la donation de vaccins pendant la crise. Les discussions pour installer un mécanisme multilatéral, à l’instar du Tirpaa, pour échanger hors APA du matériel biologique de pathogènes ayant un potentiel pandémique et les données génétiques associées se poursuivent. Un consensus devait être sur la table lors de l’Assemblée générale de l’OMS en mai 2024. L’OMS étant sous la haute influence du fondateur du géant Microsoft, Bill Gates, il est fort à craindre que les intérêts des gros poissons ne fassent qu’une bouchée des principes d’équité de l’APAvii.
i Inf’OGM a publié 2 dossiers, en 2023 et 2021, qui abordent ces questions :
– « La biodiversité à l’épreuve de l’agriculture », Inf’OGM, le Journal, n°172, juillet-septembre 2023.
– « Numériser le vivant pour mieux le privatiser », Inf’OGM, le Journal, n°162, janvier-mars 2021.
iiiCette expression est celle utilisée par la convention de Rio de 1992 et utilisée depuis dans les instances internationales. Inf’OGM a déjà souligné pourquoi cette expression qui désigne les organismes vivants est problématique :
Annick Bossu et Christophe Noisette, « « Ressource génétique » : une mauvaise expression », Inf’OGM, le Journal, n°162, janvier-mars 2021.
ivRachel Wynberg, « Biopiracy :Crying wolf or a lever for equity and conservation? », Research Policy 52, 2023.
vProgramme commun de renforcement des capacités (2017). « Mise en œuvre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et du Protocole de Nagoya de manière complémentaire : Études de cas pour examen par les Points focaux nationaux et autres parties prenantes intéressées ». Bioversity International, Rome.
vi Exception faite de la contribution significative de l’initiative norvégienne : 0,1 % des ventes nationales de semences.
viiLawrence Gostin, directeur du centre de l’OMS en droit de la santé, salue « la générosité et l’ingéniosité » d’une organisation philanthropique, comme la Fondation Gates. Cependant, il ajoute que « la plupart des financements accordés à l’OMS par cette fondation sont en lien avec son agenda. Cela signifie que l’OMS n’est plus en position de fixer ses priorités de santé globale en étant pareillement redevable à un acteur privé. Et contrairement à des États membres, contraints de répondre de leurs actes en démocratie, cette fondation n’endosse à ce niveau-là aucune responsabilité ». Swissinfo, mai 2021.