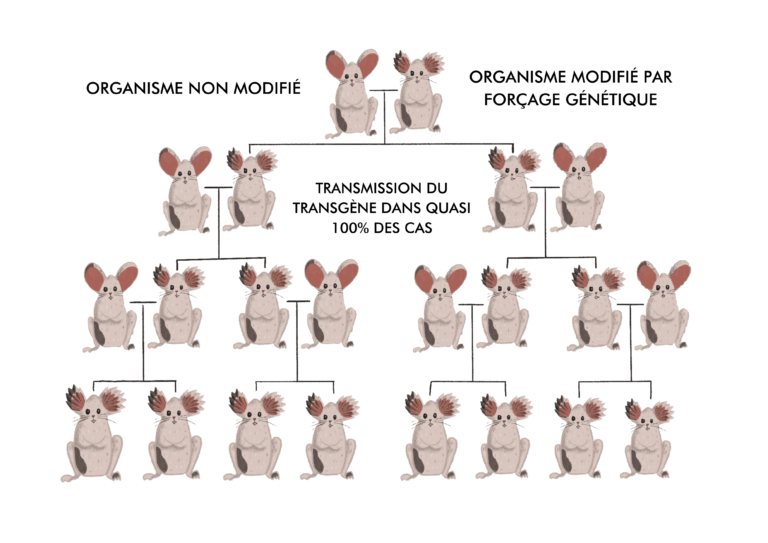Actualités
Algues OGM : une matière première en devenir pour l’industrie
Les algues vivant dans les rivières ou la mer font, depuis quelques années, l’objet d’une véritable attention. Qu’elles soient micro, macro, vertes, brunes, rouges… elles sont actuellement au cœur d’un projet de développement industriel pour lequel la Commission européenne s’est mobilisée. Passant notamment par la case modification génétique pour être transformées en usine de production de produits pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires ou encore agrocarburants, ces algues OGM pourraient être déréglementées si la proposition de la Commission européenne faite en juillet 2023 était approuvée. Cet article est une première plongée dans un monde jusque-là passé inaperçu.

S’ils ne les achètent pas certifiés par un cahier des charges excluant les OGM, les consommateurs de chlorelle, spiruline, agar agar ou autres produits d’algues marines pourraient bien devoir lire plus attentivement les étiquettes pour savoir si leurs produits ne sont pas des OGM ou produits à partir d’OGM. Sauf si cette information n’est plus obligatoire demain. Car, en juillet 2023, la Commission européenne a proposé de déréglementer les OGM, ou du moins une très grande partie d’entre euxi. Depuis, des débats ont eu lieu au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne, dans certains États membres et au sein du monde économique et de la société civile. L’enjeu de ces discussions est de taille puisque, s’il devait être adopté, ce texte ferait échapper aux requis de la législation actuelle nombre de végétaux OGM qui pourraient être commercialisés sans évaluation des risques préalables, sans besoin d’autorisation, sans étiquetage, sans traçabilité assurée par une méthode analytique et/ou documentaire, tout en faisant l’objet de brevets. Si, dans le texte proposé, tout comme dans sa communication, la Commission insiste sur le fait que cette proposition ne concerne que les végétaux, ce dernier terme est plus large que ce que chacun pense mettre dedans, en incluant également les algues.
Les algues, objet d’attention pour la Commission européenne
Comme il est écrit dans le considérant 9 de la proposition de la Commission, « le présent règlement devrait être limité aux OGM qui sont des végétaux, c’est-à-dire des organismes appartenant aux groupes taxonomiques Archaeplastida ou Phaeophyceae ». Ces deux termes latins couvrent les plantes terrestres, mais également les algues dites vertes, rouges (Archaeplastida) et brunes (Phaeophyceae).
Cette inclusion spécifique des algues est effectuée par cette seule et unique référence dans un considérant. Le terme « algue » lui-même n’est jamais cité dans le texte. Si la Directive 2001/18 et le Règlement 1829/2003 ne font nulle part référence aux algues, la raison est qu’ils concernent tous deux les organismes génétiquement modifiés, quelle que soit la nature des organismes. La proposition de règlement de la Commission portant sur les seuls végétaux, il a paru important à la Commission de faire référence aux algues spécifiquement. Mais pourquoi ce soin particulier, bien que de manière pour le moins très discrète, à ce que la proposition recouvre les algues marines comme celles d’eau douce ? La réponse se trouve dans l’utilisation de ces organismes et les projets d’utilisation des techniques de modification génétique pour les adapter aux productions et processus de fabrication industriels.
De nombreuses applications commerciales envisagées
En mars 2023, quatre mois avant que la Commission européenne ne fasse sa proposition de déréglementation des OGM incluant les algues, le Comité de la Pêche du Parlement européen publiait justement un rapport sur le « futur du secteur européen des algues »ii. Ce rapport faisait alors suite à une communication de la Commission européenne, publiée en novembre 2022, intitulé « Vers un secteur des algues de l’UE fort et durable »iii.
Selon ce rapport, environ 70 000 espèces d’algues ont été recensées, parmi lesquelles 50 font l’objet d’une utilisation industrielle soit comme source alimentaire pour l’humain ou les animaux, mais également comme source d’énergie. Elle détaille ainsi une longue liste d’exemples d’applications commerciales avec « par exemple les aliments pour animaux/poissons et les additifs pour l’alimentation animale; les produits pharmaceutiques; les produits nutraceutiques; les biostimulants des végétaux; les emballages d’origine biologique; les produits cosmétiques ou les biocarburants et les services fournis dans le cadre du traitement des eaux usées; par exemple, la fixation du carbone et des nutriments, etc. », ajoutant que « lorsqu’elles sont cultivées en mer, les algues marines éliminent le carbone [NDLR : elles n’éliminent pas le carbone mais le captent], ce qui contribue à réduire l’acidification des océans ». Alors que, selon la Commission, la demande en algues marines de l’UE devrait être à hauteur de 9 milliards d’euros en 2030, avec par exemple des demandes pour la chlorelle, qui devrait croître de « 6,4 % d’ici à 2025 » et pour la spiruline de « 8,7% d’ici à 2025 », elle ajoute que « l’augmentation de la population végétarienne et végétalienne de l’UE, qui est actuellement estimée à environ 75 millions de personnes, et les consommateurs de plus en plus soucieux de l’environnement et de la santé feront également augmenter la demande de produits alimentaires et non alimentaires d’origine végétale, y compris les algues ».
La Commission européenne en ordre de marche
La Commission européenne estime donc que « le temps est venu d’exploiter pleinement le potentiel des algues comme ressource renouvelable en Europe ». Tout faire pour faciliter ce que la Commission nomme l’exploitation des algues s’inscrit, selon elle, dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, de la stratégie « De la ferme à la table » et de sa communication relative à une économie bleue durable. La Commission estime donc avoir « un rôle central à jouer dans la création de conditions permettant d’affronter les obstacles auxquels le secteur des algues de l’UE doit actuellement faire face ». Car le secteur industriel des algues ferait en effet face à plusieurs problèmes, comme des coûts de production élevés, une production à trop petite échelle n’utilisant pas les possibilités fournies par le littoral maritime européen, ou encore trop de textes législatifs s’appliquant aux algues. Si cette communication de la Commission européenne de fin 2022 ne cite pas la législation OGM comme un des obstacles, elle affiche comme objectif « une gouvernance cohérente et rationalisée dans l’ensemble de l’Union, y compris des procédures simplifiées et un cadre de suivi et de qualité, avec pour objectif final la mise sur le marché des produits à base d’algues issus de la biomasse, sûrs et d’origine durable ». Un objectif qui répondrait à ce que le Comité pêche du Parlement européen a identifié comme « opportunités à venir » pour le secteur des algues, à savoir, entre autres, leur « utilisation en biotechnologie et bioraffinerie, allant de l’alimentation humaine, animale aux cosmétiques, dépollution et biocarburants […] source en nutriments comme des vitamines, minéraux, anti-oxydants et acides aminés ».
Des algues modifiées génétiquement ?
L’utilisation de techniques de modification génétique sur les algues fait partie des projets en cours pour les transformer en usines de production. Mais ce n’est que récemment que ces algues génétiquement modifiées semblent faire l’objet d’une attention de plus en plus vive. En avril 2022, un articleiv résumait ainsi que « les biotechnologies sur les microalgues ont récemment reçu une attention croissante ». Récente car, jusqu’alors, « le développement de procédés de production économiquement viables implique de résoudre certaines limites de la biotechnologie des microalgues et l’évolution rapide des techniques de génie génétique sont apparues comme un outil pour dépasser ces limites ». Les auteurs affirment en effet que « bien que le génie génétique appliqué aux microalgues se soit avéré efficace […] au laboratoire, seuls de rares succès ont été obtenus pour être utilisé par l’industrie jusque maintenant ». Parmi les difficultés rencontrées, les auteurs listent de faibles quantités de produits obtenues, une croissance lente des algues, des coûts de production élevés, des contaminations fréquentes, une consommation énergétique élevée… Les nouvelles techniques sont vues comme utilisables pour, par exemple, augmenter les rendements de production d’une algue ou accélérer leur croissance. L’article permet également de comprendre que les nouvelles techniques de modification génétique, le séquençage et la numérisation du vivant végétal constituent la matrice à la base des annonces d’une utilisation industrielle accrue. Les auteurs expliquent en effet que les évolutions des techniques de séquençage et l’existence des données génomiques de souches de microalgues permettent aux chercheurs une plus grande capacité à explorer des utilisations commerciales.
Début 2024, un autre article scientifiquev explique la même tendance, rappelant que les micro-algues sont naturellement riches en carbohydrates, lipides, protéines, pigments, minéraux et vitamines, faisant de ces algues des « sources renouvelables et durables de composés actifs » pour la nutraceutique, l’alimentation humaine, animale (notamment l’aquaculture) et les agrocarburants. Les auteurs de l’article estiment que « l’utilisation du génie génétique sur les souches existantes est crucial pour utiliser et augmenter les bioraffineries utilisant des micro-algues ». Ce génie génétique auquel il font référence sont les techniques de modification génétique utilisant Crispr/Cas, les nucléases à doigt de zinc, Talen… ce que la Commission européenne nomme les « nouvelles techniques génomiques ».
Des documents de la Commission européenne ou des articles scientifiques transpirent une certaine excitation industrielle quant à l’utilisation des algues à des fins commerciales. De telles ambitions industrielles sont possiblement la raison du soin mis par la Commission européenne à englober ces futures algues génétiquement modifiées dans sa proposition de déréglementation des OGM. Une déréglementation qui lui avait déjà été demandée, notamment par une structure de lobbying historiquement connue sur le dossier des végétaux OGM : EuropaBio. Cette structure, qui est récemment intervenue sur les micro-organismes OGMvi, avait plus que fortement suggéré une déréglementation des algues OGM en 2021. Cette année là, en réponse à une consultation publique de la Commission européenne sur la bioéconomie bleue, EuropaBio écrivait que « pour explorer le potentiel complet des produits obtenus par des algues […] un aspect à prendre en compte est comment le développement d’approches innovantes pour améliorer les caractéristiques des algues (comme par exemple les technologie génétique et les nouvelles techniques génomiques) peut être mis en œuvre, par exemple en assurant une encadrement réglementaire proportionné et en générant une confiance du public »vii.
i Proposition de règlement de la Commission européenne, « Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625 », 5 juillet 2023.
ii Policy Department for Structural and Cohesion Policies, European Parliament, « The future of the EU algae sector », février 2023.
iii Commission européenne, « Vers un secteur des algues de l’UE fort et durable », 15 novembre 2022.
iv S.B. Grama et al., « Emerging Trends in Genetic Engineering of Microalgae for Commercial Applications », Marine Drugs, 24 avril 2022.
v A. Kamal et al., « Genetically engineered microalgae for enhanced bioactive compounds », Discov Appl Sci 6, 482 (2024).
vi Eric Meunier, « Prochaine étape de la déréglementation : les MGM », Inf’OGM, le journal, n°175, avril/juin 2024.
vii EuropaBio, « EuropaBio comments on the public consultation on blue bioeconomy », 10 août 2021.