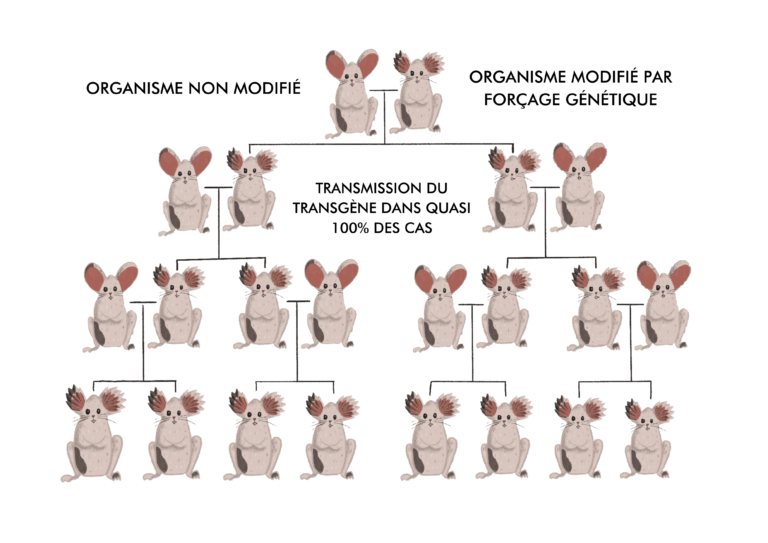Actualités
FRANCE – Cacophonie au HCB sur les nouvelles techniques de transformation du vivant

Le 4 février 2016, le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) a rendu publique une première contribution au débat sur le statut OGM ou non des produits issus des nouvelles techniques de biotechnologies. Cette contribution révèle une absence de consensus entre les acteurs, et soulève de nombreuses interrogations, notamment sur la non prise en compte de potentiels effets induits. Le travail n’est donc pas fini mais révèle déjà la tendance du Comité scientifique du HCB.
La Commission européenne promet depuis longtemps qu’elle présentera aux États membres son analyse juridique de la définition d’un OGM, et donc du statut OGM ou non OGM des produits obtenus par des nouvelles techniques de modification du génome (connues sous leur sigle anglais de NPBT). Les États membres sont donc attendus pour présenter leurs propres interprétations. En France, le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, avait annoncé en octobre 2015 la volonté du gouvernement d’organiser un dialogue avec les industriels semenciers début 2016 « afin d’être capables de fixer un cadre réglementaire et de peser sur les choix européens » pour ces nouvelles techniques [1].
Dans ce contexte, le HCB a fait le choix de s’auto-saisir de cette question [2]. Il a publié une première contribution, basée sur une note rédigée par un groupe de travail et « discutée et validée en séance plénière du comité [scientifique] » lors d’une réunion qui s’est tenue le 16 décembre 2015 et qu’il complètera par la suite. Le Comité scientifique (CS) devait répondre à trois points : décrire les techniques listées par la Commission européenne, aborder les « éventuels risques des NPBT pour l’environnement et la santé » et fournir les « éléments susceptibles de servir la réflexion quant à la qualification « OGM » ou non des produits » obtenus. Les membres du Comité économique, éthique et social (CEES) ont eux été invités « à clarifier leur positionnement ».
Sur la question centrale du statut des produits obtenus par une ou des nouvelles techniques, la contribution du CEES affirme qu’il « n’existe pas de consensus pour une interprétation univoque de la directive 2001/18 ». Certains membres du CEES appellent à toutes les considérer comme donnant des OGM soumis au champ d’application de la loi, les techniques utilisées ne disposant notamment d’aucun historique d’utilisation sûre. D’autres demandent leur exemption dans l’application de la directive 2001/18, considérant qu’elles ne font que produire plus rapidement ce qui peut tout aussi bien être obtenu naturellement ou par des procédés ne donnant pas d’OGM.
Faut-il prendre en compte le procédé ou le produit final ?
Le Comité scientifique (CS) du HCB a pour mission d’évaluer « les risques des biotechnologies pour l’environnement et la santé publique » [3]. Il est ainsi légitime qu’il fournisse des éléments – scientifiques bien sûr – susceptibles de servir la réflexion quant à la qualification « OGM » ou non des produits obtenus et qu’il aborde les risques sanitaires et environnementaux de ces techniques. Mais on ne l’attendait pas sur le terrain juridique. Or, le CS ne s’est pas contenté de l’analyse de risque qui lui revient, mais s’est aussi permis de proposer sa propre interprétation de la loi afin de déterminer quelle technique devait ou non entrer dans son champ d’application.
Le CS a de manière surprenante interprété la législation actuelle en affirmant que « le statut OGM d’un produit lui est conféré lorsqu’il est obtenu par des techniques impliquant notamment une insertion de nouvelle molécule d’ADN recombinant ».
Mais cette conclusion ne correspond guère à la définition d’un OGM précisée dans la directive 2001/18 : est OGM « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». Bien entendu, le CS du HCB rappelle que c’est bien un historique d’utilisation sans risque qui a permis à des techniques, dont la mutagenèse, considérées comme donnant des OGM, d’être exclues du champ d’application de la directive.
La contribution du CS tourne finalement autour des caractéristiques des produits finaux obtenus : contiennent-ils un élément modifié qui soit héritable ? La modification peut-elle être détectée et son origine (naturelle ou technologique) établie ? Les produits de la plante peuvent-ils être « étudiés indépendamment d’autres parties de la plante qui ne rentreraient pas dans une filière de commercialisation » ? Une approche basée sur les seules caractéristiques du produit final qui ne fait pas l’unanimité, loin de là.
Tout d’abord Sarah Vanuxem, une juriste consultée par le CEES du HCB, rappelle que « la réglementation européenne [sur les OGM] repose, à la différence de la réglementation nord-américaine, sur (…) leur procédé d’obtention, non de leur substance ; ils sont encadrés du fait de la manière dont ils ont été obtenus, non de leurs attributs ou qualités ». Cette analyse est partagée par les organisations de la société civile du CEES : pour elles, toute « interprétation juridique qui ne s’intéresserait qu’au produit, pour déterminer s’il doit être réglementé ou non, en ignorant le procédé utilisé, serait contraire à la directive 2001/18 ». De même la Fédération du Commerce et de la Distribution (qui représente des enseignes comme Carrefour, Aldi, Atac, Picard Surgelés, Monoprix, Champion, Hyper U, etc.) soutient que « le « principe d’équivalence en substance » – qui préconise de se fonder uniquement sur l’analyse du produit fini et qui est absent de la législation européenne en vigueur – ne doit pas s’appliquer dans la mesure où les risques ne sont pas que d’ordre sanitaire mais également environnementaux, juridiques, financiers voire éthiques (« consommateurs ») ».
Une seconde juriste, Estelle Brosset, a été consultée. Elle fournit une liste des interprétations possibles de la directive 2001/18, soulignant que, selon l’une d’entre elles, peuvent être exclus de la définition des OGM non seulement les produits qui ont été « modifiés d’une manière qui s’effectue naturellement », mais aussi ceux qui ont été « modifiés d’une manière qui ne peut pas s’effectuer naturellement ». Elle conclut que la réponse finale sera une affaire de choix, un choix politique assurément.
Pour le CS, il n’y aurait plus d’évaluation systématique de ces nouveaux produits
Les conclusions du CS sont claires. Il liste les techniques dont les produits ne doivent pas être soumis à une évaluation. Ainsi, les techniques d’insertion de mutation avec ou sans oligonucléotides (utilisation de nucléase – SDN1, SDN2 – et mutagénèse dirigée par oligonucléotides – ODM) ne devraient pas « faire l’objet d’une étude systématique calquée sur le modèle des OGM » (au sens de plante transgénique), si les plantes obtenues par ces techniques ne sont pas « distinguables d’une autre plante de même espèce et qui aurait pu être obtenue par « croisement conventionnel » ou par sélection de mutants (naturels ou induits) ». Pour la greffe d’un greffon non GM sur un porte-greffe GM, seul le porte-greffe GM devrait être évalué mais les « fruits ou graines » qui sont issus de la plante entière « ne nécessitent pas d’évaluation environnementale ou sanitaire propre ». De même pour la méthylation de l’ADN dépendante de l’ARN [4], « une plante portant des modifications épigénétiques ne relève pas d’une évaluation systématique calquée sur le modèle des OGM » au sens de plante transgénique. Cisgenèse / intragenèse ? « Certaines formes de cisgenèse / intragenèse pourraient bénéficier, au cas par cas et après examen des constructions, d’une exemption d’évaluation », dans les cas où les modifications ne seraient pas différenciables « de celles issues d’un événement qui pourrait être obtenu par sélection « classique » ». Enfin l’agro-infiltration, en milieu confiné et si aucune descendance n’est produite, ne devrait pas être considérée comme donnant des OGM, selon le CS.
Dernière précision d’importance : toute plante dont la modification génétique, qu’elle ait été obtenue par transgenèse, cisgenèse ou quelque technique que ce soit, n’est plus présente dans la plante car elle a été éliminée, « devrait être exemptée d’évaluation des risques et pourrait être considérée comme une plante obtenue par sélection conventionnelle ». Une référence indirecte à une technique, l’amélioration inverse, qui vise théoriquement à produire, à partir d’une plante fille souhaitée, les plantes parents de cette dernière.
Cette dernière précision ouvre la porte à un des points saillants de la contribution du CS : la faible prise en considération des potentiels effets non intentionnels comme des effets à des endroits imprévus et non désirés, donc hors-cible (« off target » en anglais) [5]. La non prise en compte de ces effets n’a pas fait l’unanimité. Ainsi, « un membre du CS a souhaité que le raisonnement de prise en compte des mutations hors-cible soit exposé ». Et la réponse apportée par le CS à ce membre est d’une simplicité déroutante : « les mutations hors-cible sont un point qui relève d’une question avant tout technique, en cours de changements et d’améliorations importants ». En clair, oui, les modifications génétiques hors-cible sont un problème qui existe mais qui ne mérite pas que l’on s’y attarde car les améliorations à venir de ces techniques les réduiront à un nombre « acceptable »… Le CS écrit en effet, qu’à terme, « en-deçà d’un seuil [6], le nombre des modifications hors-cible ne sera pas différent de celui des variations naturelles de séquence, il ne sera alors pas possible de faire une différence avec ces variations naturelles ». Cette approche quantitative de la part d’experts semble mettre de côté le fait que les variations produites par la manipulation ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui se produisent ou peuvent se produire naturellement…
Face à des techniques s’améliorant encore – donc pas encore au point ! – nul besoin donc pour le CS d’une évaluation de risque. Un argument pour le moins étonnant sur le plan scientifique… D’autant que le CS indique dans sa contribution que « les opérateurs choisissent le plus souvent de conduire une série de contrôles en laboratoire, préalablement à une commercialisation. Pour les techniques ciblées, les contrôles visent en particulier à s’assurer de la spécificité de la modification. Les critères de validation avant la poursuite du développement sont moléculaires et phénotypiques. Des contrôles règlementaires seraient possibles à ce stade ».
Pourquoi seulement constater la possibilité de tels contrôles et ne pas les exiger ? Et pourquoi ne pas demander aux opérateurs de regarder ailleurs dans le génome pour voir si des effets hors-cible n’ont pas modifié d’autres parties du génome ? Et pourquoi surtout faudrait-il refuser un contrôle public et une transparence totale de cette évaluation préalable, comme le prévoit la réglementation OGM ? D’autant que ces effets hors-cible pourraient, outre le besoin d’être évalués, être utilisés comme « signature », pas forcément si neutre que ça, de l’utilisation de techniques de modification génétique. De quoi fournir un outil de distinction entre des modifications naturelles ou conventionnelles et des modifications « technologiques » !
Des risques sanitaires et environnementaux peu ou pas abordés
On notera avec intérêt que le CS du HCB n’a finalement que très peu abordé la question des risques sanitaires et environnementaux. Le CS y fait référence par petites touches. Il affirme par exemple que « l’utilisation d’une technique moléculaire de modification génétique n’est pas obligatoirement associée à un risque biologique », reconnaissant donc en creux qu’elle peut être associée à un tel risque, ce qui pourrait justifier de demander une évaluation des risques… Il indique aussi succinctement si une technique dispose de risques propres (sans préciser lesquels) en comparaison des techniques connues de mutagenèse ou de fusion cellulaire.
Un autre point cité de manière judicieuse pas le CS aurait mérité d’être abordé plus en détail : qu’en est-il lorsqu’une même technique est utilisée plusieurs fois pour modifier le génome d’une plante ? Ou que plusieurs techniques sont utilisées en combinaison ? Et plusieurs fois ? Pour le CS, il s’agit d’un « dernier niveau de complexité [qui] s’ajoute du fait de la possibilité de multiples combinaisons entre lesdites techniques ». Si des cas d’utilisations cumulées de deux techniques sont listées, on ne trouve pas trace d’une réflexion sur les conséquences qui peuvent en résulter…
Absence de consensus au CEES… et de nombreuses questions en suspens
Tout d’abord, il est important de rappeler ici que la législation européenne implique qu’une exemption d’évaluation (telle que recommandée par le CS pour certaines techniques) entraîne de facto une exemption d’étiquetage et de surveillance des impacts potentiels sur la santé et l’environnement post-commercialisation. Les consommateurs se retrouveraient donc dans la position de consommer des produits issus de biotechnologies récentes (sans recul historique donc…) non évalués, et sans possibilité de le savoir.
La question de l’étiquetage a été abordée par certains membres [7], comme un droit à l’information du consommateur. Ces organisations rappellent qu’un tel étiquetage est déjà obligatoire pour des produits issus d’OGM transgéniques même lorsqu’on ne peut retrouver de trace moléculaire de la modification génétique (huiles raffinées, lécithines purifiées…). L’absence de marqueur génétique du procédé de modification n’empêche donc pas, selon ces organisations, la traçabilité (documentaire) des produits le long de la chaîne alimentaire ni l’information du consommateur. Elles insistent sur le fait que « les producteurs et les consommateurs (« bio » par exemple) qui ne souhaitent pas avoir recours à des produits issus de ces techniques, que ce soit pour des raisons de refus des risques, de choix personnel, d’image ou de respect d’un cahier des charges » doivent pouvoir choisir. Ce point de vue est, une fois encore, soutenu par la « la Fédération du Commerce et de la Distribution, qui considère que les sociétés semencières doivent endosser la responsabilité civile et pénale de mise sur le marché des « nouveaux » organismes issus de ces techniques », quel que soit l’état des connaissances scientifiques au moment de leur commercialisation. Une position qui interpelle d’autant plus qu’il est aujourd’hui question que les risques liés à l’utilisation de produits issus de ces techniques puissent ne pas être évalués préalablement à leur mise en marché.
Ce point de vue n’est pas partagé par d’autres membres [8] qui soulignent qu’un tel étiquetage serait difficile à mettre en place et non pertinent pour des « produits in fine non distinguables de produits issus de variétés conventionnelles ». On retrouve dans cette précision l’idée portée également par le CS qu’il faut regarder uniquement le produit final et non le procédé, au contraire de ce qui se pratique pourtant dans de nombreux domaines, de produits sous charte de qualité jusqu’aux OGM…
Brevet or not brevet ? Si c’est brevetable, c’est « OGM »
La Fédération du Commerce et de la Distribution ainsi que des organisations paysannes et de la société civile abordent aussi le sujet controversé de la propriété industrielle. Dans une contribution commune, sept d’entre elles [9] expliquent qu’en suivant la logique du CS et des obtenteurs – nombre de produits issus de ces techniques ne doivent pas être considérés comme donnant des OGM car ils peuvent être obtenus par des procédés qui ne font que découvrir et brasser la diversité génétique naturelle déjà existante – ces produits ne peuvent être considérés comme « des inventions pouvant être brevetées ». Ou pour le dire plus simplement : si c’est brevetable, c’est une invention et non une découverte de ce qui existe déjà, donc c’est « OGM ». Ces sept mêmes organisations ainsi que la fédération du commerce et de la distribution et l’association de consommateurs CNAFAL s’accordent pour considérer que les brevets sur les gènes natifs ont pour conséquence un « verrouillage de l’accès à certaines ressources génétiques », la « constitution d’oligopoles » et que l’ignorance de la présence de brevets dans telle ou telle plante est problématique en soi. Sans surprise, cette analyse n’est pas partagée par d’autres organisations du CEES (FNSEA, GNIS ou encore UFS). Pour elles, « si certaines des techniques elles-mêmes sont brevetées, la question s’avère plus complexe et nuancée en ce qui concerne les produits issus de ces techniques, dont les potentiels brevets existants » ne se révèleraient pas nécessairement bloquants notamment en raison d’une plus grande restriction récente des revendications des brevets délivrés [10]. Sur ce point en tout cas, d’autres discussions à venir sont annoncées dans la contribution du HCB.
Des discussions à venir, à partir de positions antagonistes
Les discussions à venir devraient aussi aborder la question du modèle agricole et éthique. Pour le groupe de sept organisations déjà cité, un développement incontrôlé des NPBT conduirait (notamment) à conforter rapidement un modèle agricole « productiviste / industriel », qui accentuerait « les problèmes environnementaux que causent ces monocultures, à l’encontre des politiques publiques agroécologiques » ou augmenterait le coût financier « de l’accès au marché résultant du coût des brevets et non disponibilité à terme de semences non modifiées ». Une analyse qui se confronte à celle des cinq autres organisations déjà citées également pour qui les nouvelles techniques peuvent « contribuer à une agriculture plus durable, tant par l’optimisation ou l’amélioration des pratiques actuelles que par le développement de nouvelles pratiques agricoles, de nouveaux produits et débouchés. Il ne faut dès lors surtout pas fermer la porte à cette option et donc ne pas soumettre les NPBT à des exigences (et des coûts) réglementaires qui les rendraient économiquement non viables ». Le débat risque d’être compliqué avec des positions si antagonistes et dont l’arbitrage ne peut être que politique…
Si certains membres du CEES ont questionné la position du CS sur les risques sanitaires et environnementaux, abordant comme exemple la question des effets hors-cible que nous avons déjà présentée, d’autres discussions sont d’ores et déjà envisagées : « traçabilité des NPBT, information des consommateurs, protection juridique des techniques et des produits, réglementation, examen prospectif des techniques, analyse de la maturité de celles qui sont effectivement mises en œuvre, etc. », le tout pour « fournir aux autorités publiques l’ensemble des éléments d’appréciation nécessaires ». Le travail continue donc…
[1] , « Agriculture – Innovation 2025 : des OGM dans l’agro-écologie ? », Inf’OGM, 16 novembre 2015
[2] voir : http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/avis/reflexion-sur-nouvelles-techniques-premiere-etape. Cette contribution du HCB se compose de la contribution du Comité Scientifique (CS) (http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2016/02/04/160204hcb-note-csnpbt.pdf) et de celle du Comité économique, éthique et social (CEES) (http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2016/02/04/160204hcb-synthesecontributionsetdebats-ceesnpbt_0.pdf)
[4] La technique de méthylation de l’ADN dépendante de l’ARN ambitionne de modifier l’état chimique de la molécule d’ADN sans en modifier la séquence. Cf. , « La recherche fondamentale modifie-t-elle l’approche des biotechnologies ? », Inf’OGM, 13 février 2012
[5] L’apparition de mutation ailleurs dans le génome par exemple
[6] Un certain nombre de mutations apparues, sans précision du dit nombre
[7] Amis de la Terre, Confédération Paysanne, Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique, France Nature Environnement, Greenpeace, Réseau Semences Paysannes, Union Nationale de l’Apiculture Française, Conseil National des Associations Familiales laïques
[8] Coop de France, FNSEA, Groupement National Interprofessionnel des Semences, Jeunes Agriculteurs, Union Française des Semenciers
[9] cf. note 7
[10] Inf’OGM abordera justement cette question des revendications des brevets dans un futur article qui montrera que cette affirmation de la FNSEA, du GNIS ou de l’UFS est à relativiser