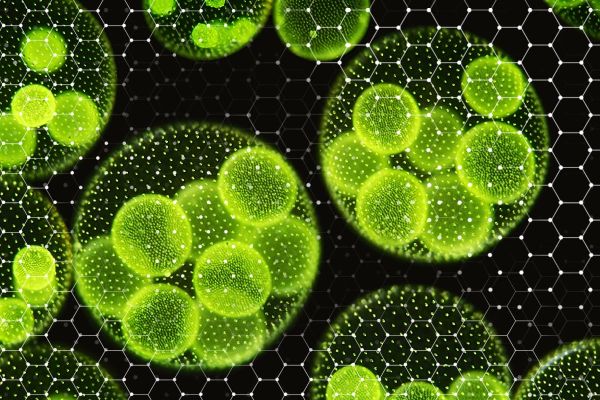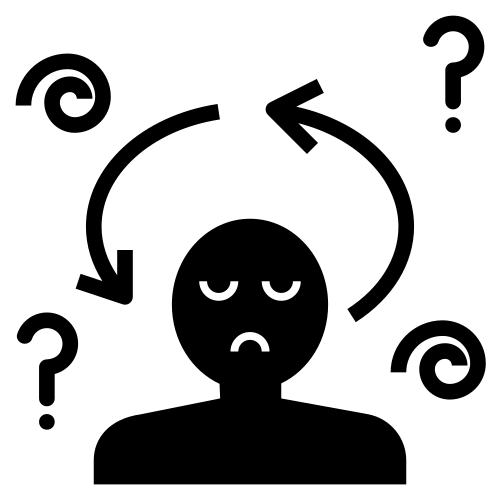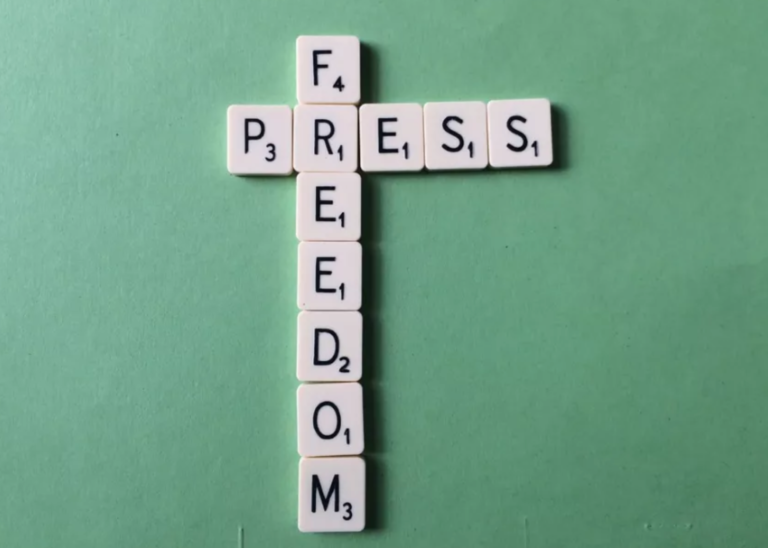Veille citoyenne sur le cadre réglementaire des OGM
La directive européenne sur la dissémination volontaire des OGM vient d’être suite au processus de conciliation entre les positions de la Commission Européenne et celles du Parlement Européen. La principale évolution concerne la reconnaissance de l’amendement 39 du Parlement Européen qui prévoit la mise en place d’un registre des implantations d’OGM en Europe. Ce registre sera accessible au public. Cependant de nombreux points restent flous, comme la responsabilité (une loi est prévue pour fin 2001) et la traçabilité.
C’est là le résultat d’un long débat qui depuis 1997 n’a fait que s’intensifier. Nous vous proposons dans ce dossier de synthèse quelques éléments de repérage pour remettre en perspective les enjeux et les interrogations sous tendus par cette nouvelle directive 90-220.
Les objectifs de la directive.
Mise en place en 1990 par la Commission Européenne, à un moment où les interrogations sur les OGM étaient encore confinées dans le cercle étroit des spécialistes des biotechnologies et de la technocratie, la réglementation sur la dissémination des OGM visait à formaliser les procédures pour les autorisations de production des OGM (micro-organismes, plantes et animaux) soit à titre expérimental, soit au titre de leur importation ou commercialisation (mise sur le marché).
Ce faisant, était d’emblée reconnue l’existence de risques de dissémination des OGM, nécessitant alors un contrôle strict et des études au cas par cas avant de les autoriser. La Commission interprétera plus tard cela comme une observation du principe de précaution.
S’agissant des plantes transgéniques, en 1990 nous en sommes encore aux balbutiements. Il faut attendre 1994 pour qu’en soit autorisée la première mise sur le marché (tabac produit par la SEITA résistant à un herbicide). Ces autorisations vont vraiment commencer à se multiplier à partir de 1996 avec diverses variétés de maïs, soja et colza. (Cf fiche annexe 6 rapport CGB 1998).
Les premières importations de maïs transgénique en provenance des Etats Unis où leur culture est libre puisque reconnus comme « substantiellement équivalents », vont alerter l’opinion publique sur les problèmes que peuvent poser les OGM.
L’amorce d’un débat démocratique.
Paradoxalement c’est le moment aussi où la Commission Européenne souhaite initier une révision de la directive 90-220 dans un souci de simplification des procédures complexes qu’elle avait édictées dont elle estime qu’elles freinent trop le rythme des mises sur le marché. L’analyse économique et les perspectives du développement des biotechnologies qu’elle encourage par ailleurs fortement, l’incite à vouloir dépasser le principe de précaution au nom de la concurrence économique dans le contexte d’intensification de la mondialisation.
Se profilent là les tensions quant à la libre circulation des marchandises (et en particulier des OGM américains dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce -OMC). Se noue alors aussi le débat sur la mise en oeuvre du protocole de biosécurité à Carthagène en Colombie. Cependant cette volonté d’accélération du développement d’une agriculture transgénique européenne pour rentrer en compétition avec les Etats Unis et le Canada, va se trouver interpellée par le Parlement Européen (PE) qui bénéficie alors d’un renforcement de son pouvoir législatif avec la mise en place de la procédure de codécision avec la Commission Européenne (traité d’ Amsterdam 1997).
En effet, une majorité se dessine au PE pour se faire l’écho des préoccupations grandissantes des populations européennes face aux biotechnologies en particulier dans le domaine alimentaire. (Cf données de l’Eurobaromètre 1996 et 52 en 1999.) Les parlementaires demanderont au contraire de la Commission un renforcement de l’application du principe de précaution.
A partir de 1998 va s’engager une série d’aller-retours des projets de révision de la directive 90-220 entre la CE et le PE sans qu’aucun n’accord ne puisse se dessiner.
Le blocage du système et les termes du débat actuel.
Les gouvernements européens interpellés dans cette querelles des pouvoirs, vont chercher une solution lors du Conseil des Ministres de l’Environnement en juin 99. Là encore l’absence totale de consensus sur les OGM entre les Etats membres aboutira à ce qui a été appelé « un mora toire de fait » consistant à geler toute nouvelle autorisation de mise sur le marché d’OGM (laissant chaque Etat membre gérer dans leur cadre législatif propre transposant la directive 90-220, les cultures transgéniques expérimentales) dans l’attente d’une nouvelle législation sur l’étiquetage des OGM (Voir fiche à venir…).
Une nouvelle décision définissant un seuil de tolérance de 1% d’OGM par ingrédient en dessous duquel les produits contenant des OGM ne sont pas étiqueté est alors adoptée le 10 janvier 2000 (réglement européen 49-2000) cherchant à répondre au souci des consommateurs européens dont les 3/4 souhaitent un tel étiquetage des OGM (Eurobaromètre novembre 98).
En dépit d’un assouplissement de la position du nouveau Parlement Européen élu en juin 99, dans son projet de nouvelle directive voté le 12 avril 2000 revenant sur les amendements préconisés par le précédent Parlement, la procédure de concil iation est engagée avec l a Commission Européenne suite au nouveau sommet informel des Ministres européens de l’Environnement de juillet 2000.
Avant même l’aboutissement de la conciliation, l’actualité agricole européenne va mettre en lumière la réalité des risques de pollution génétique dénoncés par les opposants aux cultures transgéniques En Europe ce sont les les affaires du maïs, du colza et du soja contaminés au cours l’été 2000. Ces problèmes mettent en avant l’incompréhensible recul du Parlement Européen qui a écarté de son projet de directive le principe un temps reconnu d’une nécessaire définition d’une responsabilité juridique en cas de dissémination génétique à grande échelle. Aux Etats-Unis, c’est l’affaire du maïs Starlink qui éclate en septembre 2000 qui va nécessiter le retrait de produits alimentaires contaminés par du maïs transgénique destiné à l’alimentation animale, renforcant un mouvement de méfiance naissant dans l’opinion américaine.
Les grandes questions qui sont posées par les citoyens aujourd’hui.
Le hiatus entre l’état des interrogations des populations et le niveau du débat dans les instances européennes quant à la redéfinition du cadre réglementaire des OGM soulève le problème de la difficile mise en place d’un processus de décision véritablement démocratique à l’échelle européenne (équilibre des pouvoir entre PE et CE, règles de votation au Conseil de l’Union Européenne respectant la majorité). Mais il renvoie aussi à la complexité des dispositifs réglementaires nationaux transposant la directive 90-220. Complexité nuisible à la transparence. Ainsi pour prendre l’exemple de la réglementation française, dès lors que le débat s’est amorcé sur les OGM, nombre de questions ont commencé à être soulevées par les citoyens ouvrant sur une critique de la Commission du Génie Biomoléculaire (CGB) installée en 1986 et qui se trouve être au centre du dispositif français de contrôle et d’expertise des OGM (loi du 13 juillet 1992).
Les experts et les citoyens
Ces questions ont trouvé un écho particulier en juin 98 à l’occasion de la Conférence des Citoyens organisée par l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques présidé par le député Jean Yves Le Déault.
Cependant les recommandations faites par les citoyens inspirées par le principes de précaution ont fait long feu et restent encore pour le moment lettre morte. Deux exemples : la réforme de la composition de la CGB afin de rééquilibrer le poids des experts par un deuxième collège de représentants de la société civile. L’autorisation de commercialisation du maïs Novartis Bt176 contenant un gène de résistance aux antibiotiques dénoncée lors de la Conférence des citoyens va ouvrir une vaste polémique à l’instigation de Greenpeace. Cela aboutira en décembre 98 à un arrêt du Conseil d’Etat suspendant l’autorisation et demandant à la Cour de Justice Européenne de trancher. Ce qui sera fait en mars 2000 dans un sens favorable à l’autorisation, tout en ouvrant des possibilités de recours aux juridictions nationales par rapport aux décisions de la Commission Européenne au nom du principe de précaution ainsi fortement réaffirmé. Greenpeace poursuivait alors son action en publiant en mai 2000 un rapport mettant en évidence la faiblesse des évaluations scientifiques à partir desquelles avait été autorisé ce maïs Bt de Novartis, mettant ainsi en cause la compétence de la CGB qui avait instruit le dossier.
Ce rapport arrive en écho des interrogations de l’un des membres mêmes de la CGB – Gilles Eric Séralini professeur de biologie moléculaire à l’Université de Caen – mettant en cause dans des contributions personnelles aux rapports 1998 et 1999 de la CGB le peu de sérieux des études de toxicologie sur les OGM.
Les essais fantômes
Les cultures expérimentales d’OGM sont soumises à une procédure d’autorisation par le Ministère de l’Agriculture qui s’appuie sur les avis de la CGB. Les cultures autorisées font l’objet d’une fiche d’information du public devant être affichée en mairie, mais qui occulte la localisation exacte des parcelles transgéniques. Ce point est contesté par les associations environnementales au premier rang desquelles les Amis de la Terre et France Nature Environnement qui développent une campagne pour la transparence des essais d’OGM au nom de la loi sur les OGM de 1992. Le recours déposé devant la Commission d’Accès aux Documents Administratifs leur donne raison en mars 1999. Mais l’administration résiste toujours jusque là dans la transmission de ces informations nécessaires en particulier aux agriculteurs bio dont les propres cultures sont menacées de contamination génétique par des OGM et donc susceptibles d’être déclassées au regard de la directive européenne sur les produits bio qui interdit toute trace d’OGM .
Quelle biovigilance ?
D’un côté, les poursuites judiciaires se multiplient à l’encontre des opposants détruisant les cultures d’essais transgéniques et tout dernièrement avec la décision d’un Procureur de la République de recourir aux prélévements d’ADN pour confondre des militantes de la résistance aux OGM d’un fauchage d’un champ de maïs transgénique à Longué dans le Maine et Loire. De l’autre les mouvements environnementalistes et écologistes appellent à la mise en place d’une véritable biovigilance, et interpellent le Ministère de l’Agriculture pour savoir pourquoi l’installation du Comité de Biovigilance n’a toujours pas été confirmée par décret comme il se devait ? Si bien que le Comité provisoire actuel manque, et de moyens et de légitimité face à une CGB toute puissante qui peut apparaître juge et partie. En effet, alors que le Comité provisoire de biovigilance n’a pas été saisi lors des affaires de contamination génétique de l’été 2000, la CGB est interrogée sur l’étude des chercheurs de l’Université de Cornwell sur la nocivité du maïs Bt de Monsanto sur les papillons Monarque, et affirme que ces résultats ne remettent pas en cause l’avis favorable qu’elle avait donné à ce maïs.
En conclusion, toutes ces interrogations appellent le renforcement d’une veille citoyenne sur l’actualité des OGM dont le lobby biotechnologique qui possède de puissants moyens, se passerait bien. En ce sens, il faut souligner que le groupe Vert au Parlement Européen souhaite que le moratoire de facto sur les autorisations perdurent en attendant qu’avec les lois projetées sur les aspects de responsabilité en cas de dissémination et sur la traçabilité des OGM le « puzzle soit complet ».