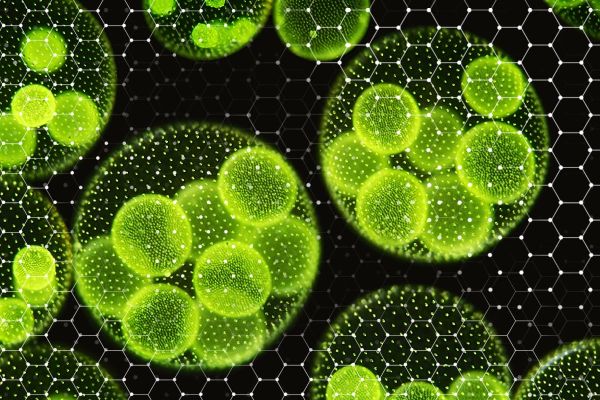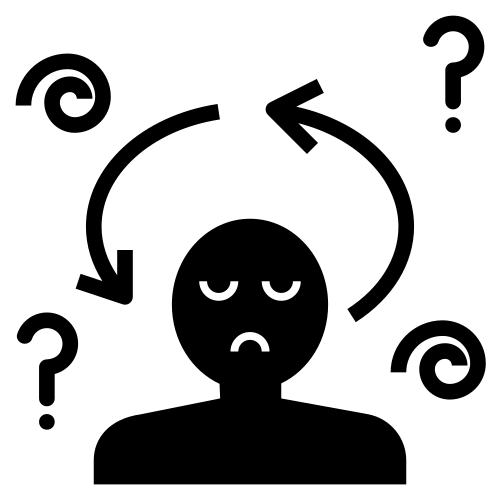OGM : indispensables transparence et accès aux données brutes
Le 14 janvier 2013, suite à « l’affaire Séralini » [1], l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) publiait sur son site internet le dossier complet de demande d’autorisation commerciale du maïs NK603 génétiquement modifié par Monsanto. Il s’agit d’une première : les citoyens et les chercheurs pouvaient avoir accès aux données brutes sans avoir à en faire la demande. Monsanto a aussitôt demandé à l’AESA de discuter des modalités d’une telle publication, sans cacher son désaccord avec une démarche qui selon l’entreprise, viole ses droits d’auteur [2]. « L’affaire Séralini » aura donc aussi remis au centre du débat la question de la transparence sur les données fournies par les entreprises. Inf’OGM expose ici sa position et ses demandes sur un sujet – la transparence des données – qui est l’un de ses objets statutaires.
Les plantes génétiquement modifiées (PGM) doivent obligatoirement être autorisées avant d’être commercialisées dans l’Union européenne. Les entreprises déposent donc des demandes d’autorisation qui doivent contenir certaines informations telle qu’une description de la PGM, ses caractéristiques, l’objet de son utilisation (culture, alimentation humaine, alimentation animale…), mais aussi les résultats d’analyses qui ont été conduites pour en évaluer les risques potentiels sur la santé et l’environnement. L’entreprise doit fournir une comparaison de la composition de la PGM avec un parent semi-isogénique (même génome hormis le transgène et quelques variations inévitables), une caractérisation moléculaire du transgène (nombre de transgènes insérés dans le génome, lieu d’insertion…), une étude de toxicologie conduite avec la seule protéine transgénique ou avec la PGM entière, une étude d’alimentarité, d’allergénicité potentielle… Le dossier est ensuite transmis aux comités d’experts nationaux et européen qui, sur base d’une simple lecture des données, émettent un avis, lequel servira à la décision politique d’autoriser ou d’interdire telle ou telle PGM.
Toute décision doit être scientifiquement argumentée
Ce système d’autorisation est donc basé sur des résultats d’analyses. En cela, il répond aux exigences de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui impose que les décisions politiques liées au commerce reposent sur des considérations uniquement scientifiques. Dans le cas contraire, l’OMC considère que ces décisions, si elles devaient interdire un produit, relèveraient d’une entrave au commerce. Avec l’objectif d’harmoniser les normes alimentaires à l’échelon international, l’OMC utilise comme référence des accords adoptés en 1994. Il s’agit de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ou accord SPS) et de l’accord sur les obstacles techniques au commerce (ou accord OTC). L’accord SPS impose que les décisions soient prises selon des critères d’évaluation scientifique des risques comme l’a rappelé l’OMC dans son jugement du conflit entre l’Union européenne et d’autres pays [3] sur le moratoire de facto et les procédures d’autorisations européennes. Concrètement, « scientifique », dans ce cadre, signifie compatible avec les standards de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). En effet, la « bonne science » est officiellement définie par l’OCDE, notamment les standards pour les études de toxicologie et d’allergologie.
Le débat sur les PGM devient dès lors un débat d’experts, dans lequel le citoyen est éliminé s’il ne parle pas avec les mots de la science officielle. Les autorisations sont données sur la base d’une évaluation dite scientifique ; les refus d’autorisation de commercialisation de PGM sont légales au regard de l’OMC si elles sont scientifiquement argumentées ; les consultations publiques organisées sur les PGM requièrent des réponses « scientifiques » pour être retenues ; les citoyens n’ont le droit d’avoir un point de vue et de l’exprimer que si leur parole est scientifique… Cette omniprésence de la science est poussée jusqu’à demander aux citoyens leur confiance aveugle dans le travail « scientifique » des entreprises et d’oublier que l’essentiel de la problématique des OGM est d’une autre nature.
Des controverses scientifiques à répétition
Or cette « bonne science » qui est censée garantir l’innocuité des PGM autorisées n’est pas exempte de controverses, que les études scientifiques publiées montrent l’absence ou l’existence de risques liés aux PGM. Orchestrés en sous-main par l’industrie, les dénigrements que subissent les articles montrant des impacts liés à des PGM sont souvent violents, comme l’ont expérimenté des chercheurs comme Pustzaï, Malatesta ou Séralini. Ces critiques reprochent une mauvaise construction des études, des résultats mal analysés voire le parti-pris des chercheurs les ayant conduites. Jusqu’à aujourd’hui, les experts européens ont également eu leur part à jouer en refusant très souvent de prendre en considération de telles études au prétexte d’une qualité scientifique insuffisante ou de résultats discutables. Mais ces mêmes experts ne se montrent pas aussi critiques vis-à-vis des études des entreprises pourtant critiquables de la même façon. Témoin de cela, le citoyen risque d’avoir du mal à accorder sa confiance dans les analyses des entreprises et la lecture qu’en font les experts.
Les entreprises conduisent donc elles-mêmes les analyses d’évaluation d’impacts des risques, situation forcément génératrice de suspicion. D’autant que le constat effectué par le citoyen est clair : s’il a accès sans restriction aux produits contenant des PGM, il n’a pas accès avec la même liberté aux données brutes ayant permis à ce produit d’être autorisé. Il comprend donc que la communauté scientifique ne peut remplir son rôle qui est de produire une connaissance suffisante pour rassurer le citoyen. Car si les chercheurs peuvent avoir accès aux dossiers complets des entreprises, ils ne peuvent les utiliser pour reproduire une expérience faite par l’entreprise et éventuellement publier leurs résultats. Pour que des chercheurs puissent réinterpréter les données brutes du MON863, il a fallu que Greenpeace les obtienne suite à un procès gagné en Allemagne.
Une telle situation a pour seule solution une transparence accrue de l’Autorité européenne de Sécurité alimentaire (AESA) en mettant en œuvre un accès non restreint aux dossiers complets de demandes d’autorisation. Il est important qu’une contre-expertise soit possible. Ce qui nécessite donc que l’AESA soit transparente sur ces dossiers ainsi que sur les déclarations d’intérêts des experts et salariés travaillant pour elle.
Ce qu’impose la législation
Les législations internationales (convention d’Aarhus), européenne (règlements 1049/2001, 178/2002, 1367/2006, et 503/2013), et française (loi du 25 juin 2008 sur les OGM, loi du 27 décembre 2012 sur la participation du public…) imposent aux administrations d’assurer l’accès aux documents et informations environnementales qu’elles détiennent. Si cette communication ne doit pas, selon les lois, aller à l’encontre du « secret industriel », Inf’OGM plaide pour que ce dernier ne recouvre pas des données concernant l’évaluation des risques et des impacts.
Le règlement européen 1049/2001 établit précisément que « les documents [des dossiers de demande d’une autorisation commerciale pour un OGM déposés par les entreprises, ndlr] [doivent être] rendus accessibles au public soit à la suite d’une demande écrite, soit directement sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un registre ». L’AESA tient effectivement à disposition tous les dossiers complets de demande d’autorisation commerciale de PGM, dans le cas d’une demande écrite. Mais la procédure existante (cf. encadré) doit être améliorée.
Des mesures simples et concrètes à mettre en œuvre
Inf’OGM considère que la mise en œuvre de la transparence vis-à-vis des citoyens français et européens doit prévaloir sur toute autre considération. Elle permettra d’établir la confiance des citoyens, puisque des laboratoires indépendants auront, entre autres, la capacité de confirmer, ou d’infirmer les résultats fournis par les entreprises, soit en refaisant l’expérience, soit en traitant de façon différente les données brutes fournies par ces entreprises. Une telle mise en œuvre nécessite une publication des dossiers complets, sur internet, sans restriction et non conditionnée à une demande d’accès. Ces dossiers mis en ligne devront contenir les protocoles détaillés, le matériel utilisé tant biologique que technique à l’instar du nom des logiciels commerciaux utilisés par les entreprises (ainsi que toutes informations nécessaires à la compréhension du fonctionnement et de l’utilisation du logiciel ainsi que des résultats produits), le nom du ou des laboratoires ayant conduit les expériences, l’origine des financements. Ces données fournies devront l’être dans un format permettant leur utilisation informatique directe (type tableur) pour, notamment, permettre un travail de ré-analyse sans re-saisie des données fournies. Enfin, les dossiers complets devront donc être accessibles par tous et disséminables par tous.
Les points d’opposition à une telle transparence
La question de la transparence et de l’accès aux données brutes se heurte régulièrement à ce que les entreprises appellent le secret industriel. Ce secret concerne deux types d’informations. D’une part les informations confidentielles telle que la séquence génétique du transgène en lui-même, ou le nom des personnes impliquées dans les analyses conduites. D’autre part, les entreprises considèrent que les données brutes de leurs analyses, les résultats en eux-mêmes, relèvent du secret industriel. Un secret que la loi impose aujourd’hui de ne pas garder confidentiel. Le souci des entreprises concerne la concurrence. Elles considèrent qu’une dissémination sans contrôle de ces données brutes pourraient conduire des entreprises concurrentes à construire des dossiers de demandes d’autorisation en reprenant ces données, sans avoir à assumer les dépenses pour conduire les analyses. La législation imposant pourtant que ces données soient publiques, les entreprises ont pris pour habitude d’invoquer le respect du droit d’auteur, à l’instar de Monsanto sur le dossier du maïs NK603. Ainsi, l’AESA précise sur la page Internet où se trouve le dossier du maïs NK603 que ce dossier ne lui appartient pas et que toute personne ou organisme souhaitant « reproduire, traduire, redistribuer, exploiter ou utiliser commercialement le contenu » de ce dossier doit « contacter Monsanto Services International S.A », propriétaire des droits d’auteur sur ce dossier. Les dossiers sont publics mais inutilisables. Or, ne pas pouvoir diffuser ces données brutes interdit aux scientifiques de pouvoir publier leurs résultats en les comparant à ceux de Monsanto (puisqu’ils ne peuvent pas publier ceux de Monsanto). Un point à améliorer obligatoirement !
Une transparence complète est fondamentale pour un débat serein sur l’innocuité des PGM. Monsanto craignant que cette transparence ne lui porte préjudice a donc fait le choix de mettre la pression sur les institutions publiques pour qu’elles n’aillent pas trop loin. Pourtant, la confiance des citoyens est au prix d’une communauté scientifique capable de réaliser des contre-expertises indépendantes des études réalisées par les entreprises en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché.
L’accès aux données brutes tel qu’en vigueur actuellement
En vertu du règlement 178/2002 et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout citoyen ainsi que toute personne morale peut soumettre une demande d’accès à des documents détenus par l’AESA, y compris ceux concernant une demande d’autorisation d’une PGM. L’AESA envoie alors une version publique de ce dossier, mais certaines données sont cachées, à l’instar de toutes les informations protégées par un brevet comme la séquence génétique et le nom des personnes intervenues sur ce dossier. Les informations qu’un citoyen européen peut demander concernent, entre autres, une description de l’OGM (méthode de transformation, caractérisation moléculaire, les nouvelles caractéristiques…), les résultats d’analyse comparative de composition, les résultats d’analyses d’impacts sanitaires sur animaux (toxicité, allergénicité), l’évaluation des risques environnementaux… de même que les échanges de courriels et courriers que l’AESA a pu avoir avec des personnes / structures extérieures.
La demande à l’AESA se fait « sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques ou fax, dans l’une des langues officielles de l’UE et de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier le document concerné » [4]. L’AESA dispose alors de 15 jours ouvrables pour y répondre, par voie informatique ou postale, prolongeable de 15 jours.
Les dossiers sont envoyés en format pdf, ce qui oblige à ressaisir les données si l’on souhaite les réanalyser. Une re-saisie qui peut être génératrice d’erreurs de saisie outre la perte de temps. Un problème qui concerne autant les citoyens que les experts des comités nationaux. Par ailleurs, si l’AESA adresse les dossiers, ces derniers ne sont pour autant pas diffusables par le citoyen du fait des droits d’auteur que les entreprises ont sur ces dossiers.
[1] , « Etude G.-E. Séralini : quel bilan ? (dossier) », Inf’OGM, 6 décembre 2012
[2] ,
, « UE – Transparence des données sur les OGM : Monsanto s’oppose à l’AESA », Inf’OGM, 14 mars 2013
[3] , « OMC – Le jugement confirmé », Inf’OGM, 29 septembre 2006
[4] , « UE – OGM : les données brutes des entreprises sont partiellement publiques », Inf’OGM, 27 novembre 2012