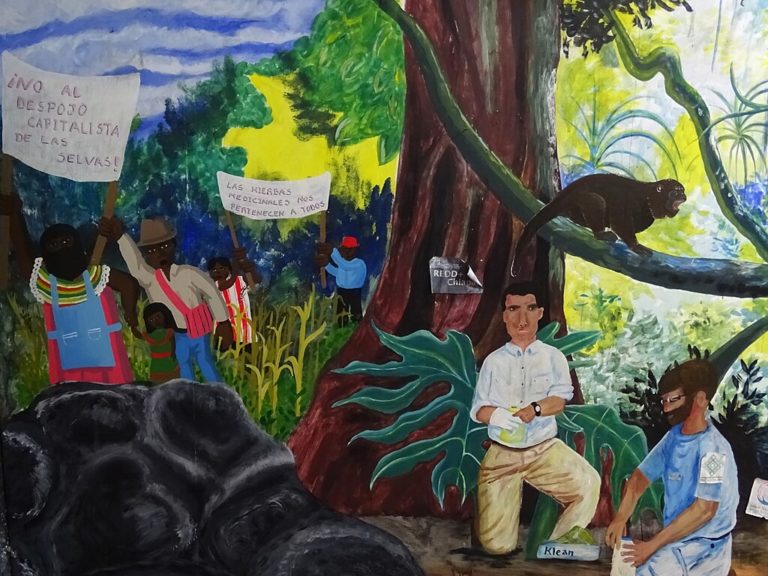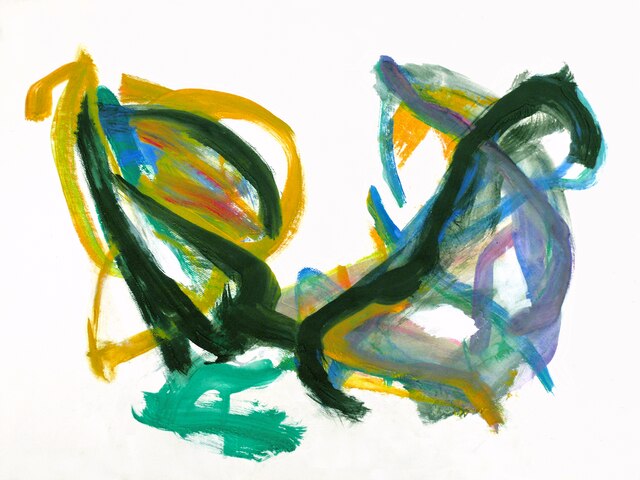Actualités
OGM : ce que propose Benoît Hamon, Parti Socialiste

Benoît Hamon n’autorisera pas la culture de plantes transgéniques sur le territoire français et aucun accord de libre-échange ne doit avoir pour conséquence la modification des règles de l’Union européenne sur les autorisations d’importations.
Mais le candidat socialiste a une position plus floue sur les nouveaux OGM : ils doivent être considérés comme des OGM et étiquetés en tant que tels. Pourtant, c’est pour lui une question européenne avant d’être un enjeu de campagne présidentielle. Du coup, si la Cour de Justice de l’UE décide que les nouveaux OGM ne sont pas des OGM, quelle décision prendra-t-il ?
Il réaffirme son soutien à l’agriculture biologique et souhaite réformer le fonctionnement du catalogue officiel pour y introduire les semences paysannes, sans pour autant nier l’importance des brevets dans le fonctionnement agricole.
Inf’OGM – Si vous êtes élu Président de la République française, quelle sera votre politique en matière de culture de plantes transgéniques ?
Benoît Hamon (B. H.) La France, au même titre que les autres États, doit faire face à une crise environnementale globale. Des changements considérables doivent être conduits dans les quelques prochaines années notamment dans le domaine agricole. En matière d’agriculture, les objectifs de maintien de la productivité agricole et de respect de l’environnement sont réalisables en parallèle. De plus en plus de solutions viables se font jour pour cela et je ne crois pas que la culture de plantes transgéniques en fasse partie. Cette forme de culture répond à des besoins issus de modèles industriels beaucoup plus qu’elle ne contribue à une production agricole de qualité et soulève encore de nombreux problèmes environnementaux, sanitaires, mais aussi économiques et sociaux, encore irrésolus. Je ne permettrai pas la culture de plantes transgéniques sur le territoire français et utiliserai tous les outils juridiques à notre disposition pour le garantir. En la matière, l’Union européenne a une influence essentielle et il faudra agir à ce niveau pour améliorer les procédures d’évaluation des plantes transgéniques.
La France importe annuellement environ quatre millions de tonnes de soja OGM pour l’alimentation de son bétail. Que pensez-vous de cette situation ?
B. H. L’importation de produits agricoles GM est licite. Mais cela n’est pas sans soulever d’importantes interrogations. Il n’est pas question de faciliter les importations d’OGM en harmonisant les autorisations entre l’Amérique et l’UE. Les normes européennes doivent être absolument respectées, en revenant sur un principe de tolérance zéro des OGM non autorisés sur notre territoire.
Ces importations sont dues à notre déficit en matière de protéines végétales alors que nous sommes à même de le combler en développant la culture de plantes riches en protéines sur le territoire européen (féverole, luzerne, soja…), et ce, d’autant plus que ces cultures, intégrées dans des rotations, ont un impact très bénéfique sur le plan environnemental. Des projets sont en cours qui vont dans ce sens. La réforme de la politique agricole commune (PAC) doit également contribuer à la réalisation de cet objectif, pour notamment renforcer l’attractivité de ces cultures pour les agriculteurs.
Le gouvernement français soutient la recherche sur les modifications génétiques, notamment avec des partenariats publics privés comme Genius. Que pensez-vous de ces contrats et recherches ?
B. H. Soutenir la recherche est, et continuera d’être, l’une de mes priorités. Je souhaite que la France consolide une position d’excellence et soit réellement destinataire des 3% de PIB auxquels les gouvernements successifs passés se sont engagés, sans que ce pourcentage soit majoritairement consommé par le « crédit impôt recherche », lequel bénéficie beaucoup plus aux entreprises privées qu’à nos laboratoires de recherche publique. Concernant les organismes génétiquement modifiés, il conviendra d’améliorer les protocoles de leur évaluation sanitaire et environnementale, de sorte que les risques qu’ils présentent éventuellement sur le long terme soient mis à jour. Surtout, la recherche en matière d’agriculture biologique est trop peu soutenue, les équipes ne reçoivent pas assez de crédits et sont trop peu pourvues en personnel. Il est pourtant très important que la recherche agronomique française soit mieux orientée, vers une agriculture résiliente, peu consommatrice d’intrants, plus proche du fonctionnement des écosystèmes.
Je ne vois pas d’inconvénient à ce que des programmes de recherche fondamentale ayant vocation à produire de la connaissance soient financés par des partenariats publics-privés, car cette connaissance profite à tous sans exclusion.
En revanche, ceux qui seraient essentiellement destinés à l’élaboration d’applications commerciales pour le secteur privé doivent être essentiellement financés par des fonds privés. L’État ne sauraient investir des fonds publics dans des innovations qui deviendraient la propriété exclusive de tel ou tel opérateur privé.
Les entreprises développent actuellement des nouveaux OGM. Elles souhaitent que ces OGM ne soient pas soumis à la législation des plantes transgéniques. La société civile, elle, réclame que tout organisme dont l’ADN a été modifié en laboratoire soit considéré comme un OGM. Quelle est votre position sur ce sujet particulièrement sensible ?
B. H. Sur ce sujet, il convient de mieux poser le débat sur le plan de la biologie des plantes, très différente de la biologie animale. Le génome des plantes est en constante évolution, au contact de son environnement. Une « modification génétique » n’a donc pas la même signification et la même portée en biologie végétale qu’en biologie animale. Toutefois, il ne s’agit pas uniquement d’une question scientifique ; loin de là. La question de la régulation des modifications génétiques appliquées à nos plantes cultivées doit être traitée comme une question sociale et sa solution doit résulter d’un compromis de société.
Je serai donc très attentif à l’opinion de la société civile sur cette question, car j’estime qu’elle a, à tout le moins, le droit de savoir. Un étiquetage approprié doit donc constituer, sur ce sujet, une garantie minimale. Quant à l’évaluation de ces « nouveaux OGM », la Cour de Justice de l’Union européenne a été saisie récemment par le Conseil d’État. Sa décision sera décisive. En effet, il s’agit, au-delà de mes positions de candidat à l’élection présidentielle, d’une question qui doit être tranchée à l’échelle européenne.
Dans tous les cas, il ne me semble pas raisonnable de prétendre, comme cela a été avancé par certains, qu’il ne s’agit pas d’OGM, et de revendiquer, dans le même temps, des brevets sur ces inventions. Si des brevets sont déposés, ces inventions biotechnologiques devront être considérées comme des OGM et soumis à l’ensemble des obligations d’évaluation.
Les brevets sur le vivant sont-ils un outil de soutien à l’innovation agricole ou un frein à l’autonomie paysanne et une menace pour la diversité cultivée ?
B. H. Les brevets visent à garantir un monopole d’exploitation commerciale, pendant un temps limité, sur le résultat d’un effort d’innovation. Nous n’avons aucune certitude quant aux effets réels de ce régime de propriété intellectuelle sur l’innovation agricole, mais je n’ai rien contre ce principe. Toutefois, concernant le vivant, il convient que les textes limitant le champ d’application des brevets soient strictement respectés, car certaines choses ne doivent pas pouvoir être brevetées (le génome de l’être humain, par exemple, mais aussi les processus essentiellement biologiques et les produits de ces processus). De plus, les conditions d’attribution des brevets doivent être scrupuleusement examinées et appliquées, de sorte que, par exemple, il ne soit pas possible de déposer des brevets non réellement innovants sur des éléments existants du domaine public (« biopiraterie »). En ce sens, le domaine public doit être farouchement défendu, afin qu’il continue d’exister et de profiter à tous, aux côtés du domaine de la propriété privée.
Concernant les semences, ce point est d’une importance cruciale. En effet, il est capital que les agriculteurs puissent avoir accès à des variétés non protégées par brevet ou certificat d’obtention végétale, afin qu’ils puissent librement en reproduire les semences à la ferme. Pour cela, le système du « catalogue officiel » doit être réformé, afin que les variétés du domaine public ne répondant pas aux critères d’inscription au catalogue et aux critères, identiques, du certificat d’obtention végétale, puissent également être commercialisées.
Il n’est pas admissible que les agriculteurs puissent devenir totalement dépendants, pour leur choix de modèles de production, de quelques firmes détenant un quasi-monopole en matière de semences végétales. Le progrès ne peut être privatisé au service d’une seule logique de développement.
Ce qu’il convient de préserver, ainsi, n’est pas tant l’absence totale de variétés brevetées ou protégées par COV sur le marché, mais plutôt un large choix de variétés pour les agriculteurs, qui pourront alors prendre leurs responsabilités relativement à leur autonomie et à la diversité cultivée.
Les semences paysannes ont un avenir en France et en Europe ? Si oui, que proposez-vous pour les encourager ?
B. H. L’expression de « semences paysannes » est ambiguë. S’agit-il de « variétés paysannes », c’est- à-dire de variétés traditionnellement utilisées, jadis ou plus récemment, par les paysans, lesquelles sont libres de droit et donc juridiquement reproductibles à la ferme ? Ou bien s’agit-il de « semences de ferme », c’est-à-dire de semences reproduites sur une exploitation agricole à l’issue d’une campagne de culture, mais issues de variétés protégées par un certificat d’obtention végétale ou un brevet ?
S’il s’agit de « variétés paysannes », je suis d’avis qu’elles devraient être autorisées à la vente, moyennant, ainsi qu’il est indiqué ci-avant, une réforme de la législation sur le commerce des semences et le système du « catalogue officiel ». Une dérogation à l’obligation d’inscription pourrait être envisagée les concernant, à condition que des standards de qualité des lots de semences soient toutefois respectés.
S’il s’agit de « semences de ferme », elles ne sont légitimes, à mon sens, que tant que les variétés protégées par des régimes de propriété intellectuelle sont les seules (ou presque les seules, car une gamme très pauvre ne représente pas véritablement une faculté de choix) à pouvoir exister légalement sur le marché. Si les agriculteurs, toutefois, avaient le choix entre variétés libres de droit et variétés protégées, il conviendrait alors que la protection conférée par le certificat d’obtention végétale ou le brevet soit respectée.
Sur le plan de la diversité biologique, je ne crois pas que les « semences de ferme » représentent une panacée. Il n’y a pas d’avantage réel à multiplier des semences très homogènes et très pauvres génétiquement. Sur ce point, je crois beaucoup plus à la réhabilitation des variétés populations, beaucoup plus riches génétiquement, peu homogènes, mais qui peuvent être rendues plus productives dans le cadre, par exemple, de programmes de sélection participative entre agriculteurs et laboratoires de recherche publique.