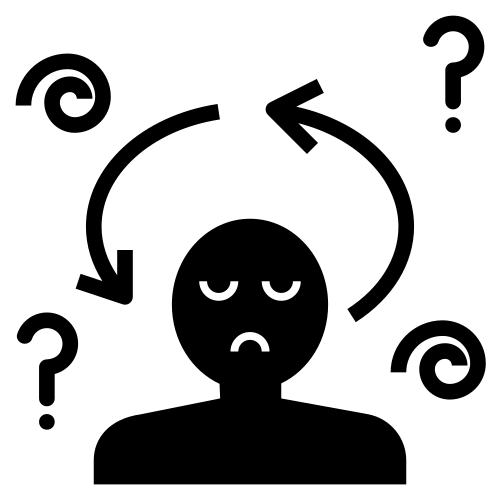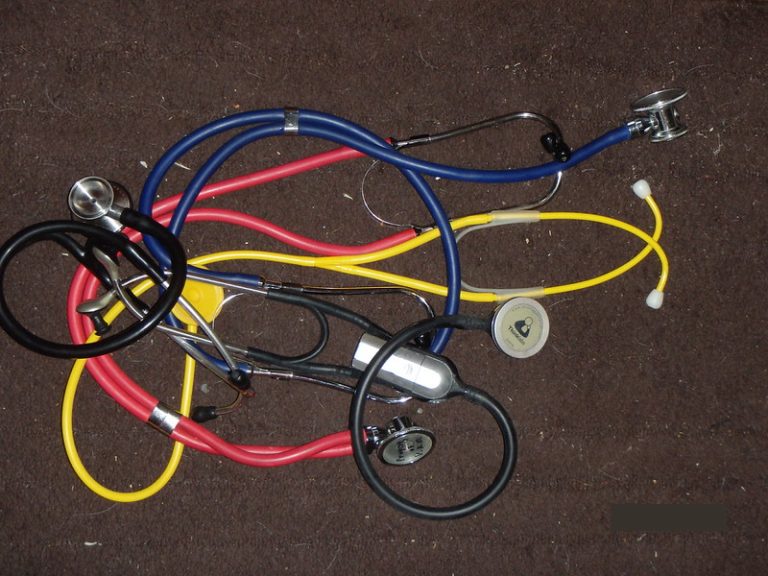Nanotechnologies dans les champs : rien de neuf depuis vingt ans ?
Les brevets impliquant l’utilisation de nanos* en agriculture se sont multipliés en 20 ans. Cependant, aucune amélioration n’est intervenue pendant ce temps concernant la disponibilité des informations dans ce domaine. Un rapport récent, demandé par AVICENN et publié par l’agence européenne des produits chimiques (ECHA), vient re-souligner la nécessité de changer la réglementation européenne afin de mieux identifier, évaluer et encadrer les nanos dans les champs et l’alimentation. AVICENN réclame davantage de transparence sur la commercialisation et les risques des nanomatériaux utilisés en agriculture depuis longtempsi.

En novembre 2004, au Canada, le collectif d’experts-militants ETC Group publiait « La ferme atomisée »ii, un rapport aussi documenté que détonant, traitant de l’essor et de l’impact des nanotechnologies développées pour l’agriculture et l’alimentation. Parmi ses recommandations figurait l’interdiction de la dissémination dans l’environnement des intrants agricoles contenant des nanos (qu’il s’agisse de pesticides, d’engrais et de produits de traitement des sols) dont l’innocuité n’est pas établie. Ce qui nécessitait, de facto, la création de nouvelles dispositions réglementaires rendant obligatoires l’évaluation spécifique des risques de ces nouveaux produits. Produits pour lesquels quelques brevets avaient déjà commencé, à l’époque, à être déposés par BASF, Bayer, Monsanto, Syngenta, etc.
En 2024, quasiment aucune donnée n’est disponible publiquement
Vingt ans plus tard, on dénombre désormais plus de 1 000 brevetsiii sur l’utilisation de nanos dans le domaine de l’agriculture et les articles scientifiques sur le sujet se comptent par centaines. Mais aucune disposition réglementaire spécifique n’a été déployée. En novembre 2024, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié un rapportiv, dont les conclusions, moins radicales à première vue que le rapport d’ETC Group qui avait 20 ans, rejoignent finalement les préconisations de cette ONG.
Avant de les détailler, soulignons que le rapport publié par l’ECHA n’a pas été rédigé par une ONG écologiste mais par une société italienne, Innovamol, spécialisée dans l’analyse et la synthèse de données scientifiques via l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (machine-learning ML).
Sur la base de près de 11 000 documents recensés, 3 052 documents ont été jugés pertinents. 1 872 ont finalement été sélectionnés et analysés en détail (des articles scientifiques pour la plupart, mais aussi 140 brevets, quelques livres, thèses, rapports institutionnels, pages web, tribunes, etc.). 75 contributions ont également été collectées dans le cadre d’une consultation lancée par Innovamol à laquelle une soixantaine de chercheurs ont participé (cinq fabricants de produits chimiques, quatre représentants d’agences réglementaires et six ONG, dont notre association AVICENN, à l’initiative de cette démarchev).
Parmi les substances les plus communément citées dans la littérature scientifique pour des applications en agriculture, ressortent des nanoparticules métalliques (argent, zinc, cuivre, fer), de silice, des nanoparticules de polymère et hybridesvi, des nanoparticules carbonéesvii, des nanoparticules de chitosane, etc.
Innovamol rapporte aussi les avantages (escomptés) de l’utilisation des nanotechnologies en agriculture, parmi lesquelles des améliorations :
- des propriétés antifongiques (pour les nanoparticules de cuivre ou d’oxydes de zinc par exemple),
- de la résistance aux maladies (pour les nanoparticules de silice notamment),
- de l’absorption des nutriments (pour les nanoparticules de fer et de zinc),
- des mécanismes de libération contrôlée des produits agrochimiques (des nanovecteurs sont conçus pour prolonger le relargage des nutriments et des pesticides, à des doses plus faibles et prétendument plus efficaces et moins néfastes sur le reste de l’environnement),
- de la défense des plantes (meilleures réponse au stress et résistance aux agents pathogènes par l’induction, via les nanoparticules, d’activités enzymatiques antioxydantes et d’un renforcement de l’intégrité des parois cellulaires),
- de la biodégradabilité de certains composants (avec le recours à des nanocomposites biodégradables).
L’intérêt du rapport est qu’il pointe également les nombreuses lacunes en termes de connaissances concernant tant la commercialisation et l’utilisation des nanos dans le domaine agricole, que l’exposition humaine et environnementale et les dangers associés. Il souligne aussi que la réglementation européenne existante, en particulier, ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les nanos dans les pesticides ou les engrais. Le règlement (EU) n°528/2012 rend certes obligatoire l’étiquetage (nano) des nanomatériaux dans les produits biocides, ainsi qu’une évaluation des risques préalable à la mise sur le marché… mais il ne s’applique pas aux produits agricoles, couverts par les règlements (CE) n°1107/2009 sur les produits phytopharmaceutiques et n°2019/1009 sur les produits fertilisants, qui ne font pas cas de la taille des particules utilisées dans les pesticides et les engrais (et ce, que ce soit concernant les substances actives ou leurs adjuvants). Concrètement, ne pas prendre en compte la taille de la molécule dans le règlement revient à ignorer cette question et à se baser sur des évaluations de la substance « bulk » (de base), qui est dans la plupart des cas moins réactive et donc moins toxique que la même substance d’échelle nano. C’est ce qui s’est passé avec le règlement européen REACH : pendant des années, l’industrie et les autorités européennes ont clamé que ce règlement s’appliquait par défaut aux nanos. Mais quand l’ECHA a demandé aux industriels des données précises sur les « nanoformes » de leurs substances chimiques, les industries ont contesté ces demandes auprès du Bureau des appels de l’ECHA, qui leur a donné raison, juridiquement parlant, dans la mesure où il n’y avait pas de définition du terme « nanoforme ». Il a fallu encore plusieurs années pour obtenir, via une révision des annexes de REACH, qu’une définition soit précisée et que des données supplémentaires et une évaluation nano-spécifique puisse être exigée des industriels. Bref, plus de 10 ans de perdus ! Et cela sans compter que la définition adoptée est très insatisfaisante et laisse passer plein de nanos à travers les mailles du filet…
Un nanomètre = 10-9 mètre = 0,000 000 001 m = 1 milliardième de mètre
Lorsque les substances chimiques sont utilisées à cette taille, des propriétés « extraordinaires » (au sens propre du terme) apparaissent : soit des propriétés nouvelles, soit des propriétés exacerbées par rapport aux substances de taille classique (micro- ou macroscopique). Ces propriétés sont dues à la plus forte proportion d’atomes en surface (par rapport au volume) que pour les substances utilisées à une échelle plus grand : il y a davantage d’échanges et d’interactions leur environnement. Si l’on ajoute à cela que les nanos, du fait de leur petite taille (de l’ordre d’un virus ou du diamètre de l’ADN) traversent plus aisément les barrières physiologiques et se faufilent dans tous les compartiments environnementaux, avec à la clé une contamination diffuse et généralisée…
A quand un changement ?
Les recommandations du rapport méritent à cet égard d’être relayées, car elles sont très pertinentes :
- mettre à jour la législation européenne afin d’intégrer une définition et des dispositions spécifiques pour les nanomatériaux dans les règlements sur les produits phytopharmaceutiques et les fertilisants ;
- établir un cadre pour des instructions d’utilisation normalisées ;
- créer une base de données des nanos utilisés dans l’agriculture de l’UE et mettre en place un système de notification obligatoire pour les fabricants ;
- demander des analyses documentaires systématiques et des tests obligatoires de toxicité et d’écotoxicité pour étayer les allégations d’efficacité et permettre aux pouvoirs publics de remplir leurs missions.
Et maintenant ? Qu’adviendra-t-il de ces recommandations ? L’ECHA et les autorités publiques s’en empareront-elles ? Au niveau français, AVICENN a demandé à l’Agence française de sécurité sanitaire (Anses) que la société Innovamol soit invitée à présenter ce travail au « comité de dialogue nanomatériaux » réuni par l’Ansesviii. Cette agence a en effet initié, en 2016, une enquête auprès des fabricants et utilisateurs de pesticides et engrais, avant de lancer, en 2018, des tests sur des produits phytopharmaceutiques dont les résultats ne sont toujours pas publics. Et pourtant, voilà dix ans que, chaque année, l’agriculture arrive en tête des secteurs d’utilisation des nanos déclarées dans le registre r-nanoix géré par l’Anses ! Malgré l’objectif initial de ce registre – renforcer la traçabilité et l’information du public et contribuer à l’évaluation du risque -, aucun détail sur les caractéristiques, localisations et risques des nanos concernés n’est disponible publiquement.
Lassée d’attendre que les réponses à nos questions viennent d’en haut, AVICENN a tenté à plusieurs reprises de déposer des dossiers de demandes de financements pour travailler avec des chercheurs sur l’identification et l’évaluation de risques de nanomatériaux dans les produits phytosanitaires, notamment auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR). Mais notre projet n’a pas été retenu, au motif que l’accès au registre r-nano ne nous est pas autorisé (ni à AVICENN, ni aux chercheurs… qui travaillent pourtant pour des organismes de recherche publicsx). Le comité de sélection de l’ANR s’est dit « convaincu de la qualité de la question scientifique », mais pas par la « faisabilité du projet » dans la mesure où « la disponibilité des informations sur les produits n’est pas assurée ».
Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que les données sur les nanos contenus dans les produits phytos soient enfin exigées des fabricants et rendues disponibles, afin de rendre possible l’évaluation des risques qui y sont associés, pour les humains comme pour l’environnement ?
| * Le terme nanos renvoie ici aux substances actives de taille nanométrique (également rencontrées sous le vocable « nanoparticules » ou « nanomatériaux ») ainsi qu’aux nano-encapsulations et nano-vecteurs conçus pour les protéger et les acheminer dans les plantes. Il n’englobe pas les « nanotechnologies » contenues, par exemple, dans les capteurs utilisés dans l’agriculture dite « de précision », ou « agritech ». La terminologie autour du terme « nano » et de ses dérivés fait l’objet de débats d’experts et de négociations en cours au niveau européen, qui dépassent le seul secteur agricole. L’Anses et AVICENN en France, le BEUC, Foodwatch et les députés au niveau européen, ont contribué à empêcher l’adoption d’une mauvaise définition, en 2024, dans le règlement sur les nouveaux alimentsxi. Dans les mois qui viennent, c’est dans le domaine des cosmétiques que se porteront les débats sémantiques et réglementaires. |
i Voir l’entretien de Christophe NOISETTE avec AVICENN :
Christophe Noisette, « Des nanos en agriculture ? », Inf’OGM, le journal, n°142, septembre/octobre 2016.
ii ETC Group, « La Ferme Atomisée », 29 novembre 2004.
iii Wang, D., Saleh, N.B., Byro, A. et al., « Nano-enabled pesticides for sustainable agriculture and global food security », Nat. Nanotechnol. n°17, p.347–360, 2022.
iv Daniele Urbani et al., « Collection and review of information on nanomaterial-based and nanoenabled plant protection products, biocidal products and fertilising products », Innovamol, 17 mai 2024.
v Ce rapport a en effet été réalisé suite à la proposition que nous avions faite, mi-2022, à l’Observatoire européen des nanomatériaux (EUON), rattaché à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), afin que soit réalisée une revue de la littérature scientifique sur les pesticides et les engrais. Notre proposition, soutenue par d’autres ONG européennes (Center for International Environmental Law (CIEL), ClientEarth, European Environmental Bureau and Health and Environment Alliance (HEAL)), a été acceptée par l’ECHA en septembre 2022. Le bureau d’études italien Innovamol a ensuite été sélectionné, en 2023, pour réaliser cette revue de littérature et formuler des préconisations dans ce rapport, qui a été finalisé et envoyé en mai 2024 à l’ECHA, et publié par cette dernière six mois plus tard, en novembre dernier.
vi type Polycaprolactone : PCL, polylactic-co-glycolic acid : PLGA
vii oxyde de graphène, carbon dots, nanotubes de carbone multiparois
viii Cette instance de dialogue ouverte aux ONG (dont AVICENN, FNE,…), syndicats et fédérations professionnelles, se réunit deux fois par an à l’Anses (avec, depuis peu, des représentants de la MSA et de Phyteis).
ix Depuis 2013, le dispositif R-Nano est alimenté par les déclarations obligatoires portant sur les quantités annuelles de substances à l’état nanoparticulaire produites, importées ou distribuées en France. Ce dispositif est piloté par le Ministère de la Transition écologique et géré par l’Anses.
x Précisons qu’AVICENN travaille à faire sauter ce verrou.
xi AVICENN, « Définition des nanomatériaux dans l’alimentation : les députés européens ont dit non au projet de Commission », 24 avril 2024.