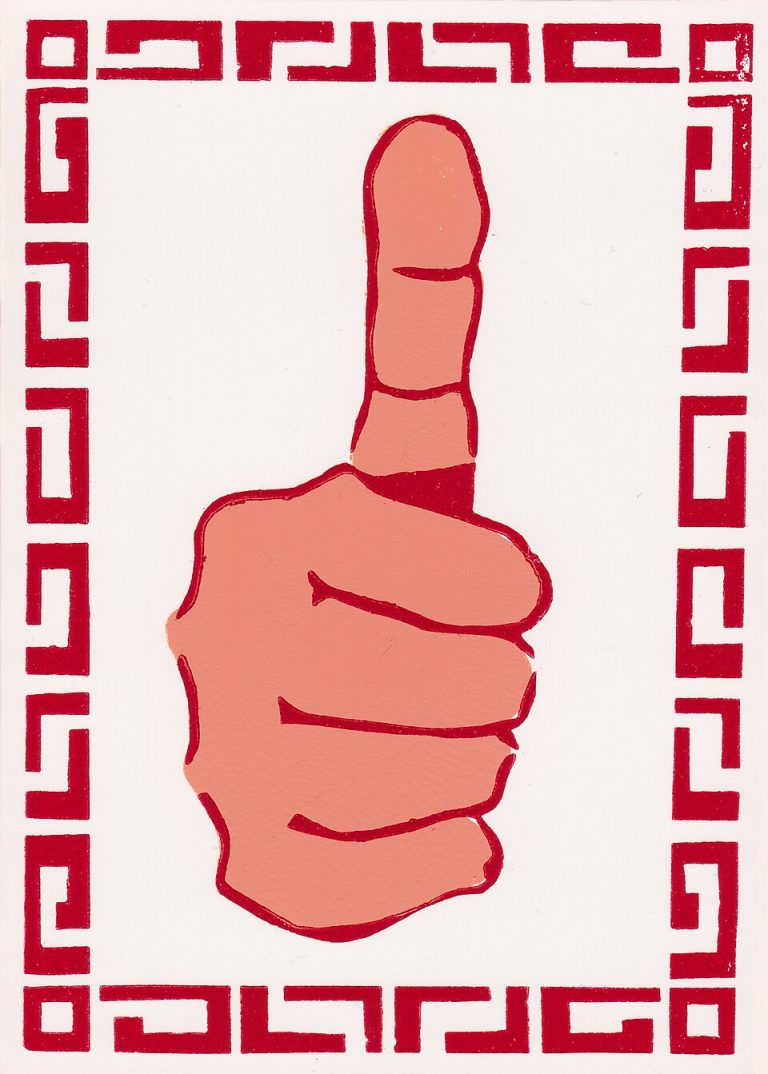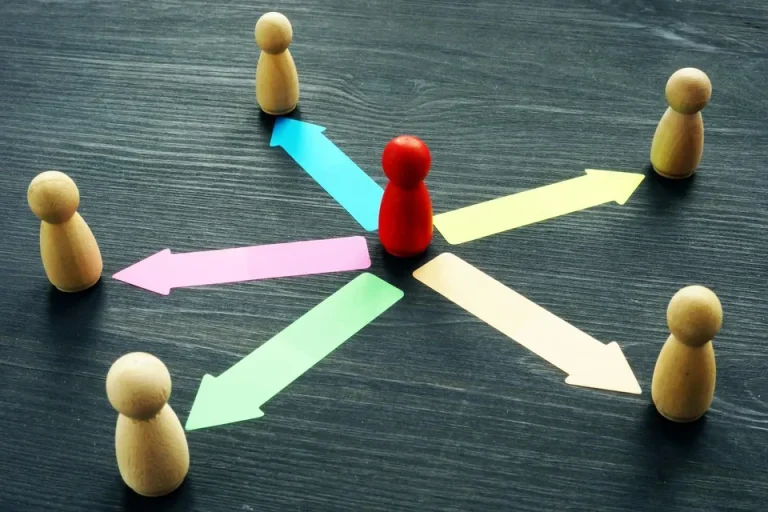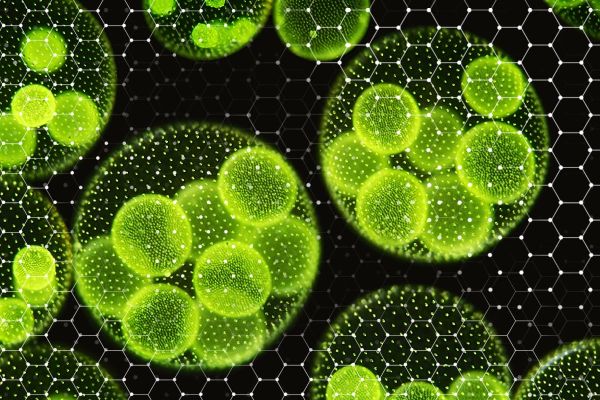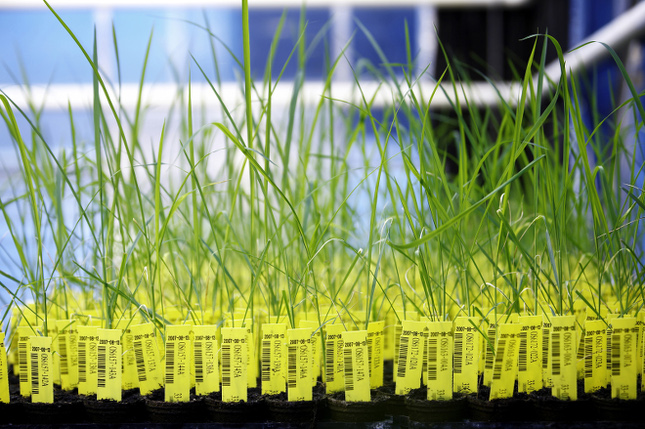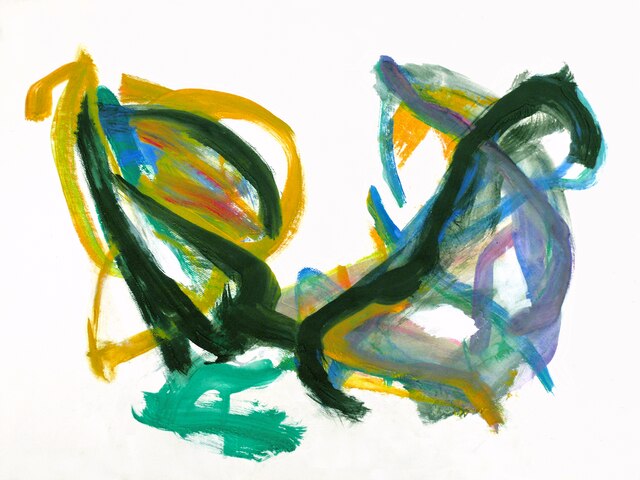Actualités
L’Union européenne discute sa définition d’un OGM
Fin 2024, les Pays-Bas ont initié un travail de réflexion sur le sens à donner à la définition légale d’un OGM, en discutant la définition mot par mot, expression par expression. Exercice purement intellectuel ? Loin de là ! Le fruit de ce travail pourrait modifier la lecture de la définition d’un OGM… sans changer la dite définition. Le résultat escompté de ces réflexions est, bien entendu, un allègement du cadre réglementaire.
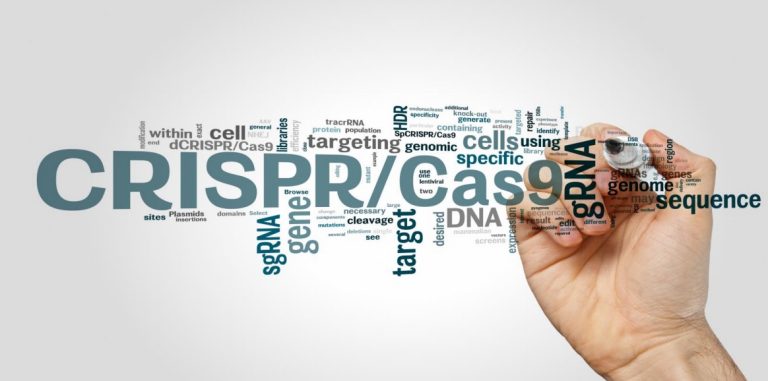
Les fronts ouverts contre la réglementation européenne actuelle des OGM sont multiples. La Commission européenne a ainsi proposé, en juillet 2023, la déréglementation d’un grand nombre d’entre eux. En 2025, elle pourrait proposer une « loi biotechnologie » qui viserait à simplifier les cadres réglementaires existantsi. Mais ces projets ne sont pas les seules dynamiques en cours. Si Inf’OGM a déjà listé les différents chantiers législatifs ouverts par la Commission européenne depuis 2023ii, un nouveau sujet, plus inattendu, a été mis sur la table de l’Union européenne le 11 décembre 2024.
La sémantique comme enjeu politique
En décembre 2024, à Bruxelles, s’est tenue une réunion du Comité réglementaire de la directive 2001/18 réunissant des représentants des États membres de l’Union européenneiii. A cette occasion, les Pays-Bas ont présenté une étude sur les interprétations données par chaque État de la définition actuelle d’un OGM, y compris un micro-organisme GM (MGM). Les éléments de définition sont donnés par deux textes législatifs européens : la directive 2001/18 et la directive 2009/41.
La directive 2001/18 définit un organisme comme « toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ». De là, un OGM est « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ».
Concernant les MGM, la directive 2009/41 établit qu’un micro-organisme est « toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ». Un MGM est, lui, définit comme « un micro-organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ».
De sa propre initiative, le gouvernement des Pays-Bas a commandé à un prestataire privé, Perseus, un rapport sur l’interprétation de cette définition par les États membres. Le fruit de cette étude a donc été présenté aux États membres le 11 décembre 2024, puis publié en ligne le 20 janvier 2025iv. Selon le compte-rendu du 11 décembre 2024, Perseus a identifié « certains défis liés notamment aux nouveaux développements techniques et scientifiques ». Sur cette base, les Pays-Bas considèrent que des discussions doivent être engagées au niveau européen. L’objectif de ces discussions serait « d’échanger les points de vue et aligner les approches adoptées lors de la mise en œuvre de la définition d’un OGM ». Le même compte-rendu de réunion indique que cette proposition néerlandaise a reçu le soutien de « certains États membres », sans préciser lesquels. Le cas échéant, le comité réglementaire de la directive 2001/18 sera le lieu de ces discussions, selon les propos de la Commission européenne.
Mot par mot, expression par expression
Le cabinet Perseus, pour mener son étude, a notamment reçu les contributions de 17 États membres, qui ont donc répondu sur l’interprétation qu’ils donnent aux définitions d’un OGM et d’un MGM. Ces États membres sont : la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, la Lettonie, la Roumanie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède. Sans rentrer dans un commentaire analytique, Inf’OGM rend ici compte des réponses reçues sur quelques termes des deux définitions.
Le terme « matériel génétique », présent dans les deux définitions, concerne évidemment les ADN et ARN, mais « pourrait également concerner d’autres molécules [NDLR : sans précision desquelles], même les molécules synthétiques ». Inclusion potentielle importante, notamment dans le domaine vaccinal ou le traitement de plantes, « l’injection de petit ARN interférent ou d’ARN messager » dans le corps d’un hôte (humain ou pas) pourrait ne pas être considéré comme un transfert de matériel génétique, ne résultant donc pas en un OGM.
L’expression « a été modifié » fait l’objet de deux interprétations différentes, aux enjeux assez clairs. Pour certains des répondants, elle implique que tous les descendants d’un OGM sont également des OGM. Mais d’autres ont considéré, à l’inverse, que la descendance peut être considérée comme non-OGM.
Une des expressions importantes des deux définitions est « d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement ». Le cabinet Perseus rapporte ici avoir observé deux lectures différentes de cette expression. Une première estime qu’elle se réfère à « la technique qui est [intrinsèquement] différente d’une manière naturelle de croisement ou de recombinaison ». La seconde affirme que la modification obtenue ne pourrait pas être obtenue naturellement ou par recombinaison. Ces deux lectures sont considérées comme possibles par les États ayant répondu.
Les êtres humains peuvent-ils être des OGM ?
Il n’est pas erroné d’affirmer que, depuis 2001, les êtres humains ne peuvent pas être légalement considérés comme des OGM, la définition paraissant assez claire sur ce point. De là découlerait la compréhension que les êtres humains ne peuvent faire l’objet de modifications génétiques. Mais les réponses reçues sur ce point sont pour le moins étonnantes. Le rapport établit en effet que plusieurs États ont répondu que des cellules et des tissus humains peuvent être considérés comme OGM si modifiés génétiquement. Une des explications fournies est que les cellules humaines, comme les tissus humains, ne sont pas des « êtres humains » à proprement parler.
Des cas concrets ont également été présentés aux États membres, impliquant notamment différentes bactéries ou virus génétiquement modifiés. S’agissant de micro-organismes, Inf’OGM reviendra plus en avant sur ces cas dans un prochain article. Le travail d’interprétation sémantique de ces définitions – OGM et micro-organismes – pourrait donc s’engager dans l’année. Les résultats de ce travail pourraient être déterminants, puisqu’ils concernent la législation actuelle sur les OGM et la proposition de déréglementation en cours de discussion. Avec, en point de mire, une éventuelle nouvelle interprétation permettant d’alimenter la volonté politique en cours d’alléger le cadre réglementaire sur les biotechnologies.
i Denis Meshaka, « La Commission européenne veut sa « révolution biotech » », Inf’OGM, 11 février 2025.
ii Eric Meunier, « Les chantiers législatifs de la Commission européenne sur le vivant », Inf’OGM, 7 novembre 2024.
iii Commission européenne, DG SANTÉ, « Regulatory Committee 2001/18/EC », 11 décembre 2024.
iv Government of the Netherlands, « Interpretation of the GMO definition in EU Member States », 20 janvier 2025.