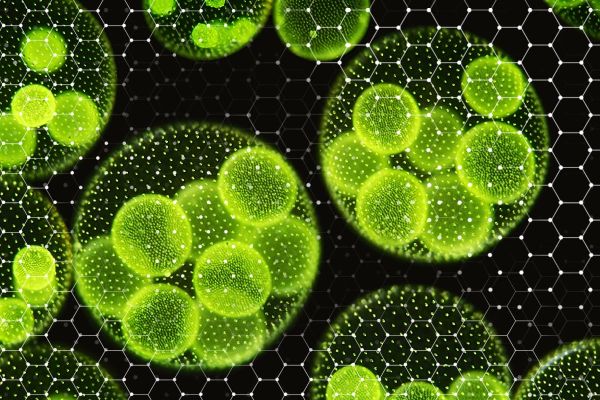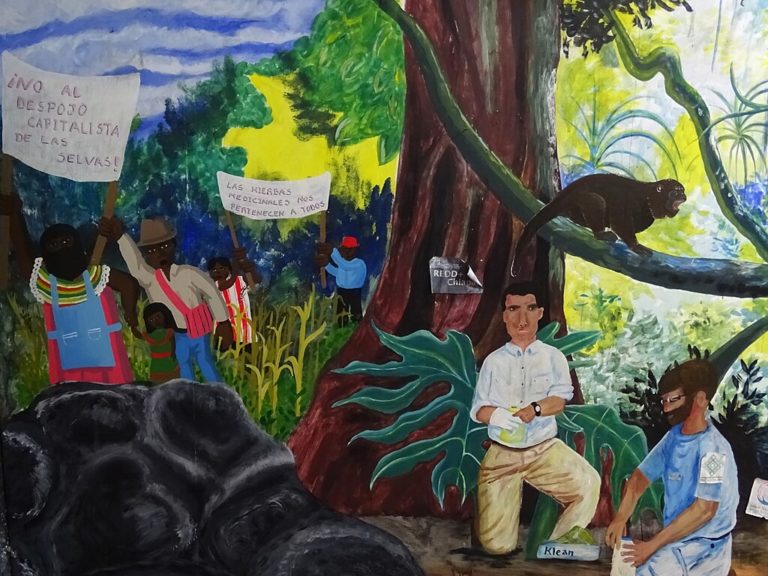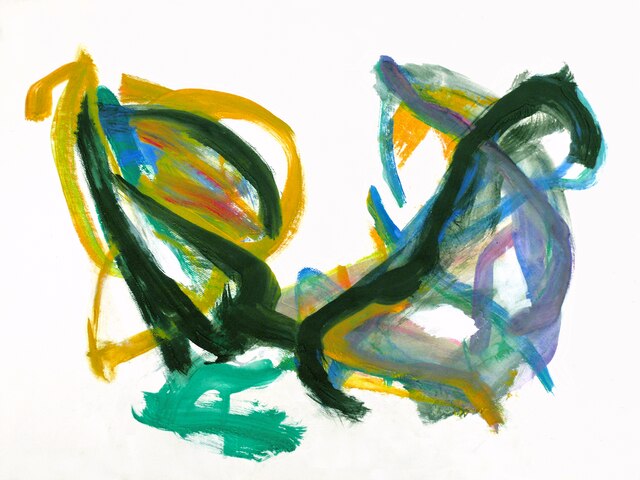Actualités
Le Brésil sera-t-il un pays sans OGM ?
Jusqu’à présent le Brésil a été un pays où la culture des plantes transgéniques était interdite. Certes, en 2000, la CNT Bio ( Commission nationale des biotechnologies) avait autorisé les cultures transgéniques, mais la justice, saisie par l’Institut de défense des consommateurs (IDEC), avait bloqué cette autorisation en arguant du manque d’études préalables d’impact sur l’environnement et la santé. En réalité, le soja transgénique, le soja RR de Monsanto résistant au glyphosate, a été cultivé illégalement à partir de semences importées en contrebande d’Argentine où les OGM sont autorisés. L’Etat du Rio Grande do Sul (RGS), frontalier avec l’Argentine, est la principale zone où les OGM ont été cultivés. A son arrivée au pouvoir en 2003, le gouvernement Lula a constaté cet état de fait et a pris en mars une Mesure Provisoire (MP 113) pour autoriser la vente de la récolte de soja 2002-2003, partiellement transgénique et illégale, mais prévoyant le retour à la légalité pour la campagne suivante. En octobre 2003, au moment du semis, une nouvelle Mesure Provisoire (MP 131) autorisant la culture des transgéniques pour la campagne 2003-2004 a jeté le trouble. Cette mesure a été aussitôt attaquée, comme étant anticonstitutionnelle. Il en résulte une grande confusion en attendant une loi sur les semences qui devrait sortir avant la fin novembre 2003. L’affrontement des pro et anti OGM se joue à trois niveaux : au niveau de la société, au niveau judiciaire et au niveau politique.
1)La bataille au niveau de la société.
Les producteurs de soja, surtout sur les grandes propriétés, ont trouvé un avantage à cultiver du soja résistant au glyphosate : moins de travail, et diminution des coûts de production (1). Il y a donc une pression très forte des producteurs de soja, surtout au Rio Grande do Sul (RGS), pour demander la légalisation des transgéniques, avec manifestations et lobbying politique. Leur poids politique est d’autant plus fort qu’ils alimentent les exportations brésiliennes.
La campagne « pour un Brésil sans transgéniques » mobilise à l’inverse les mouvements d’agriculture familiale et d’agriculture agro-écologique, les écologistes et les consommateurs. La CONTAG, confédération nationale des travailleurs de l’agriculture, principal syndicat paysan, présent dans les 27 Etats du Brésil, est également hostile à la mise en cultures des OGM dans tous les Etats, à l’exception du RGS. Depuis septembre et pendant le temps que durera le débat sur la loi, au moins jusqu’à fin novembre, environ 500 militants du MST (Mouvement des Sans Terre) et de la campagne « pour un Brésil sans transgéniques » campent, par roulement, à Brasilia, et multiplient les actions.
Il faut aussi constater des différences d’approche significatives entre Etats. A l’opposé du RGS, l’Etat du Parana, par la voix de son gouverneur, a annoncé que son territoire serait libre d’OGM et que dans son grand port de Paranagua, ne pourraient transiter que des sojas non transgéniques.
Quant à la recherche agronomique brésilienne (EMBRAPA), elle a amélioré les variétes de soja cultivés au Brésil, et veut rester propriétaire de ce matériel génétique. Elle accepte un partenariat avec Monsanto pour disposer de variétés RR adaptées à son climat, veut bien en payer le coût, mais sans brevet sur la semence pour que les agriculteurs puissent réutiliser leur production comme semence.
Le débat a lieu aussi sur le terrain économique. Parmi les trois grands pays exportateurs de soja, USA, Brésil et Argentine, seul le Brésil n’a pas autorisé les cultures transgéniques. Et cela semble lui avoir réussi : les rendements ont progressé, ainsi que les surfaces cultivées et les quantités exportées, au point de dépasser les USA. D’autres font remarquer que les rendements et la production ont augmenté aussi vite en Argentine(2).
2)La bataille judiciaire.
Le Ministère public est une instance judiciaire originale prévue dans la Constitution du Brésil. Il est autonome et a pour mission de défendre les citoyens. A la demande de Greenpeace Brésil et de l’Institut de défense des consommateurs (IDEC), c’est le ministère public fédéral qui a instruit le recours contre l’autorisation des OGM par la CNT Bio en 2000 : manque d’études d’impact car on ne pouvait se satisfaire de celles faites aux USA et absence d’étiquetage, lequel est prévu mais non appliqué. Le juge fédéral a suivi le ministère public en interdisant le soja RR et en demandant pour toute autorisation des études d’impact préalables.
Les pro OGM ont fait appel une première fois : le jugement en appel (3 juges) a confirmé le jugement précédent. C’est à ce moment que la FARSUL (Fédération de l’agriculture patronale au RGS), en opposition politique au gouverneur PT (parti des travailleurs) qui voulait faire du RGS un Etat sans OGM, a fait le choix de la désobéissance civile en organisant la contrebande pour diffuser des semences transgéniques, avec la complicité de Monsanto et le laisser faire du gouvernement fédéral. Le Ministère public a fait faire des enquêtes policières et fait condamner des agriculteurs pour trois motifs : contrebande, utilisation de semences interdites, utilisation de glyphosate dans des conditions non autorisées (dans la réglementation brésilienne actuelle, un désherbant systémique ne peut être utilisé directement sur le feuillage de la plante cultivée, mais seulement sur l’interligne). Le juge a demandé au ministère fédéral de l’agriculture de faire des contrôles, mais en vain, le ministère de l’agriculture préférant laisser faire, étant lui-même favorable aux OGM. Le ministère public a fini par abandonner les poursuites, à cause de l’impossibilité de poursuivre tous les agriculteurs du RGS en infraction.
Les pro-OGM ont fait appel une deuxième fois en 2003. Un premier juge a donné un avis contraire, en août, en faveur de l’autorisation des trangéniques. Un deuxième juge a confirmé en septembre la position antérieure, pas d’autorisation sans études préalables. En attendant la décision du troisième juge, c’est la décision antérieure qui s’applique, c’est-à-dire l’interdiction du soja transgénique.
Le ministère public a également examiné les Mesures Provisoires (MP) du gouvernement Lula. La première, en mars 2003, a autorisé la vente du soja transgénique, cultivé illégalement. Pour le Ministère public, il était difficile d’accepter cette MP, mais, comme elle prévoyait le retour au cadre légal pour la campagne suivante, le ministère a décidé de ne pas intenter d’action contre cette MP. Avec la deuxième MP, celle du 25 septembre qui autorise la culture de soja RR pour la prochaine campagne, le ministère public ne peut plus laisser le bénéfice du doute au gouvernement. Pour le Procureur général de la République, cette MP est anticonstitutionnelle pour plusieurs raisons : pas d’urgence puisque la loi sur les semences est prévue pour novembre, toujours pas d’études d’impact, défaut d’application d’une décision de justice qui n’autorise pas les cultures OGM, incohérence avec la première mesure provisoire qui annonçait le retour à une situation conforme au droit.
Comme on le voit, la bataille juridique est loin d’être terminée. La loi sur les semences devra aussi déterminer à quel niveau se prennent les décisions concernant les transgéniques : est-ce du ressort de la CNT Bio, comme actuellement, ou du pouvoir politique ?
3)La bataille politique.
Dans son programme électoral, le Parti des Travailleurs (PT) prévoyait un moratoire sur les OGM et la nécessité de faire des études d’impact. C’est la raison pour laquelle la première MP et encore plus la seconde ont provoqué un véritable malaise dans les rangs du PT. Certains démissionnent du parti, comme le député Fernando Gabeira. Le sénateur Joao Capiberibe, du PSB (parti socialiste), abandonne la vice présidence du groupe pro-gouvernemental au Sénat. Incontestablement, le gouvernement avait sous estimé les effets d’une telle décision. Il semble bien que Lula, qui ne dispose pas d’une majorité présidentielle au Sénat et à la Chambre des députés, avait monnayé le soutien des députés du RGS pour la réforme sur les retraites en échange de la libéralisation des transgéniques.
Le gouvernement est lui-même divisé. Le principal apôtre pour l’autorisation des OGM est le ministre de l’agriculture, Roberto Rodrigues, qui reflète le point de vue des grands agro-exportateurs. A l’opposé, le ministre du développement agraire (réforme agraire et agriculture familiale), Roberto Rossetto, comme sa collègue ministre de l’Environnement, Marina Silva, plaident pour un moratoire. Celle ci a imposé que dans la mesure provisoire autorisant les transgéniques pour la prochaine campagne il soit fait obligation aux agriculteurs d’assumer les éventuels dommages à l’environnement ou la santé.
A l’initiative du sénateur Capiberibe, une commission d’enquête parlementaire est demandée pour faire la lumière sur les responsabilités dans la diffusion de semences illégales, particulièrement au RGS. Des parlementaires se sont associés à l’action intentée en justice par des représentants de la société civile, la CONTAG et le MST pour faire reconnaître la Mesure Provisoire comme anticonstitutionnelle.
Le Brésil se prépare à apporter sa signature au protocole de Carthagène sur la biodiversité, qui est entré en vigueur le 11 septembre, après que 50 pays l’aient déjà signé. Ce protocole garantit aux pays l’accès aux données nécessaires pour effectuer des choix informés en matière d’OGM dits « vivants » et le libre choix d’accepter ou de refuser tout mouvement transfrontière d’OGM qui leur est destiné.
C’est dans ce contexte que la loi sur les semences va venir en discussion devant les députés prochainement. Il n’est pas certain qu’elle parvienne à dégager un consensus, tant les positions sont divergentes. De plus, quelle que soit la loi, encore faut-il avoir les moyens de la faire respecter…. ce qui explique que certains parlementaires veulent profiter de ce cas d’école pour faire avancer l’état de droit au Brésil.
(1)Il est probable que ce gain ne sera que de court terme, avant l’apparition de mauvaises herbes résistantes et avant de devoir à payer les royalties à Monsanto. En effet, aussitôt la Mesure Provisoire (MP 131) édictée le 25 septembre, Monsanto a annoncé que les agriculteurs qui vendent à l’export devraient payer la technologie.
A signaler l’étude de Victor Pelaz, professeur d’économie à l’Université Fédérale du Parana, sur la compétitivité comparée du soja conventionnel et du soja transgénique résistant au glyphosate, à partir de données récoltées aux USA, Brésil et Argentine : les coûts de production sont abaissés dans une fourchette de 0 à 19 %, la productivité baisse jusqu’à 12 %, et la quantité d’herbicides varie de -29 à + 108 %. Au total, avec le coût de la technologie, c’est-à-dire les royalties à payer à Monsanto, c’est plutôt une perte de compétitivité.
(2) La production brésilienne est passée de 23 millions de tonnes en 1995 à 52 MT en 2003 et les rendements moyens de 22 à 28 qx par ha. Les exportations de graines ont été en 2002 de 9,2 MT vers l’Europe, 4,2 vers la Chine et 0,7 vers le Japon. Il faut y ajouter les exportations de tourteaux de 9,3 MT vers l’Europe. La Chine exige une certification et la moitié du soja brésilien entrant en France est soit du soja tracé non OGM, soit du soja non tracé mais déclaré non OGM au résultat de l’analyse PCR.