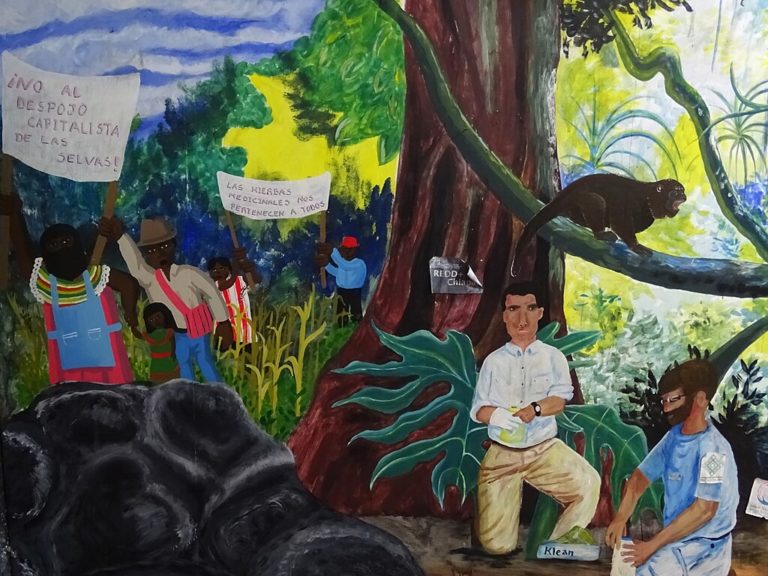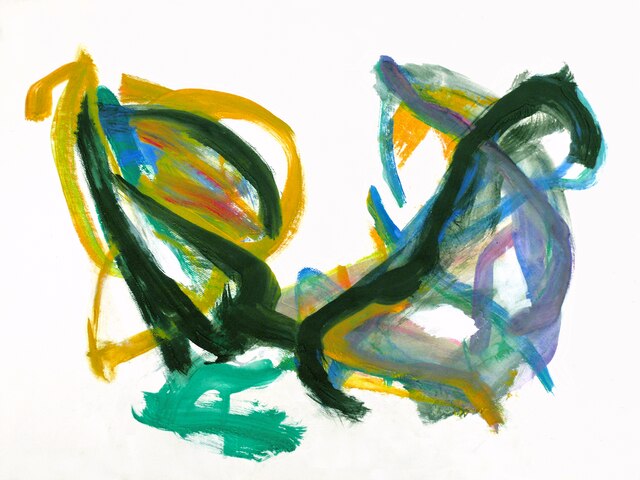Actualités
Veille juridique Inf’OGM du 2 au 9 mai 2023
FRANCE
•Assemblée nationale
Réponse à une question parlementaire : bilan de l’interdiction des néonicotinoïdes
Question N° 3461de M. Alexandre Sabatou (Rassemblement National – Oise) :
« M. Alexandre Sabatou interroge M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le bilan de l’interdiction des néonicotinoïdes en France depuis 2018 associé à un bilan comparatif sur l’autorisation exceptionnelle de les utiliser en 2021 et 2022. Cette interdiction dictée par l’Union européenne crée une concurrence déloyale au sein de cette même Union et a été faite sans prendre en compte des alternatives à ces interdictions. Les betteraviers français ont déjà subi une baisse des quotas de production imposée par l’Union européenne, qui a eu pour conséquence la fermeture de quatre sociétés betteravières françaises alors que la France est un des leaders mondiaux dans ce domaine. Pour rappel, la décision d’interdire la molécule néonicotinoïde qui est directement intégrée par le semencier dans la graine et qui permettait d’éviter certains parasites spécifiques s’est faite sans étude préalable de remplacement. Les betteraviers ressentent d’autant plus l’injustice de cet arrêt que la betterave est récoltée avant floraison et donc ne peut pas être un « tueur d’abeilles » comme cela leur a été injustement reproché. Cette politique poussée par l’Union européenne est appliquée strictement par la France alors que l’Allemagne et les Pays-Bas dérogent à la règle. Encore une fois, les betteraviers français ont l’impression que l’Allemagne est favorisée, comme ils l’avaient déjà constaté pour les quotas. La France doit faire face à la concurrence de pays n’ayant pas interdit l’usage de la molécule néonicotinoïde. Les pays d’Amérique du Nord, eux, utilisent des OGM et travaillent sur le séquençage ADN (NBT). La France ne propose aucune alternative aux betteraviers français. Le risque à moyen terme est de voir péricliter cette production française très performante. Les positions dogmatiques de l’Union européenne alliées au jusqu’auboutisme écologique vont venir à bout d’une filière française jusque-là florissante. Il lui demande sa position sur ce sujet ».
Texte de la réponse :
« Le Gouvernement a pris acte de la décision rendue le jeudi 19 janvier 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) excluant l’utilisation des néonicotinoïdes (NNI) pour les semences et le droit de déroger à l’interdiction européenne dans le cadre de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009. Par conséquent, aucune nouvelle dérogation autorisant l’utilisation des NNI pour les semences de la campagne 2023 n’a été accordée. Dès 2020, le Gouvernement avait mis en place un plan national de recherche et d’innovation (PNRI) sans précédent de plus de 20 millions d’euros face à la menace de la jaunisse. Ce plan a permis de coordonner un important effort de recherche autour de la filière afin d’apporter des solutions alternatives techniquement et économiquement viables pour sortir des NNI en 2024. La décision de la CJUE est venue percuter ce programme de travail établi pour 3 ans et provoque des inquiétudes légitimes chez les planteurs, sucriers et semenciers sur la campagne des semis de mars 2023. Elle oblige la France à s’adapter pour la troisième et dernière année, l’État sera en soutien de la filière pour y parvenir. Dès le 23 janvier 2023, conscients des impacts qu’emporte l’arrêt de la CJUE pour la campagne betteravière, le ministre a reçu les professionnels de la filière afin d’échanger avec eux sur la situation. Le 9 février 2023, il a annoncé avec la filière le déploiement d’un plan d’actions afin de garantir une production suffisante de betteraves en 2023 et l’approvisionnement de l’ensemble de la filière sucre française. Dans ce cadre, afin que les producteurs ne pâtissent pas d’une distorsion de la concurrence, une action est menée à l’échelle européenne, afin de s’assurer que la décision de la CJUE soit uniformément appliquée par l’ensemble des pays de l’Union européenne. De plus, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a demandé, lors du Conseil européen « agriculture et pêche » du 30 janvier 2023, le déclenchement d’une clause de sauvegarde permettant d’interdire l’importation de produits traités avec des néonicotinoïdes. En outre, ce plan d’actions vise à déployer rapidement des mesures de protection des cultures. À cette fin, de nouveaux itinéraires techniques ont été élaborés en liaison avec les professionnels et selon les recommandations du PNRI. Ils seront mis à disposition des producteurs via l’institut technique de la betterave et pourront être utilisés en cas de jaunisse dès le printemps 2023. En parallèle, toutes les solutions immédiatement disponibles, issues du PNRI, concernant notamment l’utilisation des plantes compagnes sont mises en œuvre par la profession. À des fins préventives, des mesures ambitieuses de gestion des réservoirs viraux sont à l’étude et un plan d’actions et de surveillance sur la gestion de ces réservoirs sera présenté prochainement. Les modèles de prévision des vols de pucerons issus des travaux du PNRI seront déployés prochainement. Enfin, une aide sera accessible aux planteurs en cas de pertes liées à un épisode de la jaunisse au cours de l’année 2023. Le Gouvernement a demandé l’activation d’une mesure de crise européenne et engagé le travail de construction du dispositif, en lien avec la Commission européenne ».
Lien ici.
UNION EUROPÉENNE
•Commission européenne
Réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l’alimentation animale : les VrTH à l’ordre du jour
Le 12 mai prochain aura lieu une réunion de la section Semences du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l’alimentation animale. A cette occasion, une discussion aura lieu sur la demande de la France concernant l’autorisation de prescrire des conditions de culture appropriées pour les variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH), dans le cadre de l’article 16(2) de la directive 2002/53 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
Pour rappel, dans sa décision du 7 février 2020, le Conseil d’État a enjoint le gouvernement français à demander l’autorisation à la Commission européenne de prescrire des conditions de culture appropriées pour les cultures de VrTH. Cette demande a été présentée par le gouvernement, le 8 mars 2022, devant la section semences du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l’alimentation animale.
Lien ici.
•Parlement européen
Réponse à une question parlementaire : essais en plein champ de pesticides à ARN dans l’Union européenne
Question P-001063/2023 de Eric Andrieu (S&D) :
Un nouveau type de pesticide fait actuellement son apparition. Ces pesticides à interférence sur l’acide ribonucléique (ARN) sont conçus pour inhiber l’expression génétique des insectes afin de les tuer.
Au moins une entreprise a déclaré publiquement qu’elle menait déjà des essais en plein champ sur des cultures de pommes de terre dans plusieurs États membres, dont la France, l’Espagne, l’Allemagne et la Slovénie.
L’impact environnemental de ces « pesticides génétiques » est loin d’être connu et plusieurs études scientifiques laissent déjà entrevoir de nombreux risques pour la biodiversité et les pollinisateurs, en raison notamment des proximités génétiques existantes entre différentes espèces d’insectes.
En réponse à la question d’une ONG sur le sujet, la Commission a déclaré ne pas avoir connaissance d’essais en plein champ de substances à ARN, ce qui est surprenant, surtout au moment où la Commission prépare une proposition de règlement sur les nouvelles techniques génétiques.
1. Quelles mesures la Commission envisage-t-elle de prendre pour évaluer ce qui se passe actuellement dans les États membres en ce qui concerne les essais de substances à ARN ?
2. Les pesticides à ARN bénéficient-ils actuellement d’un vide réglementaire ?
3. Sommes-nous confrontés à une stratégie du fait accompli, qui discréditerait la Commission pour son ignorance des essais en cours alors qu’un nouveau cadre réglementaire pour les nouvelles techniques génétiques est en cours d’élaboration ?
Réponse de Mme Kyriakides au nom de la Commission européenne :
« La Commission souhaiterait informer l’Honorable Parlementaire que les pesticides à ARN (acide ribonucléique) interférent ne bénéficient pas d’un vide réglementaire. Au contraire, ils sont pleinement couverts par le règlement (CE) no 1107/2009 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Pour obtenir l’approbation d’une substance active à ARN interférent, les demandeurs devraient introduire une demande auprès d’un État membre et fournir les données nécessaires, telles que requises pour toute substance chimiquement active, avant une évaluation scientifique des risques par un État membre rapporteur et un examen par les pairs mené par les autres États membres sous la houlette de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA/EFSA). Les résultats de l’évaluation des risques serviraient de fondement à la décision sur la gestion des risques prise par la Commission (sous réserve d’un avis favorable du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux).
À l’heure actuelle, la Commission n’a pas connaissance d’une demande d’approbation dans l’Union européenne de substances actives à ARN interférent aux fins d’une utilisation dans des produits phytopharmaceutiques.
En ce qui concerne les études de terrain sur des substances actives non encore approuvées, l’article 54 du règlement (CE) no 1107/2009 s’applique ; il prévoit que les États membres peuvent, sur demande, délivrer des permis spécifiques pour ces études. Les permis peuvent limiter les quantités à utiliser et imposer des conditions visant à prévenir les effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou des effets inacceptables sur l’environnement. Les États membres ne sont pas tenus d’informer la Commission des permis délivrés. Les résultats des études de terrain, si celles-ci sont effectivement autorisées, peuvent être intégrés à une demande d’approbation, telle que susmentionnée. Toutefois, étant donné que toute approbation ne pourrait être accordée qu’après une évaluation approfondie de la demande, on ne peut en aucun cas parler de stratégie du fait accompli. »
Lien ici.
Réponse à une question parlementaire : groupes d’experts
Question P-001046/2023 de Irène Tolleret (Renew) :
« La Commission européenne a mis en place de nombreux groupes d’experts en vue de la préparation de propositions législatives, des actes délégués ainsi que d’autres initiatives politiques, mais aussi pour mettre en œuvre la législation, les programmes et les politiques de l’Union, y compris la coordination et la coopération avec les États membres et les parties prenantes, et la préparation anticipée d’actes d’exécution.
1. Ces groupes d’experts devant être en mesure de donner un avis indépendant sur les sujets qu’ils traitent, la Commission peut-elle dire comment leur expertise est évaluée et leur représentativité garantie ?
2. Sait-elle quel organisme indépendant sélectionne les experts à l’issue de leur candidature ?
3. Peut-elle expliquer pourquoi aucun représentant des secteurs agricole et agroalimentaire ne fait partie du groupe d’experts sur la taxonomie, et ce en dépit des répercussions des textes concernés sur ces secteurs ? »
Réponse du vice-président Maroš Šefčovič au nom de la Commission européenne :
« 1. Les organisations de parties prenantes et les experts individuels sont nommés membres de groupes d’experts sur la base de critères de sélection qui sont mentionnés dans des appels publics à candidatures publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission (ci-après le « registre »), conformément aux règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission [1]. Les autorités des États membres et autres entités publiques sont nommées sur invitation directe. Pour garantir le plus haut niveau de transparence et d’intégrité des experts, les personnes demandant à être nommées à titre personnel doivent soumettre une déclaration d’intérêts dans le cadre de leur candidature. Les personnes demandant à être nommées pour représenter un intérêt commun partagé par des parties prenantes, de même que les organisations, ne sont nommées que si elles sont inscrites dans le registre de transparence.
2. Les membres des groupes d’experts sont sélectionnés par le service de la Commission qui est responsable du groupe en cause.
3. La sélection des membres de la plateforme sur la finance durable, établie en conformité avec le règlement sur la taxinomie [2], a été faite sur la base des candidatures reçues à la suite de l’appel public à candidatures [3] et dans le but de garantir autant que possible une composition équilibrée. Compte tenu des tâches à accomplir, de la taille de la plateforme et du type et du niveau d’expertise requis, il n’a pas été possible d’assurer une représentation permanente de tous les secteurs concernés, notamment le secteur agricole. Cependant, la Commission peut inviter ponctuellement d’autres experts ayant acquis une expertise spécifique à participer à la plateforme (voir article 20, paragraphe 4, du règlement sur la taxinomie). Ces experts garantiraient que les secteurs concernés sont représentés au sein de la plateforme lorsque c’est nécessaire. Comme pour tout groupe d’experts, la transparence est assurée au moyen du registre. »
Lien ici.
Réponse à une question parlementaire : retards systématiques dans le traitement des demandes d’accès aux documents des institutions de l’UE
Question E-001119/2023 de Gianantonio Da Re (ID) :
« On Tuesday 28 March 2023, the European Ombudsman, Emily O’Reilly, called on the European Commission to deal urgently with systemic delays in handling requests from European citizens for access to documents of the EU institutions. According to the Ombudsman, a fundamental reform of the procedure for documents access is required to ensure that the EU Transparency Regulation deadlines are met. Specifically, it appears that over 60% of decisions reviewing requests took more than 60 working days, despite a maximum time limit of 30 working days.
Unfortunately, such delays render the information obtained no longer useful for research or journalistic purposes, or actually prevent citizens from having their say at relevant times in decision making.
What measures does the Commission intend to take to speed up the procedure for handling access to documents requests ? »
Réponse de la Vice-Présidente Jourová au nom de la Commission européenne :
« The Commission is currently analysing the recommendations from the European Ombudsman related to the delays in handling requests for access to documents.
At this point, the Commission would like to stress that the vast majority of initial requests for access to documents submitted to the Commission were handled in a timely manner as acknowledged by the European Ombudsman.
The Ombudsman’s finding of maladministration concerns the confirmatory stage of the access to documents procedure, which represents a limited part of the total applications received by the Commission (355 requests out of a total of 8065 applications in 2021 – only 4.4% of all applications received by the Commission). The delays mainly affected particularly complex requests due to their legal and technical nature.
The Commission is already making available documents via several registers including the Register of Commission Documents. The Commission strives to proactively publish more documents.
As part of these efforts to facilitate the exercise of the right to information, the Commission launched in September 2022 a new IT system for submitting and handling requests for access to Commission documents (EASE — Electronic Access to European Commission Documents).
Via the public portal the applicants can submit their request as well as search and consult the documents that were disclosed in the context of other applications for access to documents.
The Commission will provide a list of measures intended to accelerate the handling of the applications in the response to the European Ombudsman decision. »
Lien ici.
[1] C(2016)3301 final.
[2] Voir l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
[3] Voir l’onglet « information complémentaire » sous l’entrée « Groupes d’experts » à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=fr&groupID=3731