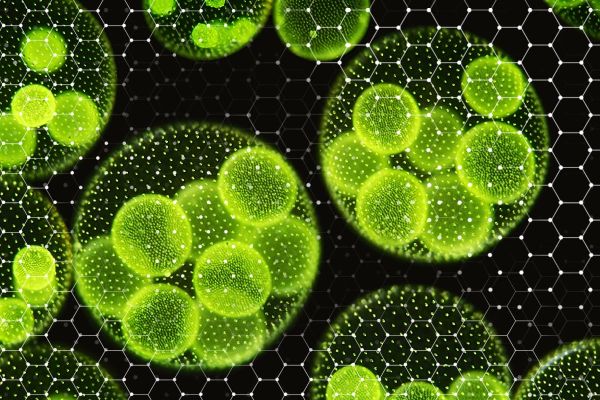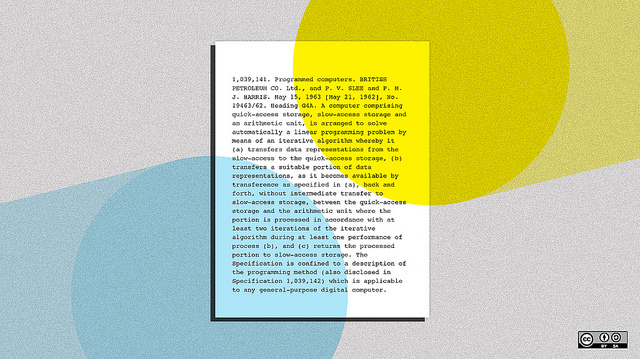Les brevets à l’assaut des semences

Le 25 mars 2015, la Grande chambre de recours de l’Office Européen des Brevets a confirmé que des plantes issues de procédés « essentiellement biologiques » [1] peuvent être brevetées. Quelques jours plus tard, le premier semencier mondial, Monsanto, annonçait son ambition d’acquérir le troisième, Syngenta, et de contrôler ainsi à lui seul près de 40% du marché mondial des semences et des pesticides associés [2]. En parallèle, le marché des brevets s’organise au sein de clubs privés échappant à toute régulation publique [3]. Comment en est-on arrivé là ?
Selon une directive européenne de 1998 [4], l’établissement du lien entre une information génétique (séquences, marqueurs…) et un caractère d’intérêt économique [5] peut justifier l’octroi d’un brevet couvrant toutes les plantes [6] qui expriment ce caractère et contiennent l’information génétique associée. En 1998, la transgenèse était l’outil des généticiens le plus connu, ce qui a laissé supposer que seuls les transgènes pouvaient être brevetés : la Grande Chambre a donc rappelé, le 25 mars 2015, que rien dans la directive n’interdit la brevetabilité des traits natifs préexistants, et a donc confirmé que des plantes issues de procédés « essentiellement biologiques » peuvent être brevetées.
Semences paysannes locales et droits d’usage collectifs des communautés
Toutes les espèces cultivées sont issues de plusieurs millénaires de sélections paysannes. En ressemant chaque année une partie de leurs récoltes précédentes régulièrement enrichies de quelques semences venant d’autres champs, les communautés paysannes les ont adaptées à chaque terroir, à la diversité et à la variabilité des climats, de leurs besoins alimentaires et de leurs aspirations culturelles. Elles nous ont ainsi légué plusieurs millions de populations de plantes différentes. Au sein de ces systèmes semenciers paysans, les échanges de semences sont essentiellement locaux, entre personnes qui se connaissent. Les droits de propriété intellectuelle n’existent pas. Seuls des droits collectifs oraux définissent les règles d’accès et d’usage garantissant la pérennité et la qualité du stock semencier ; et les savoirs intellectuels indispensables à la reproduction de ce stock sont transmis oralement entre pairs.
La variété propriétaire obtient le monopole des marchés régionaux
Au siècle dernier, la sélection sort du champ de production agricole. Elle croise et standardise les semences paysannes pour les adapter partout au même paquet technologique (mécanisation, engrais et pesticides chimiques, irrigation) offert par l’exploitation des énergies fossiles. Apparaissent alors des variétés distinctes, homogènes et stables (DHS) issues de cette « amélioration des plantes » réalisée par l’industrie, variétés qui s’extraient des contraintes du terroir local pour conquérir les grandes régions climatiques. Ces critères DHS sont aussi ceux du catalogue officiel, ce qui leur accorde un monopole absolu d’accès au marché. Les obtenteurs déposent sur ces variétés inscrites au catalogue des droits de propriété intellectuelle (COV) qui interdisent toute reproduction de la variété sans l’autorisation de l’obtenteur [7].
Mais ces caractères DHS évoluent dans le champ des paysans où il est très difficile de distinguer une variété d’une autre, et ne sont plus identifiables dans la récolte, ni dans une nouvelle variété issue d’un croisement. De ce fait, les multiples tentatives d’interdiction des semences de ferme ne sont jamais totalement opérationnelles et tout obtenteur reste libre d’utiliser les variétés de ses concurrents pour en sélectionner d’autres [8]. Les exceptions du fermier et du nouvel obtenteur qui limitent la propriété de l’obtenteur précédent découlent de la nature des caractères DHS choisis pour définir la variété.
Les semences paysannes, diversifiées et variables, donc non DHS, sont exclues du catalogue, donc du marché. Mais elles ne doivent pas disparaître car elles constituent la ressource originelle des obtenteurs qui les ont baptisées « patrimoine commun de l’humanité » afin de justifier leur accès libre. Elles sont systématiquement collectées dans les champs des paysans, puis momifiées et conservées dans d’immense collections publiques réfrigérées où elles ne survivent que provisoirement. Pour garantir leur renouvellement, les gouvernements tolèrent en marge des lois l’existence des systèmes semenciers « informels » de l’agriculture vivrière qui, bien que cantonnés au jardinage amateur dans les pays riches, produit les trois quarts de la nourriture consommée sur la planète [9]. En 1992, la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a divisé le patrimoine de l’humanité en le plaçant sous la souveraineté des États afin de faciliter l’acceptation de sa privatisation par les brevets en échange d’une promesse jamais tenue de partage des bénéfices [10]. En 2005, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) [11] a rendu à l’industrie un accès « facilité » à sa ressource en mutualisant les collections nationales au sein d’un Système multilatéral mondial.
Le brevet sur les traits génétiques contrôle le marché libre globalisé
En moins d’un siècle les « améliorateurs » ont réalisé tous les croisements possibles basés sur l’observation de caractères phénotypiques de plantes entières et visant à valoriser le paquet technologique de l’agriculture industrielle. Pour continuer à produire de nouvelles semences, les commercialiser et engranger des dividendes, ils quittent la station d’expérimentation pour le laboratoire où ils transforment alors génétiquement ces mêmes plantes en assemblant une à une leurs séquences génétiques. Les premiers OGM apparaissent dans les années 80 et avec eux, un nouveau droit de propriété intellectuelle sur le « gène et sa fonction » beaucoup plus puissant que le COV et le brevet sur la variété : le brevet sur les traits génétiques. Couvrant de multiples espèces et variétés différentes, il conquiert le marché mondial. Avec les marqueurs génétiques et les progrès en matière de séquençage et de bioinformatique, l’information génétique brevetée est identifiable non seulement dans le champ, mais aussi dans la récolte et les produits qui en sont issus, ainsi que dans les nouvelles variétés issues de croisements. Les exceptions de l’agriculteur et du sélectionneur sont anéanties.
Le règlement européen 2100/94 tente de rétablir l’équilibre avec le COV en étendant sa protection à la variété « essentiellement dérivée » à laquelle un transgène a été rajouté. Il est suivi par la directive 98/44 qui attribue les royalties sur les semences de ferme de plantes brevetées au seul détenteur du COV. Tant que le brevet se limite aux seuls transgènes étiquetés, les contaminations génétiques des cultures ne menacent que les paysans. Mais l’évolution des techniques va bouleverser rapidement cet équilibre instable.
De 2001 à 2014, le coût du séquençage génétique est divisé par 100 000. En 1997, l’International Rice Genome Sequencing Project constitue un consortium de laboratoires publics de dix pays pour séquencer le riz, ce qui lui prend sept ans. En 2007, dix espèces sont séquencées en une seule année, 50 autres depuis. Toutes ces séquences sont numérisées dans des bases de données, tandis que le phénotypage à haut débit numérise les caractères phénotypiques des plantes auxquels sont rajoutés leurs caractères d’intérêts (résistances à un herbicide, à un pathogène, à la sécheresse, caractère nutritionnel ou susceptible d’alimenter l’industrie de la biomasse…). En 2015, l’initiative DivSeek [12] entame la construction d’une base de données mondiale des séquences génétiques et des caractères phénotypiques de toutes les ressources du Système multilatéral du TIRPAA. Il suffit dès lors de disposer des moyens financiers nécessaires à la programmation et au fonctionnement de moteurs de recherche de grande puissance de calcul pour identifier la corrélation entre des séquences génétiques, des caractères phénotypiques d’intérêt et les plantes qui les expriment. C’est ainsi qu’une poignée de multinationales semencières est en train de breveter à tour de bras tous les caractères essentiels des principales cultures agricoles.
Brevets toxiques et concentration industrielle
Ces brevets ne sont pas tous développés pour produire des semences. Un grand nombre ne sert qu’à alimenter des procédures judiciaires destinées à rançonner ou absorber les entreprises concurrentes qui utilisent, souvent sans le savoir, des informations génétiques brevetées. La concentration industrielle qui en résulte est exponentielle : alors qu’en 1997, 7000 obtenteurs [13] se partageaient le marché mondial des semences sans qu’aucun d’entre eux n’en contrôle plus de 1%, en 2013, 10 multinationales en contrôlaient plus de 75% dont trois plus de 50% [14].
Une nouvelle bulle financière gonfle ainsi bien au-delà de la valeur des semences physiques sur lesquelles elle se développe. Contrairement aux obtenteurs de variétés qui sélectionnent de vraies plantes, ces breveteurs évoluent dans le monde numérique virtuel sans avoir besoin de manipuler ou de produire la moindre graine. Leur action sur les semences physiques réelles n’en est pas moins catastrophique :
![]() elle oblige les paysans à racheter chaque année de nouvelles semences brevetées et les pesticides nécessaires à leur culture ;
elle oblige les paysans à racheter chaque année de nouvelles semences brevetées et les pesticides nécessaires à leur culture ;
![]() elle bloque l’innovation en supprimant l’accès libre à la ressource et tarit son renouvellement : si les paysans étaient encouragés à donner leurs semences aux collections publiques afin de les rendre notoirement connues pour les protéger d’une appropriation par un COV, ils vont par contre refuser de les donner si cela facilite le dépôt de brevets sur leurs traits natifs qui leur interdiront de continuer à les cultiver ;
elle bloque l’innovation en supprimant l’accès libre à la ressource et tarit son renouvellement : si les paysans étaient encouragés à donner leurs semences aux collections publiques afin de les rendre notoirement connues pour les protéger d’une appropriation par un COV, ils vont par contre refuser de les donner si cela facilite le dépôt de brevets sur leurs traits natifs qui leur interdiront de continuer à les cultiver ;
![]() elle génère de nouvelles normes sanitaires, environnementales et de biosécurité dont le coût assure un monopole d’accès au marché aux seules semences bénéficiant du retour sur investissement du brevet ;
elle génère de nouvelles normes sanitaires, environnementales et de biosécurité dont le coût assure un monopole d’accès au marché aux seules semences bénéficiant du retour sur investissement du brevet ;
![]() enfin, si le passage des semences locales communes au bien public mondial géré par le TIRPAA a été marqué par une réduction de 75 % la biodiversité cultivée, l’actuelle privatisation de ce bien public la réduit à quelques centaines de « traits » brevetés cultivés sur toute la planète.
enfin, si le passage des semences locales communes au bien public mondial géré par le TIRPAA a été marqué par une réduction de 75 % la biodiversité cultivée, l’actuelle privatisation de ce bien public la réduit à quelques centaines de « traits » brevetés cultivés sur toute la planète.
Les clubs de brevets privatisent l’organisation de l’accès aux ressources
Pour faire face à ces nouveaux brevets, les obtenteurs traditionnels sollicitent le secours des lois pour taxer les semences de ferme [15] et consolider le monopole que leur accorde le catalogue des variétés DHS, attaqué à la fois par les multinationales du brevet (qui n’ont pas besoin d’homogénéiser et de stabiliser des variétés pour faire valoir un brevet sur un gène) et par les défenseurs des semences paysannes et biologiques. Ceux qui investissent dans les biotechnologies s’organisent pour cumuler les avantages des deux systèmes. En introduisant les marqueurs génétiques comme nouvel outil pour établir la distinction des variétés, ils donnent au COV la même possibilité technique qu’au brevet sur les traits génétiques de limiter efficacement les exceptions de l’obtenteur (aux seules variétés qui ne sont pas essentiellement dérivées [16]) et des semences de ferme (au paiement des royalties). Au-delà, leur principal souci est de rouvrir l’accès aux ressources génétiques pour la recherche et la sélection. Avec la Public Initiative on Patents Rights in Agriculture (PIPRA), les universités américaines développent dès 2004 une stratégie de mise en commun de leurs brevets. En Europe, les lois nationales allemande, française et hollandaise rétablissent à la même époque l’exception de recherche, suivies en 2014 par le brevet unitaire européen. Contrairement au COV traditionnel, l’exception de l’obtenteur reste soumise dans le cadre des brevets à l’accord du détenteur du brevet si l’information génétique brevetée est présente dans les nouvelles semences commercialisées. Pour remédier au risque de blocage qui peut en résulter, une dizaine de semenciers européens ont fondé une plate-forme internationale de licences pour les végétaux [17] : chaque membre du club a accès aux brevets des autres membres qui ne peuvent pas refuser, l’arbitrage d’un expert indépendant remédiant aux éventuelles difficultés de négociation du prix. A la différence du système multilatéral du TIRPAA, ce club privé échappe à toute gouvernance publique et l’accès à la ressource n’est pas gratuit.
Il reste à espérer que les mobilisations paysannes et populaires convaincront les gouvernements de ne pas se laisser berner par les promesses des semenciers, d’abroger tout brevet sur le vivant et d’appliquer les droits des agriculteurs d’utiliser, d’échanger, de vendre et de protéger leurs semences de la biopiraterie.
[1] Procédés ayant recours à des « phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection »
[2] , « Fusion Monsanto-Syngenta : moins d’impôts pour plus de pesticides ? », Inf’OGM, 27 mai 2015
[3] , « Brevets : certains semenciers enterrent la hache de guerre », Inf’OGM, 7 mai 2018
[4] Directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
[5] Toute invention brevetable doit être susceptible de « développement industriel »
[6] il en est de même des animaux qui ne sont pas développés ici
[7] Le verrouillage technologique des variétés hybrides F1 n’est efficace que pour les espèces allogames. Il est complété en Europe par le COV et aux États-Unis par le brevet sur la variété
[8] que cela soit juridiquement autorisé dans le cas du COV ou interdit dans le cas du brevet
[9] En n’utilisant qu’un quart des surfaces cultivées, ce qui prouve qu’elle n’est pas moins productive que l’agriculture industrielle
[10] , « Accès aux ressources génétiques : vers un partage réel des avantages ? », Inf’OGM, 16 avril 2012
[11] , « Le Tirpaa, 10 ans après : l’industrie semencière ne joue pas le jeu… », Inf’OGM, 29 octobre 2017
[13] Cela ne prend pas en compte les multiplicateurs et revendeurs, ni les agriculteurs qui vendent leurs propres semences sur les marchés locaux
[14] http://www.etcgroup.org/es/content/monsantosyngenta-degigantes-geneticos-mega-monstruos-agricolas
[15] Qu’ils considèrent comme une concurrence déloyale du fait que le brevet sur les traits génétiques peut les interdire efficacement, contrairement au COV ou au brevet sur les caractères phénotypiques de la variété
[16] Il s’agit pour les semenciers de garder un droit de propriété sur des variétés dont les différences avec la « variété-mère » sont minimes Cf. http://www.infogm.org/-Semence-definition-loi-et-marche-mondial-
[17] , « Brevets : certains semenciers enterrent la hache de guerre », Inf’OGM, 7 mai 2018