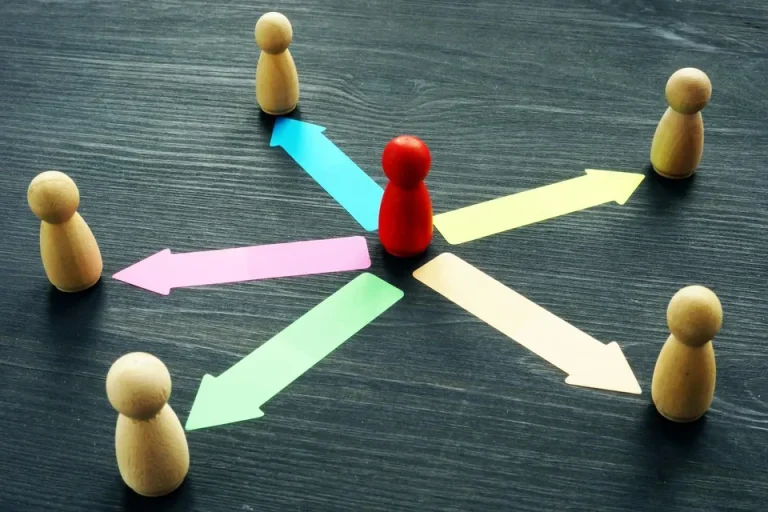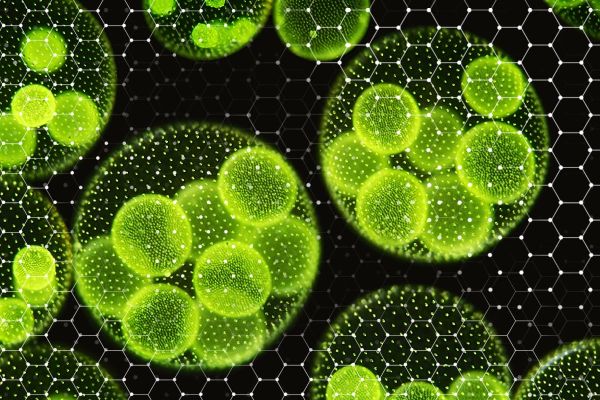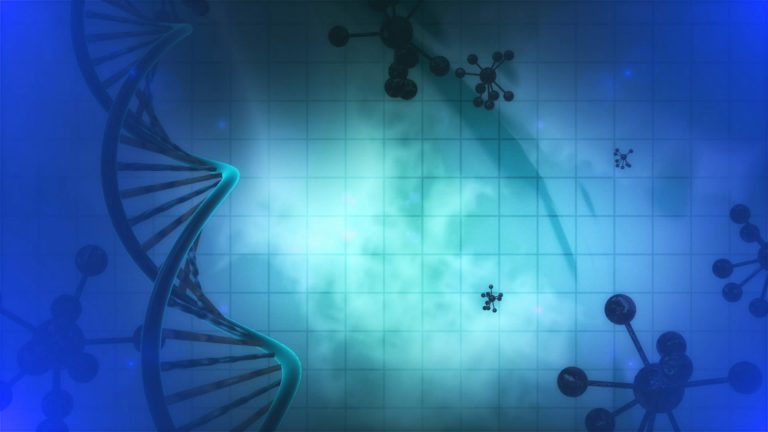Actualités
Belgique : des vers transgéniques au comportement modifié
En octobre 2023, un consortium public/privé, sous la responsabilité de l’université de Namur (Belgique), inaugurait le projet européen BABots (en anglais : Biological Animal roBots). Le premier Babot actuellement en cours de construction par ce consortium est un nématode génétiquement modifié censé être piloté comme un robot. Pourtant, ces vers ne sont pas réellement pilotés et sont, en fait, loin d’être des robots. Ce projet s’inscrit dans la logique de la convergence des technologies connues sous le nom de BANG (pour Bit, Atome, Neurone et Gène).

On connaît les plantes transgéniques insecticides ou tolérant les herbicides, on connaît les micro-organismes transgéniques producteurs d’enzymes ou additifs alimentaires… Voici une nouveauté qui vient du domaine animale : des vers modifiés génétiquement, non pour avoir une nouvelle caractéristique, comme on les a connus jusque maintenant, mais pour avoir un comportement génétiquement modifié.
Des nématodes transgéniques
Les Babots sont des animaux modifiés génétiquement, qualifiés d’« animaux robots » ou de « robots biologiques » par leurs promoteurs. L’Université de Namur, associée à cinq autres centres universitairesi et une entreprise agricole italienne, Zero Farming, ont obtenu des financements européensii pour créer ces Babots. Le premier d’entre eux, en cours de développement, est un nématode d’un millimètre de long ; un animal, modèle de laboratoire, Caenorhabditis elegans (C. elegans en abrégé) génétiquement modifié par transgénèses. D’après le site Internet du projetiii, « les BABots sont des vers transgéniques (C. elegans) qui sont reconfigurés pour effectuer des tâches biologiques conçues par l’homme de manière active et autonome ». Autrement dit, la nouveauté par rapport à d’autres animaux transgéniques est qu’ils sont censés « (inter)agir dans des environnements biologiques complexes » selon des ordres donnés par les techniciens de laboratoire. Ces Babots sont donc supposés prendre le relais des robots mécanico-électroniques que certaines entreprises agricoles développent, présentés comme plus agiles, plus « éco-compatibles »…
Cependant, le terme de robot est discutable. L’utilisation de ce terme plonge le lecteur dans un univers de science-fiction, mais au fond le trompe. En effet, ce projet n’entend pas faire fusionner du métal et des matières biologiques, ou encore d’adjoindre des éléments biologiques (peau, synapses…) à une structure « métallo-électronique ». D’ailleurs, d’autres « bio-robots » sont construits, comme les Anthropobots, amas de cellules humaines qui se déplacent dans le corps et agissent par eux-mêmes. Ils sont également nommé « robots » de façon erronée. Ce que souligne Philippe Fraisse, directeur du groupement de recherche CNRS Robotique, dans un entretien publié dans Sciences et Aveniriv : « ces systèmes autonomes n’ont pas été construits ni programmés : leur assemblage et leur comportement sont spontanés. On ne peut donc pas vraiment parler de » robot » ».
Modifier les gènes pour modifier le comportement
En quoi consistera la modification ? La nouveauté des Babots réside dans le fait d’insérer des transgènes pour modifier les structures synaptiques et ainsi modifier le comportement de ces vers. L’objectif des promoteurs a été d’établir « une technique pour insérer génétiquement de nouvelles connexions synaptiques électriques dans les circuits neuronaux de C. elegans ». Une technique qui « s’est avérée très efficace pour modifier les comportements naturels de C. elegans », selon eux. Interrogé par Inf’OGM, Ithai, l’un des partenaires de ce projet, nous explique : « nous avons développé des techniques pour insérer génétiquement de nouvelles connexions synaptiques entre des neurones cibles, modifiant ainsi la structure des circuits neuronaux et les comportements qu’ils contrôlent. Nous ajoutons concrètement au génome un gène qui code pour une protéine spéciale, à partir de laquelle la synapse est construite. Nous ajoutons également une « adresse » pour restreindre l’expression de ce gène aux neurones spécifiques que nous souhaitons connecter. Il est possible d’insérer de cette manière plusieurs variantes de la synapse en parallèle »v.
De même, Elio Tuci, professeur à la faculté d’informatique de l’Université de Namur, un des partenaires du projet, souligne que « concernant le nématode, nous pouvons supprimer ou ajouter des connexions entre les 302 neurones du ver par notre connaissance du système nerveux central ». Et Ithai de renchérir : « en outre, nous visons à mettre en œuvre de nouveaux circuits génétiques au sein de neurones spécifiques afin de permettre [de] répondre à un certain signal pendant un certain temps, puis passer à un signal différent ». Cette réorganisation neuronale sera-t-elle de nature à engendrer de la souffrance pour les vers ? Aucunement selon les participants au projet qui précisent que « les C. elegans ne sont pas sensibles. Ils ne sont pas capables de ressentir la douleur et ne peuvent pas être blessés. Ils seront bien entendu traités avec le respect dû à toute forme de vie et évolueront dans des environnements très naturels pour eux ». La question de la sensibilité et de la sentience est loin d’être tranchée. Le 19 avril 2024, la « déclaration de New York », signée depuis par 287 chercheurs, reconnaît la « possibilité réaliste » que tous les animaux, vertébrés et invertébrés, aient une conscience… Cette déclaration souligne notamment qu’en conséquence, il serait « irresponsable d’ignorer cette possibilité » dans la façon dont nous traitons ces animaux, qu’il s’agisse notamment d’élevage ou d’expérimentation animalevi.
Des nématodes OGM pour détecter et détruire des polluants ?
Ce projet envisage de créer des animaux transgéniques qui pourraient détecter une substance cible et agir pour l’éliminer. Les porteurs du projet mentionnent que des animaux transgéniques capables de détecter des polluants existent déjà, comme des C. elegans génétiquement modifiés, pour servir de biocapteurs de composés toxiques ou de métabolites liés à des maladies : des poissons transgéniques qui deviennent fluorescents lorsqu’ils rencontrent des polluants. Interrogé par nos soins, Ithai précise : « l’idée n’est pas que les BABots interagissent avec un opérateur humain, mais qu’ils agissent de manière autonome pour accomplir leur mission. Par exemple, s’ils détectent un pathogène végétal intrus, ils commencent par « s’armer » avec quelque chose qui éliminera l’intrus, puis ils l’attaquent et poursuivent leur activité. Ce n’est pas un comportement que l’on observe naturellement chez C. elegans. […] Si, par exemple, les BABots détectent des bactéries envahissantes, ils devront se rendre dans un réservoir contenant une substance qui tue les bactéries, la charger et ensuite infecter les bactéries ».
Il faut souligner que ce projet vise non pas un seul individu mais des populations de vers transgéniques qui interagissent. Ithai ambitionne de « produire des comportements d’essaimage artificiels afin que les C. elegans modifiés présentent de nouvelles formes de comportement collectif, et mettre en œuvre la commutation comportementale. Notre objectif actuel est de créer une population de C. elegans BABot qui agissent ensemble pour identifier et attaquer certains pathogènes végétaux ». Comment peuvent-ils interagir, collectivement, sans être sensible ? Il ajoute également : « la création d’un comportement collectif synthétique |sic] fait partie de notre objectif. […] Nous ne saurons si cela fonctionne qu’après l’avoir testé ». Mais cette prévision paraît déconnectée de la réalité biologique, car les écosystèmes reposent sur tellement d’interactions, d’éléments en réseaux…
Des BABots éco-compatibles en milieu confiné : vraiment ?
Sur le site du projet, les participants évoquent « une technologie biologique compatible à 100 % avec l’environnement ». Étant « 100 % biologiques », les BABots seraient donc pour eux hautement compatibles avec l’environnement naturel, pourraient s’auto-repliquervii et seraient entièrement dégradables. Biodégradables, cela semble évident… Mais « compatibles avec l’environnement » ou « naturels », c’est osé de l’affirmer : ils ont été modifiés de façon non naturelle avec de très nombreuses transgénèses (puisqu’ils jouent sur des synapses forcément différentes) et ne sont pas issus d’une co-évolution avec leur environnement, de facto. Et s’ils peuvent s’auto-répliquer, la menace est grande qu’ils prennent une place importante dans l’écosystème et deviennent invasifs. Il est en tout cas certain qu’à ce stade, l’absence de risques affichée par les promoteurs n’est qu’une affirmation qui leur appartient, aucun expert n’ayant eu à se prononcer puisqu’aucune demande d’autorisation n’a été faite.
Les porteurs du projet précisent également que le projet a pour ambition de tester l’efficacité de la technologie BABots dans un environnement naturel comme celui confiné de « l’agriculture verticale ». L’agriculture verticale, telle que développée par ZERO Farms, un des partenaires de ce projet de recherche, est un environnement agricole « contrôlé et confiné, comprenant des systèmes de culture de plantes sans sol et en cycle fermé ». C’est dans cet environnement « sûr et confiné » que les chercheurs comptent, dans un premier temps, disséminer leurs BABots pour les évaluer et voir leurs interactions avec les éléments de la machinerie de ZERO Labs (pompes, sondes, tuyauterie) et avec les cultures cibles (par exemple, la laitue et les plants de fraises). Ce projet s’inscrit donc dans la logique de l’agriculture de précision, l’agritech qui se base sur le tryptique génétique, robotique, numérique. En théorie, « il n’y aura aucun contact entre l’environnement naturel et les vers génétiquement modifiés. De plus, ceux-ci ne pourront pas survivre au-delà de l’ambiance expérimentale », rassure Elio Tuci. Le doute est là encore permis car, par exemple, l’étanchéité des laboratoires n’est jamais parfaite et ces petits robots biologiques sont extrêmement petits (1 millimètre), ils pourraient s’échapper.
Des BABots à tout faire
Dans la droite ligne de l’économie de la promesse, les promoteurs de ce projet ont une communication aussi ambitieuse que possible, probablement pour motiver des investissements futurs. Ils évoquent ainsi des usages de ces BABots dans tous les domaines : « nous imaginons, par exemple, des insectes agriculteursviii produisant et distribuant des engrais et protégeant les cultures en luttant contre les parasites ; des nématodes médicinaux pénétrant dans le corps, effectuant des procédures médicales spécifiques et repartant ensuite ; des cafards sanitairesix nettoyant le système d’égouts, mais restant en dehors de la maison ». Efficacité et précision, les maîtres mots des biotechnologues… Mais Elio Tuci apporte une modération à l’enthousiasme qui agite cette équipe et illustre que le plus important dans ce projet est justement la promesse. Oubliant tous les risques et autres questions sociétales, il considère en effet que « si le risque d’échouer est grand, la récompense est d’une taille proportionnelle »…
iLe Département de neurobiologie médicale de l’Université hébraïque de Jérusalem (Israël), l’Institut des sciences et technologies cognitives (ISTC) du Conseil national italien de la recherche (Italie), l’Institut Max Planck de neurobiologie du comportement – CAESAR (Allemagne), l’Institut Max Planck du comportement animal (Allemagne), le Département des études de gestion de l’université d’Aalto (Finlande).
iiCe projet est actuellement financé par l’Union européenne et son programme Cordis à hauteur de 3,251 millions sur quatre ans (octobre 2023 / septembre 2027). Il ne s’agit que d’une phase préliminaire, de recherche. Pour le moment rien de « commercialisable » n’est attendu.
iiiUniversité de Namur, « BABots : Un projet européen de biorobotique », 22 décembre 2022.
Site officiel du projet BABots : « BABots: The design and control of small swarming biological animal robots ».
ivMarie Parra, « Anthrobot, un « robot biologique » à partir de cellules humaines », Sciences et Avenir, 30 novembre 2023.
vArticles scientifiques de l’équipe qui détaillent leurs « prouesses » :
Rabinowitch, I., Chatzigeorgiou, M., Zhao, B. et al., « Rewiring neural circuits by the insertion of ectopic electrical synapses in transgenic C. elegans », Nat Commun 5, 4442 (2014).
Rabinowitch, I., & Schafer, W. R., « Engineering new synaptic connections in the C. elegans connectome », Worm, 4(2), 2015.
Ithai Rabinowitch, « Synthetic Biology in the Brain: A Vision of Organic Robots », 29 juillet-2 août 2019. Issu de « ALIFE 2019: The 2019 Conference on Artificial Life », online. (pp. pp. 654-655), ASME.
viLe Monde, 4 juin 2024
viiCes nématodes sont capables d’auto-fécondations :
Rachel Litke, Éric Boulanger et Chantal Fradin, « Caenorhabditis elegans, un modèle d’étude du vieillissement », Med Sci (Paris), 2018.
viii« Farmer insects » dans le texte.
ix« sanitation cockroaches » dans le texte.