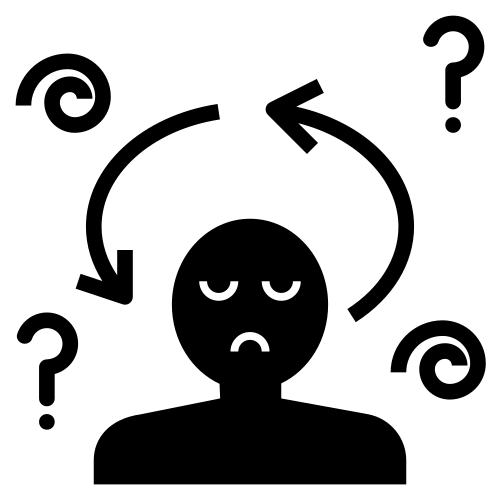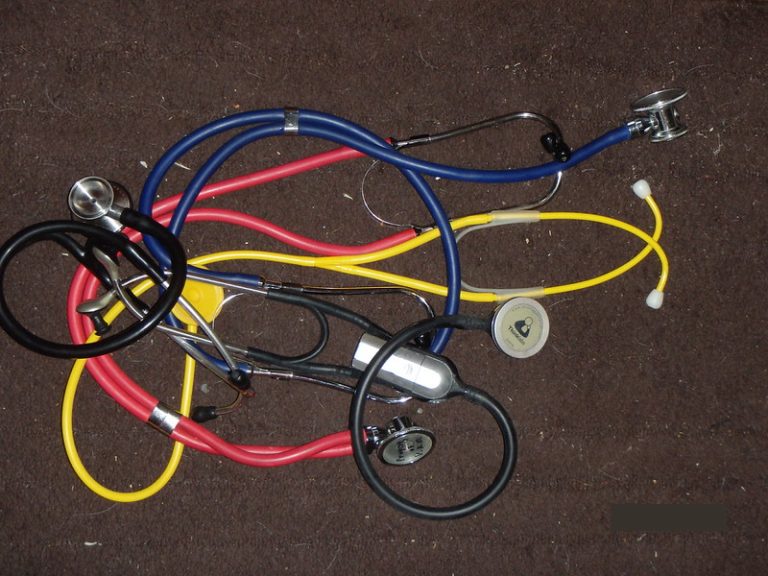OGM : qui manipule qui et quoi ?
Les anthropologues se sont intéressés au paradoxe suivant : les humains ont conçu des OGM pour les adapter à leurs objectifs de contrôler et de rentabiliser une agriculture industrielle à grande échelle, mais à partir du moment où ces organismes sont relâchés dans l’environnement, ils échappent au contrôle humain et développent leur propre capacité d’agir. Dès lors, les humains sont contraints de contenir les mouvements des OGM, de comprendre les conséquences de leur agissement et d’anticiper leur impact sur l’avenir.
Les OGM : une technologie qui dépasse l’homo sapiens
Les OGM ont un pouvoir d’action mais ils ne peuvent pas assumer la responsabilité de leurs actions. C’est donc entre humains que la responsabilité pour ces organismes vivants façonnés par les humains doit être négociée. La question anthropologique qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure les humains sont-ils réellement capables d’assumer la responsabilité pour la technologie qu’ils ont déchaînée ? Dans quelle mesure l’imagination humaine peut-elle suivre le rythme de ses propres inventions technologiques ?
La nature humaine est relativement statique dans son émotivité et son imagination par rapport à la sphère de la production, où il est possible de bâtir sur ce qui a été réalisé auparavant. Notre capacité à prévoir les conséquences est en retard sur les connaissances technologiques qui nous permettent d’agir. L’homo faber (l’homme qui fait) triomphe sur l’homo sapiens (l’homme qui sait) [2]. Ce savoir-faire technologique est relativement simpliste par rapport à la complexité des systèmes biologiques qu’il affecte. Il est relativement simple d’insérer un gène d’une espèce différente dans le génome d’une plante, mais il est presque impossible d’apprécier comment les milliards de pollens qu’elle produit affecteront les différents environnements où elle prolifère. L’impulsion humaine d’aller de l’avant et d’obtenir un contrôle de plus en plus grand sur le monde matériel et naturel, y compris sur les autres humains, est le moteur de cet élan technologique. Une fois créés, les objets vivants nécessitent de nouvelles impulsions inventives pour leur entretien et leurs développements ultérieurs et promettent aux créateurs toujours plus de bénéfices [3]. La mesure du succès est l’argent et le support est la propriété intellectuelle.
Les OGM créent une distorsion des temporalités et des propriétés
Les anthropologues ont réfléchi sur l’opposition entre le temps circulaire des saisons agricoles et la conception linéaire du temps inhérent à l’idée de progrès technologique. L’accélération du temps est intrinsèque à l’économie néolibérale, comprise comme une course aux opportunités et aux avantages. Les OGM sont promus avec un discours d’urgence, avec une « rhétorique de la vitesse à bout de souffle » [4]. La vitesse se manifeste de deux manières distinctes : d’une part, sous la forme d’une compression massive du temps consacré à la recherche et à la production et, d’autre part, sous la forme d’une logique d’urgence qui contribue à la rapidité ou s’en nourrit. La « rapidité » en génomique n’est pas seulement importante parce que le changement est rapide, mais parce que la « rapidité » est un point d’appui matériel et rhétorique utilisé pour inciter d’abord le gouvernement, puis le public et les agriculteurs, à répondre au « matraquage publicitaire » et à s’engager encore d’avantage dans les biotechnologies [5].
Les droits de propriété intellectuelle sont les accélérateurs dans cette course au développement d’OGM commercialisables. Les auteurs des brevets peuvent être des chercheurs individuels, des équipes de recherche, une entreprise ou une institution qui fournit le financement et les installations de recherche. Les anthropologues font la distinction entre « propriété culturelle » et « propriété intellectuelle ». Le bien culturel est transmis de génération en génération : « [i]l est authentique parce qu’on peut démontrer qu’il a été transmis » [6]. Ainsi, les semences traditionnelles transmises et améliorées au fil des générations sont de tels biens culturels. Au contraire, la propriété intellectuelle est exigible précisément parce qu’elle n’a pas été partagée et elle n’a pas été transmise. Les semences brevetées soulèvent la question éthique de savoir si quelques humains devraient être autorisés à devenir propriétaires d’un patrimoine génétique, à jouer avec et à risquer un désastre écologique pour réaliser un profit à court terme.
La revendication d’un brevet sur un organisme vivant exige la réduction des processus organiques à des processus mécaniques, la plante vivante est réduite à une « composition de matière » [7]. Les éléments chimiques composant une séquence d’ADN deviennent les « blocs de construction de la vie » que les humains peuvent recomposer et modifier, comme des blocs Lego. Alors que l’immense complexité du vivant est occultée pour être réduite à des procédures technologiques, des peurs intenses s’emparent des consommateurs, qui craignent que la nature ne se venge et ne subjugue les humains qui prétendent la contrôler.
Avec la semence dont les cellules portent un transgène breveté, un nouveau faisceau de pouvoirs s’est introduit dans le champ de l’agriculteur. Définir la propriété comme un « faisceau de pouvoir », comme le suggère l’anthropologue du XIXème siècle Henry Maine, permet de comprendre les nouveaux pouvoirs privés qui découlent des contrats d’usage que les agriculteurs concluent avec les firmes semencières [8]. Ils sont fondés sur le droit des affaires et posent un défi au droit public. Le droit de propriété intellectuelle supplante le droit de propriété sur la terre et le droit de l’agriculteur sur le fruit de son travail. L’entreprise qui possède un brevet sur un gène implanté dans une semence est devenue capable d’agir sur les actions des agriculteurs grâce à son droit de propriété intellectuelle. L’entreprise détermine ce qu’ils récoltent, comment ils vendent, s’ils réensemencent ou non leur récolte, et même comment ils tiennent leur comptabilité. Nous observons alors un phénomène anthropologique nouveau : des agriculteurs qui deviennent esclaves de leurs semences.
Des responsabilités et des responsables à identifier et juger
Une fois posée la question, qui est responsable de ces objets vivants façonnés par les humains, dotés d’un pouvoir d’action et détenus en tant que propriété intellectuelle, il devient apparent que le jugement pratique et éthique du public sur la connaissance scientifique porte aussi sur la qualité des institutions qui en sont les promoteurs, et qui esquivent un débat public sur les limites de ce savoir [9]. Ce sont les États qui concèdent aux multinationales de biotechnologie le droit de collecter des rentes sur des gènes brevetés insérés dans des plantes. En se reproduisant naturellement, les plantes imposent ce droit dans les champs, que les agriculteurs le veuillent ou non. Les OGM sont donc des « objets poilus » qui s’attachent d’une manière risquée [10]. Les producteurs, et par conséquent les régulateurs et les juges de ces objets, ne sont plus invisibles « mais apparaissent au grand jour, embarrassés, controversés, compliqués et impliqués avec tous leurs instruments ». Les controverses ne portent pas seulement sur les conséquences de la culture et de la consommation d’OGM, mais aussi sur la transparence et l’opacité des institutions démocratiques et sur les possibilités pour les citoyens, les agriculteurs et les consommateurs de faire entendre leur voix. La capacité critique des citoyens qui refusent le statut du consommateur intéresse les anthropologues du politique. L’agir politique visant à contrôler ce qui est mis sur le marché, et à refuser aux OGM le statut de marchandise, ouvre un nouveau chapitre dans les combats environnementalistes et climatiques. Cette démarche revendique une nouvelle démocratie économique qui s’étend à d’autres enjeux, tels que l’usage excessif des pesticides, des énergies fossiles et la mainmise des multinationales sur la chaîne alimentaire.