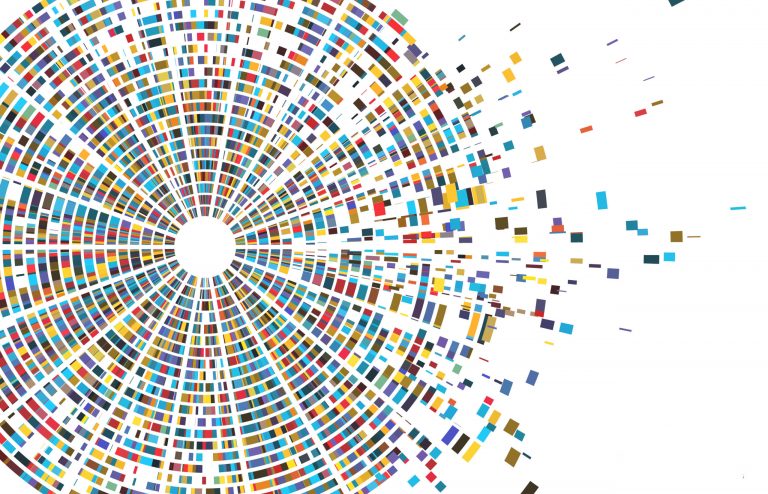Biopiraterie : heureusement, les ONG veillent

Les peuples autochtones, les communautés d’agriculteurs et les organisations de la société civile ont lutté contre la biopiraterie depuis la fin des années 1980, quand la mondialisation s’est véritablement imposée. Ils ont lutté, parfois avec succès, contre des cas où des ressources génétiques avaient été brevetées et des profits engrangés par des multinationales sur le dos des savoirs traditionnels et des ressources des autres.
Le cas le plus ancien et fréquemment évoqué est celui de la Pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus) qui produit deux molécules utilisées dans des médicaments prescrits dans le traitement de plusieurs types de cancers. Des scientifiques canadiens ont étudié cette plante originaire de Madagascar, spécifiquement pour son utilisation dans la médecine traditionnelle. Alors que des médicaments produits à partir de la Pervenche de Madagascar ont sauvé ou allongé d’in-nombrables vies, les communautés traditionnelles, dont le savoir a conduit les chercheurs à faire leurs découvertes, ont reçu bien peu d’avantages en retour.
Ayahuasca : un vol pur et simple
Les médicaments produits à partir de la Pervenche de Madagascar ne menacent pas directement les savoirs traditionnels, mais certaines revendications des brevets peuvent le faire. Ainsi, dans les années 90, l’étasunien Loren Miller a obtenu un brevet étasunien sur une variété d’ayahuasca (Banisteriopsis caapi), une vigne hallucinogène considérée comme sacrée et utilisée dans des rites par de nombreux peuples indigènes dans l’Ouest du bassin amazonien.
Cette audace a beaucoup offensé en Amérique du Sud et provoqué une contestation judiciaire. Les jugements ont infirmé dans un premier temps le brevet mais l’ont rétabli en appel. Miller a obtenu des droits exclusifs sur la plante, alors qu’il a été démontré qu’il n’avait fait que collecter la vigne dans une communauté indigène d’Équateur, la décrire et soumettre cette description en payant les frais de dossier pour revendiquer la plante comme étant son « invention ». Une plante sacrée pour nombre de peuples indigènes fait ainsi l’objet d’une appropriation individuelle. Un peu comme si quelqu’un brevetait l’hostie utilisée dans les messes et communions chez les catholiques.
Les cas de biopiraterie sont légion : des scientifiques du Mississippi qui déposent un brevet sur l’utilisation du curcuma pour les blessures (une pratique médicinale ayurvédique centenaire) à l’entreprise californienne qui revendique un microbe d’un lac kényan produisant une enzyme pouvant être utilisée pour conférer aux jeans un aspect bleu pâle… en passant par l’entreprise semencière du Colorado qui obtient un brevet sur la variété de haricot Enola, une variété jaune mexicaine. Si le brevet a finalement été annulé en 2009, il aura permis à l’entreprise de bloquer les importations américaines de tout haricot mexicain qui avait à peu près la même couleur, au détriment des agriculteurs mexicains qui, en premier, avaient fait co-évoluer le haricot jaune !
Une coalition d’ONG fait annuler un brevet sur un géranium
Parfois, les communautés et les ONG des pays en développement ont riposté avec succès. Schwabe, une entreprise allemande, a breveté des extraits d’un géranium Sud Africain (Pelargonium sidoides) utilisés dans le Umckaloabo, un produit populaire et efficace pour traiter le rhume. Une ONG étasunienne l’a traqué sur les étagères des pharmacies de Berkeley en Californie et, suspectant qu’il s’agissait d’un cas de biopiraterie, a envoyé des échantillons à des partenaires à Johannesbourg. Les ONG sud-africaines ont contacté des praticiens de médecine traditionnelle dans la région Est du Cap, d’où provient le géranium. Puis ont fait appel à des ONG européennes et organisé une contestation judiciaire contre les revendications de Schwabe, la contraignant finalement à renoncer à son brevet et à revoir certaines de ses pratiques.
Mais attaquer les brevets biopirates un par un a une limite. C’est un exercice coûteux et chronophage pour les organisations de la société civile mais aussi pour les gouvernements, comme ceux de l’Inde et du Pérou, qui attaquent certains brevets américains, européens et autres menaçant leurs ressources génétiques et savoirs traditionnels.
Les pays en développement ont tenté d’entraver et de mettre un terme à la biopiraterie à travers les accords internationaux. La Convention sur la diversité biologique et son Protocole de Nagoya posent le principe que les entreprises ou autres qui utilisent des semences et d’autres ressources génétiques doivent démontrer qu’elles ont obtenu le consentement préalable et informé des pays d’où proviennent ces ressources, et qu’existent des conditions acceptées d’un commun accord concernant le partage des bénéfices découlant de leur utilisation.
Mais en Europe, la mise en œuvre du Protocole de Nagoya est minimale et il reste de nombreuses failles (voir Biopiraterie : flou sur les règles internationales). Et les États-Unis, l’un des pays qui pratique le plus la biopiraterie, restent en dehors de l’accord.
Cosmétiques Clarins : la palme du mensonge
Un cas qui a récemment retenu l’attention est celui de l’entreprise française Clarins et son brevet sur la plante africaine harungana. Clarins a remporté le prix Captain Hook pour la biopiraterie en 2016, un « honneur » donné par les organisations de la société civile pour des cas particulièrement inacceptables.
L’entreprise privée dont le siège est à Paris a déposé un brevet sur l’utilisation de tout extrait de l’arbre d’harungana pour traiter une grande variété d’affections de la peau. Mais ceci ne semble pas être une invention française du tout. Des praticiens africains de médecine traditionnelle, notamment malgaches, utilisent des extraits d’harungana sur la peau depuis des centaines d’années. En atteste la littérature scientifique occidentale depuis les années 1880 au moins.
Or les revendications du brevet de Clarins sur l’harungana sont très larges et portent sur l’utilisation de la plante pour un grand nombre d’usages – souvent associés au vieillissement. Les revendications ne se limitent pas à un extrait spécifique ou composant particulier mais couvrent tout extrait d’harungana. Aucun concurrent ne peut donc commercialiser un produit d’harungana pour les utilisations revendiquées dans le brevet de Clarins.
Outre la revendication sur ce savoir traditionnel, les organisations de la société civile sont outrées de voir Clarins qualifier son commerce de l’harungana comme « équitable ».
L’analyse des données publiées sur le commerce de Clarins avec les producteurs malgaches d’harungana révèle un partage extrêmement inéquitable des bénéfices résultant de l’utilisation de la plante africaine. Selon l’association française Jardins du Monde, qui travaille étroitement avec Clarins, l’entreprise ne paie les villageois malgaches qu’environ 2 € par kilo de feuilles séchées d’harungana. Seule une petite partie de l’extrait des feuilles va dans chaque bouteille des produits harungana de Clarins, qui sont vendus à plus de 100 € les 30 ml. Pendant que Clarins profite généreusement de son produit « avec la feuille d’Harungana exclusive de Clarins », les versements qu’elle a faits jusqu’à présent à Madagascar en 2014 et 2015 représentent à peu près 0,38 € pour chacun des 5 000 résidents de la ville malgache où les feuilles d’harungana sont récoltées. Et même cet argent-là est contrôlé par Jardins du Monde : il n’est pas versé directement aux résidents mais mis sur un compte contrôlé par l’association, qui doit approuver les dépenses.
Tout consommateur qui pense rendre un grand service aux africains en achetant de la crème à l’harungana de Clarins semble donc avoir été induit en erreur.
Du vol physique au vol de données
Alors que la société civile s’est organisée pour attaquer des brevets individuellement et qu’ont été mis en place des lois et règlements sur la base du Protocole de Nagoya, beaucoup reste à faire en matière de biopiraterie. Une préoccupation grandissante est que l’information sur la séquence génétique, stockée dans des énormes bases de données, devienne utile pour les biopirates qui peuvent s’en servir et même breveter l’information sans aucune autorisation du pays et des peuples d’où elle provient (voir Biopiraterie : flou sur les règles internationales). Ainsi, si le débat sur la biopiraterie a plus de 25 ans, des nouveaux problèmes de piraterie – et de nouvelles solutions – continuent d’apparaître.