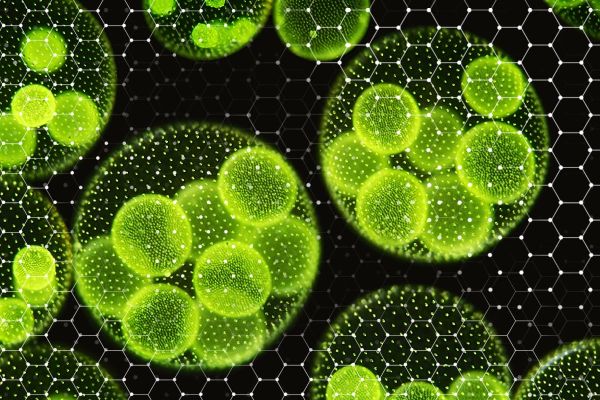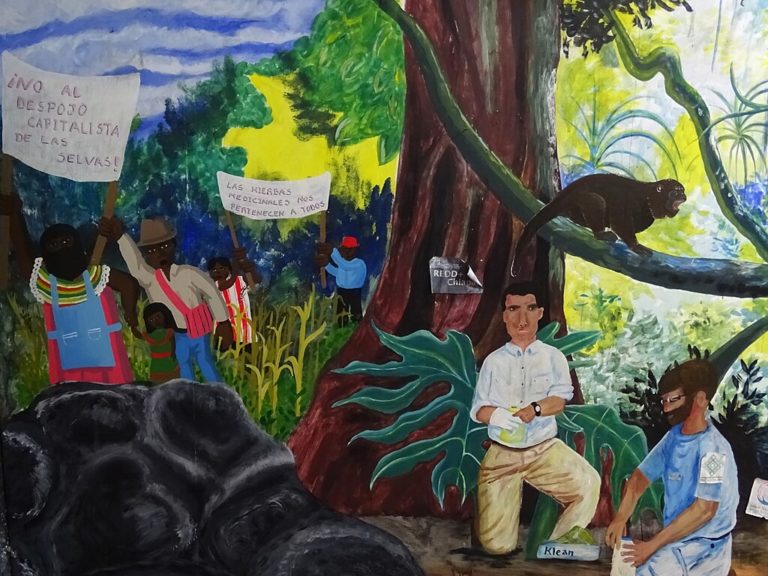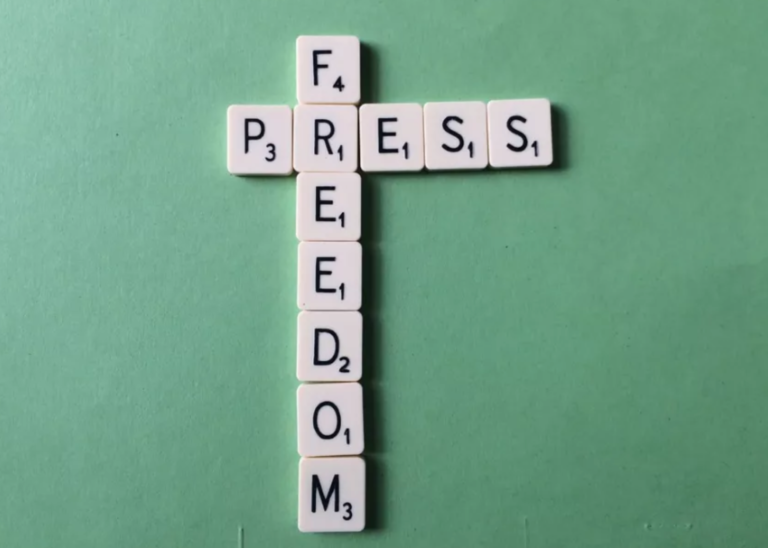Changer la réglementation pour renforcer les brevets ?

Alors que les OGM transgéniques ont été un relatif échec commercial, la mise sur le marché des « nouveaux » OGM est-elle réellement l’objectif des multinationales ? Ou faut-il regarder ailleurs ? Une possible réponse a été apportée par un semencier français : « l’activité foisonnante qu’on trouve autour des NBT est plus des dépôts de brevets, qui sont une menace pour les semenciers de taille intermédiaire ou moyenne et petite et les agriculteurs, qu’autre chose ».
Commercialisés depuis le milieu des années 1990, les OGM transgéniques couvrent actuellement moins de 4 % des surfaces agricoles mondiales [1]. Ces plantes étaient censées résoudre la faim dans le monde, permettre de lutter contre le changement climatique, de réduire l’usage des pesticides… Mais aucune de ces promesses n’a été tenue et leur commercialisation ressemble fort à un échec.
Pas de commercialisation… mais des brevets !
Pour les multinationales, cet « échec » incombe notamment à des réglementations qui seraient trop contraignantes et onéreuses. Elles s’emploient, depuis une dizaine d’années, à persuader les dirigeants politiques que la nouvelle génération de plantes génétiquement modifiées pourront, enfin, apporter les avantages économiques, environnementaux et sociaux tant espérés pour relever les défis auxquels l’Humanité est confrontée… pourvu que ces plantes OGM ne soient pas réglementées comme OGM.
Pourtant, l’adoption d’une réglementation plus souple, comme c’est le cas aux États-Unis, ne se traduit pas par une commercialisation massive des OGM issus des nouvelles techniques de modification génétique [2]. Ce constat soulève donc la question des facteurs non-réglementaires expliquant l’absence de mise sur le marché.
L’intérêt commercial des OGM obtenus par de nouvelles techniques pourrait bien résider dans l’économie des brevets. Les OGM seraient-ils développés sans la possibilité de breveter les informations génétiques et les produits associés ? En effet, l’essor de ces nouvelles techniques s’est surtout traduit, jusqu’à présent, par une hausse des demandes de brevets et par la conclusion d’accords de licence. Ces demandes sont déposées principalement par quelques multinationales des biotechnologies. En tête se trouvent Corteva et Bayer, lesquelles détiennent déjà à elles deux 40 % du marché des semences au niveau mondial. Un constat qui met à mal le discours sur l’accessibilité des nouvelles techniques aux petites et moyennes entreprises (PME), tenu par la Commission européenne et repris sans discernement par certains journalistes.
En février 2023, les semenciers français RAGT et Florimond Desprez ont d’ailleurs exprimé leur crainte qu’une dérèglementation des OGM issus des nouvelles techniques ouvre la voie à la diffusion incontrôlée des brevets associés et menace les semenciers et les agriculteurs.
L’enjeu de la transparence
Pourquoi quelques multinationales se battent-elles pour obtenir la dérèglementation des OGM et ainsi la fin de leur étiquetage ? Aucune obligation n’étant faite aux entreprises de lister les plantes dans lesquelles leurs brevets se trouvent, l’étiquetage OGM imposé par la réglementation européenne est, à ce jour, la source d’information la plus fiable. Caricaturalement, une étiquette OGM indique la présence de brevets et inversement. Or, la proposition de déréglementation de la Commission européenne vise à masquer le lien entre le brevet et le produit commercialisé pour un nombre important d’OGM issus des nouvelles techniques, ce qui engendrerait d’importantes incertitudes juridiques pour les sélectionneurs et les agriculteurs et renforcerait la position des détenteurs de brevets.
Dans un rapport de 2021, la Commission européenne a reconnu que, tout en étant bénéfiques pour l’innovation, les brevets « (ainsi qu’une forte concentration d’entreprises) peuvent également constituer une barrière à l’entrée sur le marché pour les PME et limiter l’accès aux nouvelles technologies et au matériel génétique, par exemple pour les sélectionneurs et les agriculteurs » [3]. Pourtant, la Commission prévoit de publier seulement en 2026 un rapport sur « l’incidence que le brevetage des plantes et les pratiques correspondantes en matière de licences et de transparence ont sur l’innovation en ce qui concerne la sélection végétale ».
[1] Selon les dernières données de l’International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (Isaaa), 2019. Nos propres recherches montrent que les surfaces transgéniques n’ont pas augmenté depuis 2019, voire ont diminué dans l’Union européenne.
[2] , « Aux États-Unis, une décennie de promesses sans commercialisation », Inf’OGM, 31 octobre 2023.
[3] Commission européenne, « Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16 », avril 2021.