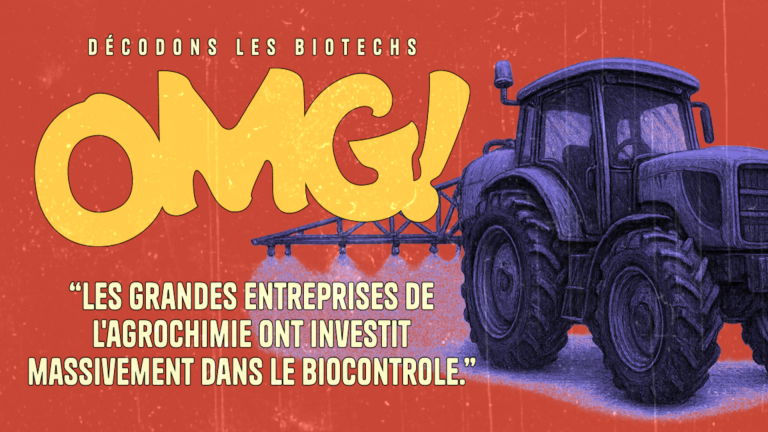Actualités
Objet de toutes les convoitises, les algues OGM existent-elles vraiment ?
Les algues sont les invités surprises de la proposition de déréglementation de la Commission européenne. Quelles utilisations sont faites de ces organismes par l’industrie ? Dans quels pays sont-elles produites ? Surtout, quelles sont les modifications génétiques effectuées pour quelles commercialisations ? Cet état des lieux est important car, pour la Commission européenne, leur déréglementation – comme celle des autres OGM végétaux – se justifierait par les « connaissances […] liées à l’innocuité » de ces OGM. Ces algues OGM n’existent pourtant pas, les protocoles techniques n’étant pas maîtrisés…

Les algues, quand elles seront génétiquement modifiées par de nouvelles techniques, pourraient bien ne plus être soumises aux règles encadrant les OGM, comme les plantes terrestres. Tel est le souhait de la Commission européenne, qui l’a proposé en juillet 2023 par le biais de deux termes latinsi insérés dans la description des organismes couverts pas sa proposition de déréglementation. Elle écrivait en effet que « sur la base des connaissances scientifiques et techniques actuelles, notamment en ce qui concerne les aspects liés à l’innocuité, le présent règlement devrait être limité aux OGM qui sont des végétaux, c’est-à-dire des organismes appartenant aux groupes taxonomiques Archaeplastida ou Phaeophyceae ».
Le présent article dresse les grandes lignes des utilisations commerciales actuelles des algues et des projets de modification génétique existants. La terminologie utilisée – algues, macroalgues, microalgues – est faite selon une utilisation telle que trouvée dans différents rapports. Quant à savoir si toutes ou parties des familles d’algues décrites ci-dessous sont couvertes par la proposition de la Commission européenne, la question reste ouverte et fera l’objet d’un futur article. Mais, quoiqu’il en soit, au regard des difficultés à modifier génétiquement les algues, inclure ces dernières dans la proposition de déréglementation apparaît pour le moins prématuré.
Des algues rouges, vertes, brunes, macro, micro…
Que cela soit sous forme unicellulaire (microalgues) ou pluricellulaires (macroalgues), les algues font depuis peu l’objet d’une véritable convoitise à l’international comme en Europe, avec notamment le plan pour la bioéconomie bleue initiée par la Commission européenne en 2022. Un an auparavant, en 2021, l’Organisation des Nations-Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) publiait un état des lieuxii du domaine sur base de données chiffrées à date de 2019. Cette année là, la production mondiale totale d’algues était de près de 36 millions de tonnes, dont la quasi totalité était des macroalgues (99,84%). Très largement le fait de pays asiatiques, comptant pour plus de 97 % de cette production, elle était alors peu développée en Europe (0,8 % de la production mondiale), en Afrique (0,41%) et sur les deux continents américains (1,36%).
Récoltées en mer ou cultivées dans des installations maritimes, proches des côtes, les macroalgues peuvent être nommées rouges, vertes ou brunes. Les algues brunes comptent pour près de 50 % de la production mondiale d’algues et sont utilisées dans l’alimentation humaine (comme la soupe au Kombu ou les salades de Wakamé) ou animale (pour les ormeaux notamment). Elles sont également sources de diverses substances utilisées en alimentation humaine, animale, comme engrais en agriculture, en pharmacie ou encore comme emballage. Les deux principales algues brunes utilisées sont Laminaria et Undaria.
Les algues rouges constituent l’autre moitié de la production mondiale. Elles sont utilisées en alimentation humaine pour produire de l’Agar ou en alimentation animale (ormeaux). L’algue rouge Kappaphycus est utilisée pour obtenir des molécules utilisées par l’industrie alimentaire comme non alimentaire. Porphyra est une source d’aliments pour des soupes ou des sushis. Les principales sont Kappaphycus, Gracilaria et Porphyra.
Enfin, les algues vertes sont également utilisées, bien qu’en moindre quantité par rapport aux algues brunes et rouges, avec un peu moins de 17 000 tonnes par an. Ces algues sont utilisées comme aliments (salade par exemple), mais également pour nourrir des ormeaux, comme engrais agricole, en pharmacie, cosmétique ou pour le traitement de déchets.
De leur côté, les microalgues, nommées ainsi car microscopiques, peuvent être trouvées aussi bien dans des eaux maritimes que douces. Plusieurs sont utilisées par l’industrie, la FAO donnant pour exemples la chlorelle, les diatomées, Nannochloropsis, Schizochytrium, Crypthecodinium ainsi que la spiruline, qui est en fait une cyanobactérie « habituellement classée comme microalgue ». En 2019, plus de 56 000 tonnes étaient produites à l’internationale, dont la très très grande majorité était de la spiruline. La Chine, avec près de 55 000 tonnes, est le principal producteur de microalgues. Les utilisations commerciales de ces algues, telles que listées par la FAO, concernent les domaines de l’alimentation humaine (sous forme de poudre de chlorelle ou spiruline par exemple), de compléments alimentaires (carotènes, astaxanthine…), de la cosmétique (avec des polysaccharides ou des colorants). Des projets d’utilisation de microalgues pour « traitement des eaux usagés, repas et huiles d’algue, séquestration de carbone et [production d’]agrocarburants » sont également cités comme des marchés en expansion rapide dans un futur proche.
Des ambitions industrielles pleines de « promesses »
Outre leur utilisation en alimentation humaine, animale ou comme fertilisants en agriculture, les algues intéressent également les industries du fait de leur capacité métabolique pour capter les composés à base d’azote ou de phosphore. Ces capacités les rendent convoitables pour être utilisées comme agent de dépollution ou de captation du carbone. Leur utilisation comme complément alimentaire pour les animaux est également présentée comme pouvant potentiellement participer à une réduction des émissions de méthane.
Ces utilisations feraient néanmoins l’objet de plusieurs limites pour les industriels. Parmi ces limites, la FAO liste par exemple la compétition d’accès à l’espace côtier avec les zones urbaines, les activités de pêche ou d’élevage de poissons, la pollution des eaux environnantes ou encore l’augmentation de la température des océans. La « qualité » des souches d’algues est également listée dans les limites rencontrées. La « détérioration des environnements de culture comme l’augmentation de la température des océans ou des maladies plus fréquentes et plus sévères » participeraient à cette perte de qualité. Une mauvaise gestion ou des contraintes lors de la production de souches interviennent également, menant à « une dégénérescence des caractéristiques et une perte de la valeur agronomique des types cultivés ». Mais la FAO cite comme piste de solution l’amélioration génétique de ces souches ! Elle écrit ainsi que « les technologies d’amélioration génétique comme la sélection de souches, l’amélioration sélective, l’hybridation, la micropropagation (également connue sous le nom de culture de tissus) et les marqueurs génétiques peuvent aider à améliorer la qualité des souches et l’efficacité des productions ».
Justement, quelles sont ces utilisations de « technologies d’amélioration génétique », et plus particulièrement celles de modification génétique, même si elles ne sont pas spécifiquement nommées par la FAO ? Deux articles scientifiques nous renseignent plus avant sur l’état actuel de la recherche. Or, un des deux articlesiii prévient dès le début que, en 2019, lorsque des chercheurs ont « regardé les génomes d’une centaine de micro et macroalgues, ils ont découvert que plus de 50 % des gènes remplissaient une fonction inconnue » ! S’ils précisent que l’étude de mutants « apparus naturellement ou par induction » a permis de démarrer des recherches pour associer des fonctions à des gènes, ils ajoutent qu’en 2024, date de publication de leur article, « pour la plupart de ces mutants, les mutations responsables [du changement de caractéristiques] restent inconnues ».
Des microalgues génétiquement modifiées disséminables ?
Pour ces microalgues, l’article scientifiqueiv de chercheurs autrichiens et allemands, publié en juin 2024, fait le tour des projets de modification génétique chez les microalgues, que ce soit par transgénèse ou à l’aide des nouvelles techniques de modification génétique. Sur base d’une bibliographie scientifique et la lecture de divers rapports (bibliographie grise), les auteurs ont identifié 36 projets de modifications génétiques de microalgues pouvant impliquer une dissémination dans l’environnement autres que via des milieux confinés (tels que des fermenteurs pour les microorganismes). Le détail des techniques utilisées n’étant pas fourni, il n’est pas possible d’identifier les projets impliquant de nouvelles techniques et donc donnant potentiellement des OGM que la Commission souhaiterait déréglementer. Néanmoins, le panorama reste impressionnant à observer. Parmi ces 36 projets (cf. tableau ci-dessous), seuls quatre sont qualifiés de « développement pour le marché » et ne concernent que des algues transgéniques, donc des OGM qui resteraient encadrés malgré la déglementation envisagée par la Commission européenne. Les auteurs précisent en effet n’avoir identifié aucune algue modifiée par nouvelles techniques de modification génétique.
D’après la recherche effectuée, la majorité des projets de modification génétique de microalgues concerne le domaine des agrocarburants. Sur les 36 projets (cf. tableau ci-dessous), 20 sont en effet conduits pour induire chez des microalgues des caractéristiques intéressantes pour ce secteur, dont 3 sont en phase de développement commercial. 7 projets relèvent eux du biocontrôle avec, par exemple, des modifications génétiques opérées pour pouvoir utiliser les algues OGM comme agent de vaccination, notamment dans les cultures de crevettes ; ou encore l’expression d’un transgène codant un ARN interférent qui se révélera insecticide quand des larves d’Aedes Aegypti se nourriront de ces algues. 5 autres projets relèvent eux de ce qui est promu comme une décontamination de l’environnement en utilisant des organismes vivants. 3 projets relèvent quant à eux de la captation de carbone ou de la production d’un additif pour l’alimentation animale.
Comme le soulignent les auteurs de l’article, ces 36 projets sont des projets voués à donner lieu à une commercialisation et production et/ou dissémination de microalgues OGM dans l’environnement. S’il n’est pas possible, comme ils l’indiquent, de savoir si ces production et dissémination se feront dans des lieux confinés ou ouverts, cette dernière possibilité n’est pas exclue.
Quid des macroalgues OGM ?
C’est un autre article scientifiquev, publié en 2024 également, qui renseigne plus spécifiquement l’utilisation de nouvelles techniques de modification génétique, chez les macroalgues cette fois. Une utilisation qui en est clairement à ses balbutiements sur de rares macroalgues, comme l’expliquent les auteurs.
Il en est ainsi de la transgénèse elle-même. Cette technique, utilisée sur les macroalgues, n’a permis que des expressions transitoires des séquences transgéniques, les auteurs ajoutant que « peu de rapports décrivent des transformations stables ». Parmi les difficultés rencontrées, sont notamment décrites la capacité des algues à éteindre l’expression des transgènes insérés et la méconnaissance de séquences génétiques impliquées dans une activité de régulation.
Pour ce qui des nouvelles techniques de modification génétique, la situation n’est pas plus avancée, « les rapports de succès d’édition du génome [étant] très rares, autant que ceux de protocoles de transformation stable ». Au jour de publication de leur article, les auteurs notent que seul l’outil Crispr/Cas a été testé sur les macroalgues. Ils ont listé trois articles ayant rendu compte de réussite sur des algues brunes et vertes, mais ces protocoles ne sont pas passés par une étape de transgénèse, ils ont directement injecté le complexe protéique Crispr/Cas. Une approche qui s’explique par la contrainte de ne pas réussir à avoir une expression stable de transgènes chez ces organismes. Surtout, les auteurs précisent que ces trois articles constituent des « preuves de concept ». Autrement dit, ils permettent de savoir qu’un protocole de modification génétique utilisant l’outil Crispr/Cas directement injecté est possible. Mais « plus de recherches sont nécessaires pour augmenter l’efficacité de mutation et élargir l’application des systèmes de mutagénèse dirigée chez les macroalgues ».
A lire les besoins listés par les auteurs pour parvenir à une éventuelle possibilité d’utilisation réussie de techniques de modification génétique sur les macroalgues, une telle perspective semble encore éloignée. Les chercheurs nécessitent en effet d’avoir « plus de génomes d’espèces de macroalgues […] disponibles ». Des espèces qui devraient, « idéalement, avoir des cycles de vie pouvant être complets en laboratoire pour permettre à des protocoles de transformation génétique d’être conduits ». Une autre limite à résoudre est le nombre très restreint – un seul en réalité – de séquence génétique utilisable comme marqueur (l’équivalent des gène de résistance aux antibiotiques introduits sous forme transgénique pour être utilisés comme marqueur chez les végétaux). Les méconnaissances sur les interactions entre séquences génétiques sont également un problème. Enfin, voire surtout, les auteurs soulignent qu’une limite importante est la très faible efficacité de mutagenèse observée. Leur conclusion est dès lors assez claire, les auteurs considérant que « le domaine de l’édition du génome évoluant rapidement, de nouveaux outils […] pourraient offrir des bénéfices en termes d’efficacité, d’adaptation et de précision ».
Pour résumer, la modification génétique en laboratoire de macroalgues est une approche encore assez éloignée d’une réalité commerciale. D’après les auteurs de l‘article sur les macroalgues publié en 2024, seules 3 espèces de macroalgues, les deux algues brunes Ectocarpus spp et Saccharina Japonica, et l’algue verte Ulva Prolifera, ont fait l’objet d’un article de recherche fondamentale montrant une possible modification du génome par le biais de « nouvelles techniques ». Aucun article n’a encore rapporté une telle possibilité pour des algues rouges. Pourtant, la Commission européenne inclut ces organismes dans sa proposition de déréglementation faite en juillet 2023…
Tableau 1 : Modifications génétiques de microalgues (selon Miklau et al.iv)
| Avancement | Organisme GM | Domaine | Caractéristique |
|---|---|---|---|
| Recherche de base | Chlamydomonas reinhardtii | Décontamination | Captation de métal (cuivre) |
| Chlamydomonas reinhardtii | Décontamination | Captation de métal (Nickel) | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Séquestration de carbone | Efficacité de captation du CO2 | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Biosynthèse améliorée de triacylglycerol | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Contenu en lipide accru | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Sécrétion d’acide gras | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Contenu en lipide accru | |
| Chlamydomonas sp. | Agrocarburants | Accumulation de lipides | |
| Fistulifera solaris (m) | Agrocarburants | Production de lipide accrue | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Modification du gène de CrACCase | |
| Nannochloropsis salina | Agrocarburants | Croissance accrue | |
| Phaeodactylum tricornutum | Agrocarburants | Contenu en lipide accru | |
| Chlamydomonas reinhardtii i | Agrocarburants | Production d’hydrogène accrue | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Production d’hydrogène accrue | |
| Recherche avancée | Chlamydomonas reinhardtii | Décontamination | Décontamination d’herbicide (Penoxsulam) |
| Chlamydomonas reinhardtii | Décontamination | Captation de métal (Cadmium) | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Décontamination | Décontamination de Cyanide | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Biocontrôle | Développement et mue d’Aedes Aegypti bloqués | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Biocontrôle | Vaccin oral pour crevettes cultivées | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Biocontrôle | Production de peptides antimicrobien | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Biocontrôle | Expression d’ADN double brin antiviral pour crevettes | |
| Chlorella sp. | Biocontrôle | Production de peptides antimicrobiens | |
| Nannochloropsis oculata | Biocontrôle | Production d’antibiotiques bovins | |
| Nannochloropsis oculata | Additif alimentation animale | Production d’hormone de croissance de poisson | |
| Dunaliella salina | Biocontrôle | Expression d’une protéine virale | |
| Chlorella sp. | Séquestration de carbone | Captation de carbone | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Production d’acide gras modifiée | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Production accrue de lipide et d’acide gras | |
| Species not specified | Agrocarburants | Production d’hydrogène à partir d’eau | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Production accrue de lipides | |
| Chlamydomonas reinhardtii | Agrocarburants | Contenu accru en lipide | |
| Phaeodactylum tricornutum | Agrocarburants | Contenu accru en lipide | |
| Développement commercial | Chaetoceros gracilis (m) | Confinement | Utilisation de phosphite comme unique source de phosphore |
| Scenedesmus dimorphus | Agrocarburants | Production accrue d’acide gras | |
| Nannochloropsis oceanica | Agrocarburants | Contenu d’acide gras modifiée | |
| Prototheca morimorfis | Agrocarburants | Triglyceride |
i Eric Meunier, « Algues OGM : une matière première en devenir pour l’industrie », Inf’OGM, 4 février 2025.
ii Cai, J. et al., « Seaweeds and microalgae: an overview for unlocking their potential in global aquaculture development. FAO Fisheries and Aquaculture Circular », No. 1229, Rome, FAO.
FAO, « Global seaweeds and microalgae production, 1950–2019. WAPI factsheet to facilitate evidence-based policy-making and sector management in aquaculture », juin 2021.
iii De Saeger Jonas et al., « Genome editing in macroalgae: advances and challenges », Frontiers in Genome Editing, vol. 6, 2024.
iv M. Miklau et al., « Horizon scanning of potential environmental applications of terrestrial animals, fish, algae and microorganisms produced by genetic modification, including the use of new genomic techniques », Frontiers in Genome Editing, juin 2024.
v De Saeger Jonas et al., « Genome editing in macroalgae: advances and challenges », Frontiers in Genome Editing, vol. 6, 2024.