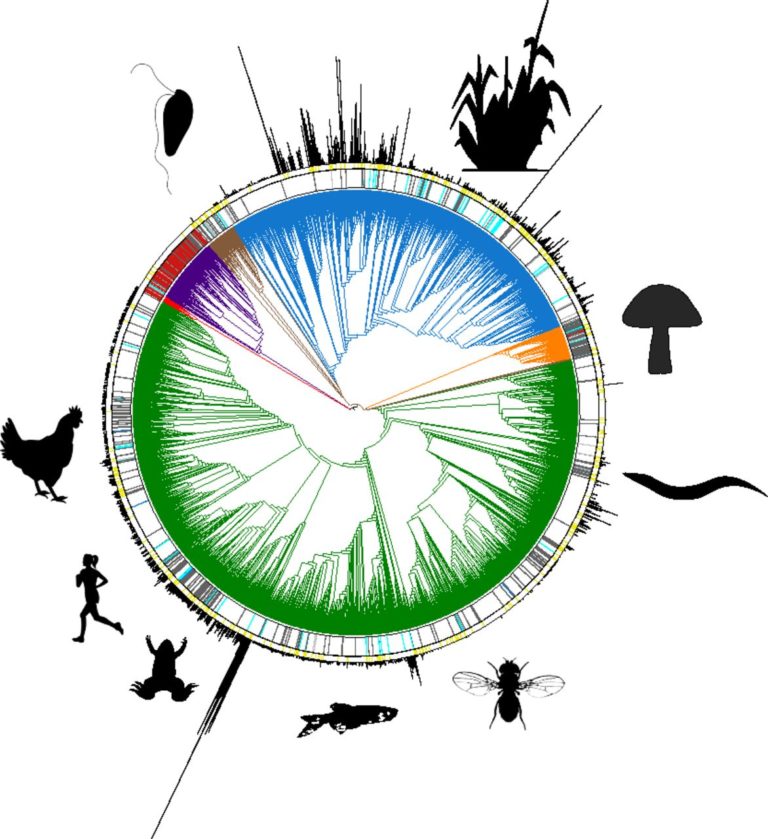Actualités
COP – MOP 2 à Montréal : quel bilan ?
La deuxième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties du Protocole de Carthagène sur la biosécurité (COP-MOP) s’est tenue du 29 mai au 3 juin 2005, à Montréal, Canada. Forts du succès de la première COP-MOP (février 2004, Kuala Lumpur, Malai-sie), les pays Parties au Protocole étaient venus à Montréal avec la volonté ferme d’avancer sur la mise en œuvre effective du Protocole. Mais pour nombre d’entre eux qui sont partisans de règles strictes, le résultat de la COP-MOP 2 n’a pas été à la hauteur des attentes. En raison de l’absence d’accord sur les modalités concrètes d’identification des organismes vivants modifiés destinés à l’alimentation humaine ou animale ou à la transformation (OVM-AHAT), un article clé du Proto-cole, la COP-MOP 2 apparaît comme un échec. De plus, peu d’avancées majeures ont été faites sur les autres sujets en discussion. Le Protocole semble donc en panne. A l’origine de cette panne, l’intransigeance du Brésil et de la Nouvelle-Zélande et l’éclatement du bloc Union européenne – Afrique – Asie/Pacifique dans les derniers moments cruciaux de la négociation.
Rappel de l’ordre du jour
Plusieurs nouveaux sujets étaient à l’ordre du jour de COP-MOP 2 : la notification (article 8), l’évaluation et la gestion des risques (articles 15 et 16), les considérations socio-économiques (arti-cle 26. 2) et la participation du public et sensibilisation du public (article 23. 1a). Une décision était également très attendue sur les modalités d’application de l’article 18. 2a relatif à l’identification des OVM-AHAT. La COP-MOP 2 était également l’occasion de faire un bilan des activités mises en place ou rendues opérationnelles à Kuala Lumpur (fonctionnement du Centre d’échange sur la prévention des risques biotechnologiques, Comité de respect des obligations, état des activités de création de capacités, coopération avec les autres organisations et conventions pertinentes, ques-tions financières et mécanisme de financement) afin de réajuster, si besoin, les orientations prises. Enfin, la COP-MOP 2 devait examiner le rapport du groupe spécial d’experts sur la responsabilité et la réparation qui se tenait la semaine précédent sa réunion du 25 au 27 mai. Ces différents points ont été traités soit en plénière, soit en groupe de travail, voire dans des groupes de négociations plus restreints pour les points les plus sensibles (groupe de contact, groupe des Amis du Président).
Ce qu’il faut retenir
> Impasse sur l’identification des OVM-AHAT : bien qu’une décision devait être prise d’ici sep-tembre 2005 d’après les termes du Protocole, aucun accord n’a été obtenu ;
> Responsabilité, un processus qui s’enclenche doucement : le groupe spécial d’experts sur la responsabilité et la réparation a tenu sa première réunion du 25 au 27 mai. Si le rapport transmis à la COP-MOP 2 pour examen est bien étoffé, certains délégués sont préoccupés par la lenteur des discussions. La deuxième réunion du groupe initialement prévue en 2005 est en effet repor-tée à février 2006 ;
> Des avancées à petits pas sur les « nouveaux » sujets : des avancées ont été faites mais elles restent minimes. Les décisions sur les questions de fond sont effectivement remises à plus tard (à la 3e, 4e ou 5e COP-MOP). Les pays Parties, non Parties et les organisations « compétentes » doivent en attendant soumettre leurs expériences nationales et points de vue au Secrétariat exé-cutif du Protocole ;
> La nécessité de pallier des dysfonctionnements dans la mise en œuvre : cela concerne le Centre d’échange et le fichier d’experts. Le bilan depuis la COP-MOP 1 n’est pas complètement posi-tif. Des améliorations sont nécessaires pour pallier les dysfonctionnements identifiés dans ces domaines.
> Des bailleurs de fonds soucieux d’assurer une allocation efficiente des ressources : les réponses des bailleurs de fonds (pays donateurs ou institutions multilatérales) apparaissent timides par rapport aux nombreuses demandes des pays en développement concernant la création de capa-cités ;
> Des questions émergentes : au cours des discussions, deux questions sont apparues particuliè-rement importantes, celles des droits et des obligations des pays de transit et du rôle de la re-cherche publique dans les négociations. Elles pourraient prendre une place croissante dans les débats des prochaines COP-MOP ;
> Des coopérations à géométrie variable : les pays continuent de s’opposer en particulier sur la question des rapports avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Certains sont scepti-ques quant à un rapprochement du Secrétariat du Protocole avec celui de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Une coopération doit s’enclencher avec les or-ganisations internationales compétentes intervenant dans les domaines du transport et de l’emballage, en vue de l’examen de l’article 18. 3 sur l’élaboration de normes communes sur l’identification, la manipulation, le transport et l’emballage des OVM ;
> De la règle du consensus au droit de veto ? : la règle du consensus qui est appliquée dans le système des Nations Unies montre ses limites. Paradoxalement, elle laisse le champ libre au droit de veto, c’est-à-dire à la possibilité pour chaque pays membre de bloquer les négociations s’il estime que ses intérêts ne sont pas satisfaits. L’impasse sur l’identification des OVM-AHAT en et les conflits sur les procédures de vote au sein du Comité de respect des obligations en sont une parfaite illustration ;
> Le groupe de Miami (Argentine, Australie, Canada, Chili, Etats-Unis, Uruguay) et ses alliés sont les grands gagnants de la COP-MOP 2, à la différence du bloc Union européenne – Afrique – Asie/Pacifique qui en sort affaibli.