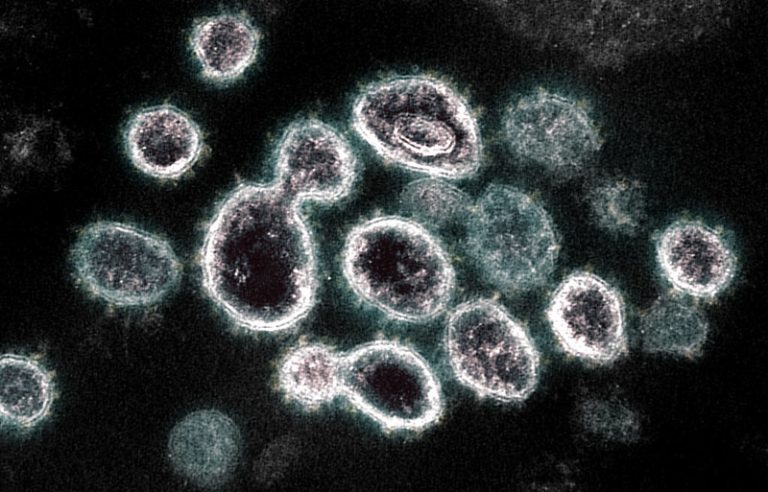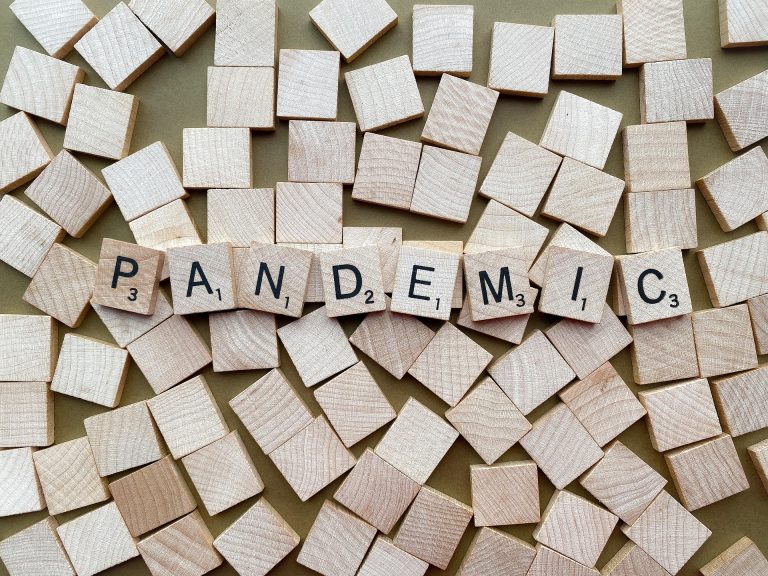Perceptions publiques des biotechnologies agricoles

L’utilisation des OGM dans l’agriculture et l’alimentation est devenue un des sujets les plus controversés dans les sociétés contemporaines, et particulièrement en Europe. D’un côté, les promoteurs des biotechnologies agricoles pensent que la controverse publique actuelle sur les OGM en Europe empêche le développement et la commercialisation d’un nouveau domaine technologique qu’ils considèrent être d’une importance économique stratégique pour l’Europe. De l’autre côté, les acteurs qui croient que les OGM entraînent des impacts inacceptables pour l’environnement, la santé et la société, continuent de penser que leurs inquiétudes n’ont pas été prises en compte. Le public est en quelque sorte coincé entre les deux. Que pensent les Européens à propos de l’utilisation des OGM dans l’agriculture et l’alimentation ? Quelles sont leurs attentes et inquiétudes ? Comment forment-ils leurs opinions lorsqu’ils sont confrontés à une nouvelle technologie ? Comment perçoivent-ils cette question dans le contexte général de la modernisation et des changements de styles de vie ?
Depuis quelques années les biotechnologies agricoles ont été soumises à de nombreuses investigations, consultations et débats publics. Pourtant la plupart des protagonistes ne sont pas satisfaits. Le besoin de comprendre les réactions du public n’a jamais été aussi pressant. Mais comprendre comment les décideurs et les autres acteurs impliqués conçoivent les réactions du public est aussi essentiel.
Une équipe de recherche provenant de cinq pays européens (Allemagne, Espagne, France Italie et Royaume-Uni) et dirigée par le professeur Brian Wynne a été chargée par la Commission Européenne de mener une étude approfondie sur les attitudes du public à propos des biotechnologies agricoles. Pour obtenir une impression fidèle et compréhensive de ses attitudes, l’équipe a choisi la méthode des groupes de discussion (focus groups), une méthode de recherche empirique qui donne des résultats particulièrement pertinents sur les facteurs sous-jacents qui déterminent les attitudes du public. Au total, 55 groupes de discussion ont été organisés dans les 5 pays. Les chercheurs ont aussi réalisé des entretiens avec les acteurs clés et observé des réunions réunissant diverses parties prenantes du débat.
Le public incompris
La conclusion principale de cette étude est que la plupart des acteurs dans le débat sur les OGM ont mal compris les réactions du public, et que ceci représente une des causes fondamentales de l’impasse actuelle de ce débat. Presque toutes les opinions courantes à propos des perceptions de ’l’homme de la rue’ s’avèrent être de simples mythes.
L’étude identifie et décrit dix « mythes » à propos des réactions du public aux OGM qui sont largement partagés par les acteurs, et démontre comment les résultats des groupes de discussion les remettent en cause :
Les représentations des réactions du public aux OGM qui circulent parmi les décideurs sont typiquement formulées soit en termes d’un manque de connaissances – entraînant des initiatives pour l’éducation du public – soit d’inquiétudes ’éthiques’ ’non-scientifiques’ – entraînant la création de comités d’éthiques ou de consultations publiques sur l’acceptabilité sociale des OGM. Cette étude démontre que ces représentations dominantes du public ne captent pas l’essence des inquiétudes du public et ne reconnaissent pas les facteurs socio-culturels et institutionnels qui les déterminent. La recherche présentée ici révèle une réalité plus complexe, dans laquelle les distinctions habituelles faites entre ’risque réel’ et ’risque perçu’, entre ’risque’ et ’éthique’, ou entre dimensions scientifiques et non-scientifiques sont estompées. Les résultats de l’étude PABE éclairent la dynamique des inquiétudes du public : leurs sources se trouvent, en partie, dans les représentations erronées du public dans les milieux officiels.
Même si les participants ont peu de connaissances précises sur les dimensions scientifiques de la transgénèse et sur les évolutions de la recherche, la réglementation et la commercialisation dans ce domaine, ce manque de connaissances n’explique pas leurs réactions aux biotechnologies agricoles. Les inquiétudes exprimées par les participants dans les groupes de discussion étaient surtout fondées sur des connaissances profanes et empiriques sur le comportement précédent des institutions responsables du développement et de la réglementation des innovations technologiques et des risques, appuyées par de nombreuses expériences collectivement partagées, qui leur semblaient insatisfaisantes à bien des égards. Dans ce contexte, l’affaire de la vache folle n’est pas considérée comme une exception. Au contraire, les participants aux groupes de discussion décrivaient la gestion de cette affaire comme un cas exemplaire qui démontre le comportement habituel de ces institutions. De nombreux autres exemples de mauvaise gestion ont aussi été cités qui, du point de vue des participants, étaient très similaires et démontraient que l’on ne pouvait pas faire confiance à ces institutions. De plus, les participants avaient l’impression que les décideurs n’avaient pas appris grand-chose de ces expériences, car ils n’avaient pas résolu les problèmes qui pour eux avaient été mis en évidence par l’affaire de la vache folle. Ils s’attendaient donc à ce que ces institutions continuent à se comporter de la même façon en ce qui concerne les OGM ou d’autres questions ; quelles ont donc été les réactions des participants ?
Les participants n’ont pas en général exprimé des opinions arrêtées « pour » ou « contre » les OGM. Leurs attitudes étaient plus nuancées et sophistiquées. L’ambivalence était le sentiment principal exprimé, et les participants reconnaissaient à la fois des dimensions positives et négatives à leur développement.
Les participants exprimaient aussi de l’ambivalence sur le ’progrès’ dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation de façon plus générale. Dans tous les groupes, ils soulevaient des inquiétudes sur l’évolution actuelle de toute la chaîne agro-alimentaire. En même temps, les mêmes participants exprimaient leur satisfaction envers les normes modernes d’hygiène, reconnaissaient que l’alimentation n’avait jamais été plus sûre et que le fait de passer moins de temps à faire la cuisine et les courses était pratique, laissant plus de temps pour d’autres occupations. Cependant, malgré ces satisfactions, les participants exprimaient en même temps des réticences sur les bénéfices d’une industrialisation encore plus poussée de la chaîne alimentaire. Dans ce contexte, les OGM représentaient « une étape de trop » dans une évolution déjà bien amorcée.
Les participants faisaient la différence entre différents types d’OGM, mais celle-ci ne pouvait pas être réduite à une simple distinction entre les applications agro-alimentaires et médicales. Les applications médicales étaient perçues d’un œil plus favorable, mais cette perception favorable n’était pas fondée seulement, ou principalement, sur une évaluation des bénéfices personnels. D’après les participants beaucoup d’autres facteurs étaient plus satisfaisants dans le domaine médical, tels que l’accès à l’information, les procédures d’évaluation des risques et la réglementation.
Les participants trouvaient certains des bénéfices revendiqués pour les OGM agricoles louables (l’amélioration de la santé, la réduction de l’utilisation des pesticides, l’augmentation de la productivité de l’agriculture des pays du tiers monde), mais n’étaient pas convaincus qu’ils seraient réalisés. De plus, les stratégies de communication de l’industrie des biotechnologies qui insistent sur l’idée que les OGM pourraient « nourrir la planète » étaient perçues de façon très négative, comme une tactique de marketing manipulatrice, surtout parce qu’ils n’avaient pas l’impression que ces compagnies travaillaient sérieusement dans ce sens.
Les participants réclamaient l’étiquetage des aliments transgéniques, mais ceci n’était pas simplement pour pouvoir se protéger contre des risques potentiels pour leur santé. L’étiquetage était considéré comme une condition minimale pour permettre aux consommateurs de savoir et de choisir ce qu’ils mangent. Certains participants considéraient aussi l’étiquetage comme un outil qui permettrait aux consommateurs de boycotter les produits transgéniques, un suivi des impacts néfastes non intentionnels, et le retrait du marché des produits incriminés. L’étiquetage démontrerait aussi « qu’ils n’ont rien à cacher ».
Les participants décrivaient souvent les OGM comme « pas naturels ». Ceci ne signifie pas que, pour eux, les autres innovations agricoles, y compris les « croisements conventionnels » soient « naturelles ». Ainsi, il est inexact par exemple de dire que les consommateurs qui s’inquiètent à propos des aliments transgéniques préfèrent nécessairement les aliments produits en utilisant des pesticides chimiques.
Les participants ne demandaient pas le ’zéro risque’ ou la certitude totale sur les impacts des OGM. Ils étaient bien conscients que dans leur vie quotidienne, la plupart des activités sont associées à de nombreux risques et bénéfices qui doivent être pesés les uns contre les autres. De plus, ils trouvent tout naturel que la science ne puisse jamais prédire avec précision tous les impacts futurs d’une nouvelle technologie. Plutôt, ils pensaient fermement que les incertitudes inhérentes et incontournables devraient être admises par les institutions, et prises en compte dans les décisions.
Restaurer la confiance
C’est le refus des institutions responsables d’admettre ces incertitudes qu’ils trouvaient déroutant et indigne de confiance. La confiance – ou plutôt le manque de confiance – est, en effet, de plus en plus souvent identifiée comme étant le problème clé et la question à résoudre pour les décideurs impliqués dans la gestion des risques. Pour restaurer la confiance du public dans les institutions de contrôle, on a tendance à penser qu’il suffit d’améliorer les stratégies de communication et cette question est généralement traitée indépendamment d’autres décisions institutionnelles. Mais les résultats présentés ici démontrent que la question de la confiance traverse tous les autres facteurs socio-culturels identifiés, et que pour restaurer la confiance de meilleures stratégies de relations publiques ne suffiraient pas ; une transformation plus profonde de la culture institutionnelle est nécessaire afin de démontrer la capacité de ces institutions à gérer les risques de façon adéquate à travers un comportement cohérent sur une longue période et dans différents domaines. De manière générale, les institutions ont besoin de démontrer que les opinions du public sont comprises, valorisées, respectées et prises en compte par les décideurs – même si elles ne peuvent pas toutes être suivies.
Les participants, dans leurs discussions sur les OGM, soulevaient beaucoup de questions qui ne sont pas directement liées aux risques tels qu’ils sont définis par les experts scientifiques ou les réglementations. Mais ces considérations socio-politiques et éthiques plus larges ne pouvaient pas être facilement séparées des dimensions ’scientifiques’ du ’risque’. Les résultats des groupes de discussion démontrent que les attitudes du public aux OGM sont façonnées par des facteurs sous-jacents qui remettent en cause les frontières présumées entre ’science’ et ’politique’ et aussi entre ’risque’ et ’éthique’.
L’étude PABE n’était pas conçue pour analyser la réception des médias par le public, mais elle confirme les résultats d’autres recherches dans ce domaine qui démontrent que les individus s’engagent activement dans l’interprétation et l’évaluation de formes multiples de médiation et d’information, certaines impliquant les mass médias, d’autres non. Ainsi les citoyens ne peuvent pas être caractérisés comme des victimes qui absorbent passivement les messages assenés par les media. Pourtant, la fixation des acteurs sur le rôle des mass médias comme un déterminant clé de l’opinion publique sous-entend un public passif et sans intellect.
La comparaison de deux types de résultats – d’une part les perceptions des OGM parmi les citoyens non-impliqués dans le débat et d’autre part, les perceptions des réactions du public parmi les parties prenantes (acteurs impliqués dans la controverse sur les OGM) – apporte un nouvel éclairage sur les perceptions des OGM par le public. Elle révèle la persistance de nombreuses idées reçues à propos du public qui sont partagées par la plupart des parties prenantes mais qui ne sont pas confirmées par notre analyse des opinions des citoyens exprimées dans les groupes de discussion. Ce constat a des conséquences importantes, parce que ces interprétations erronées des perceptions du public ont une influence déterminante sur les stratégies de communication et les décisions des organismes publics et privés, ainsi que des associations de protection des consommateurs ou de l’environnement. Ainsi ces acteurs ne réussissent pas à répondre de façon adéquate aux attentes du public et donc ne contribuent pas à faire avancer le débat. Les nouvelles initiatives et stratégies – même si elles sont innovatrices et cherchent sincèrement à intégrer les opinions du public – continueront probablement à échouer si elles continuent à être fondées sur ces représentations erronées du public.
Dans ces circonstances les auteurs du rapport suggèrent que la contribution la plus positive de cette recherche est de révéler et d’analyser le décalage entre les idées que se font les acteurs à propos du public et les perceptions du public exprimées dans les groupes de discussion.
L’étude conclut en identifiant comme priorité le besoin d’un changement culturel profond dans les institutions au sujet des perceptions du public sur la science, les technologies et les risques. Les décideurs publics devraient être prêts à considérer que la source du problème ne se trouve pas seulement dans le comportement du public mais aussi dans le comportement des institutions responsables de la création et de la gestion des innovations et des risques. Ceci semble impératif pour le développement d’un débat plus constructif sur les biotechnologies agricoles en Europe.
Les mythes de l’opinion publique
La cause principale du problème est que les profanes n’ont pas assez de connaissances scientifiques.
Les gens sont ’pour’ ou ’contre’ les OGM.
Les consommateurs acceptent les OGM pour la médecine, mais pas pour l’agriculture et l’alimentation.
Les consommateurs européens se comportent de façon égoïste envers les pauvres dans les pays du tiers monde.
Les consommateurs revendiquent l’étiquetage afin d’exercer leur liberté de choix.
Le public pense – à tort – que les OGM ne sont pas naturels.
C’est la faute de l’affaire de la vache folle : depuis, les citoyens ne font plus confiance aux instances de contrôle.
Les consommateurs demandent le « risque zéro » : c’est irréaliste.
L’opposition aux OGM est due à « d’autres facteurs » politiques ou éthiques
Les citoyens sont des victimes démunies face aux médias sensationnalistes qui déforment les faits.