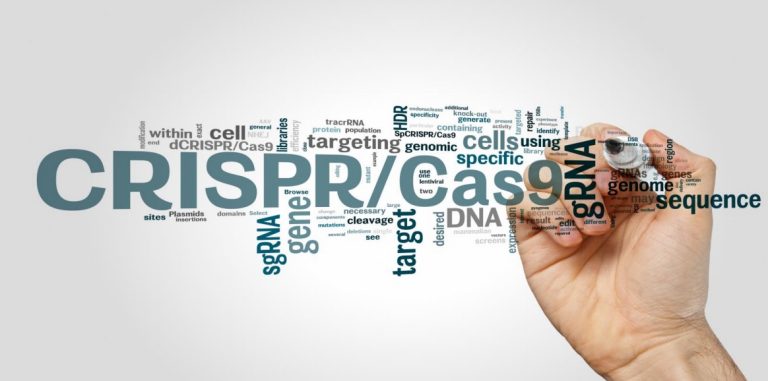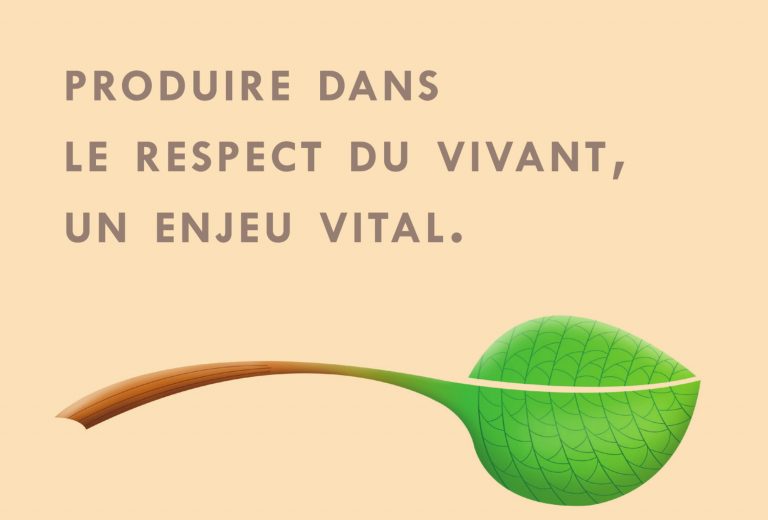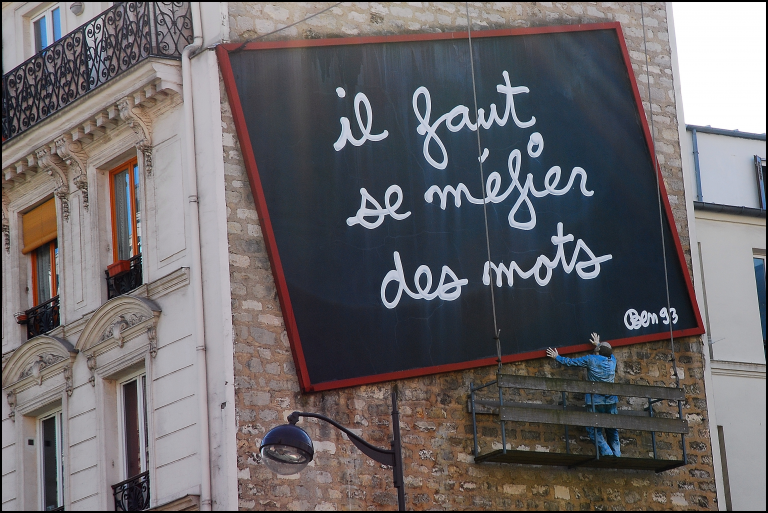Actualités
OGM : ce que propose Emmanuel Macron, En Marche

Emmanuel Macron, du mouvement « En Marche », est pour l’interdiction des cultures d’OGM en plein champ et la possibilité, à terme, d’une interdiction des OGM pour l’alimentation animale. Il souhaite pour cela la mise en place d’une filière française de protéagineux et le développement de l’élevage à l’herbe. Il souhaite « explorer le potentiel de développement des OGM et [nouveaux OGM] en laboratoire et en confinement », tout en précisant que « la règlementation sur les OGM doit s’appliquer aux [nouveaux OGM] tant que [ceux-ci] n’ont pas fait l’objet d’une analyse spécifique ». Tout, et son contraire, sont donc encore possible !
Bien que se déclarant contre les monopoles liés au brevets sur le vivant, le nouveau président ne pipe mot sur leur éventuelle interdiction. Enfin, Emmanuel Macron prône d’aider en priorité les semenciers français. Voici les réponses qu’il nous avait fournies quand il était candidat.
Inf’OGM – Si vous êtes élu Président de la République française, quelle sera votre politique en matière de culture de plantes transgéniques ?
Emmanuel Macron (E. M.), En Marche Nous maintiendrons une interdiction ferme des cultures d’OGM en plein champ, et nous prendrons une position très claire en faveur du maintien d’une législation OGM au niveau européen, avec la possibilité d’une clause de sauvegarde au niveau national. Nous maintiendrons l’interdiction des OGM. Nous développerons les alternatives pour l’alimentation animale et étudierons la possibilité d’une interdiction des OGM pour l’alimentation animale.
La France importe annuellement environ quatre millions de tonnes de soja OGM pour l’alimentation de son bétail. Que pensez-vous de cette situation ?
E. M. Les importations de soja sont responsables de l’essentiel de « l’empreinte déforestation » de la France et de l’Europe. Il est nécessaire, pour réduire les importations de soja issu de la déforestation, de mettre en place une filière française structurée de production de protéagineux et des incitations économiques pour les producteurs de légumineuses en général afin de tendre vers l’autonomie protéique. Nous souhaitons par ailleurs favoriser l’élevage à l’herbe, dans le cadre de notre objectif de faire monter en gamme l’agriculture française. Nos propositions de plan de transition agricole de cinq milliards d’euros pour soutenir les projets de modernisation des exploitations pour réduire l’impact environnemental et améliorer le bien-être animal ; ainsi que de consacrer 200 millions d’euros chaque année pour rémunérer les services écologiques (entretien des paysages, pâturage) rendus par les agriculteurs, devront y contribuer. Nous souhaitons par ailleurs que la viande française puisse être valorisée dans la restauration collective, dans le cadre de notre objectif que d’ici 2022, l’ensemble de la restauration collective devra proposer au moins 50% de produits biologiques, labels de qualité ou local. Nous souhaitons, pour une meilleure information des consommateurs, poursuivre l’étiquetage de l’origine de la viande et du lait dans les produits transformés qui est actuellement en test. Nous devrons également travailler à une harmonisation des conditions d’élevage au niveau européen.
En ce qui concerne les importations venant d’Amérique il faut être très clair : les produits importés dans l’Union européenne doivent respecter les normes européennes. Il en est ainsi des réglementations applicables au bœuf aux hormones, aux organismes génétiquement modifiés, aux produits chimiques. Il n’y aura aucune exception aux normes actuelles protégeant la santé des consommateurs. La précaution ne se négocie pas.
Le gouvernement français soutient la recherche sur les modifications génétiques, notamment avec des partenariats publics privés comme Genius. Que pensez-vous de ces contrats et recherches ?
E. M. Il est indispensable de maintenir la recherche publique pour ne pas laisser la main aux seuls intérêts privés : en 2009, la recherche privée en agronomie représentait environ neuf milliards de dollars dont presque deux milliards pour Monsanto et Syngenta. C’est environ dix fois le budget public pour l’agroécologie !
C’est pourquoi nous souhaitons explorer le potentiel de développement des OGM et des New Breeding Techniques en laboratoire et en confinement, à des fins agronomiques futures et dans l’industrie du médicament : en effet les OGM ont de multiples applications dont la production de molécules aux effets thérapeutiques. Depuis 20 ans, un certain nombre de protéines « recombinantes » sont produites de cette manière en confinement : insuline, hormones de croissance, vaccins, facteurs de coagulation. Le potentiel de développement est extrêmement élevé et peut être un atout pour la France.
Les entreprises développent actuellement des nouveaux OGM. Elles souhaitent que ces OGM ne soient pas soumis à la législation des plantes transgéniques. La société civile, elle, réclame que tout organisme dont l’ADN a été modifié en laboratoire soit considéré comme un OGM. Quelle est votre position sur ce sujet particulièrement sensible ?
E. M. Les techniques évoluent sans cesse, et cela pose des problèmes d’évolution du droit : la question de la règlementation applicable aux nouvelles technologies de mutagénèse est actuellement en cours d’examen au niveau européen. En pareille situation, il faut d’abord être clair sur les principes : les interventions génétiques assimilables aux techniques OGM doivent relever de la réglementation OGM. Il faut ensuite être prudent : par défaut, la règlementation sur les OGM doit s’appliquer aux NBT tant que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une analyse spécifique.
Les brevets sur le vivant sont-ils un outil de soutien à l’innovation agricole ou un frein à l’autonomie paysanne et une menace pour la diversité cultivée ?
E. M. Le droit des brevets qui devait initialement stimuler l’innovation se retrouve avec le brevetage du vivant à l’opposé de cette vocation. Le droit des brevets a modifié les rapports de force dans le monde agricole puisque trois semenciers suite aux rachats et fusions se partagent plus de 50% du marché.
Nous ne pouvons pas accepter que des plantes dont la vocation est de nous nourrir soient la propriété d’une poignée d’entreprises, nous ne pouvons pas accepter que ces mêmes entreprises puissent fixer un prix de semences aux dépens des agriculteurs et des consommateurs ou qu’elles limitent volontairement le nombre de nouvelles variétés qui arrivent sur le marché.
L’autonomie semencière au niveau européen doit être préservée, il en va de notre souveraineté alimentaire et du maintien de notre biodiversité.
Les semences paysannes ont un avenir en France et en Europe ? Si oui, que proposez-vous pour les encourager ?
E. M. Nous souhaitons donner la priorité aux financements permettant aux semenciers français de développer des semences visant à un accroissement de la biodiversité cultivée.