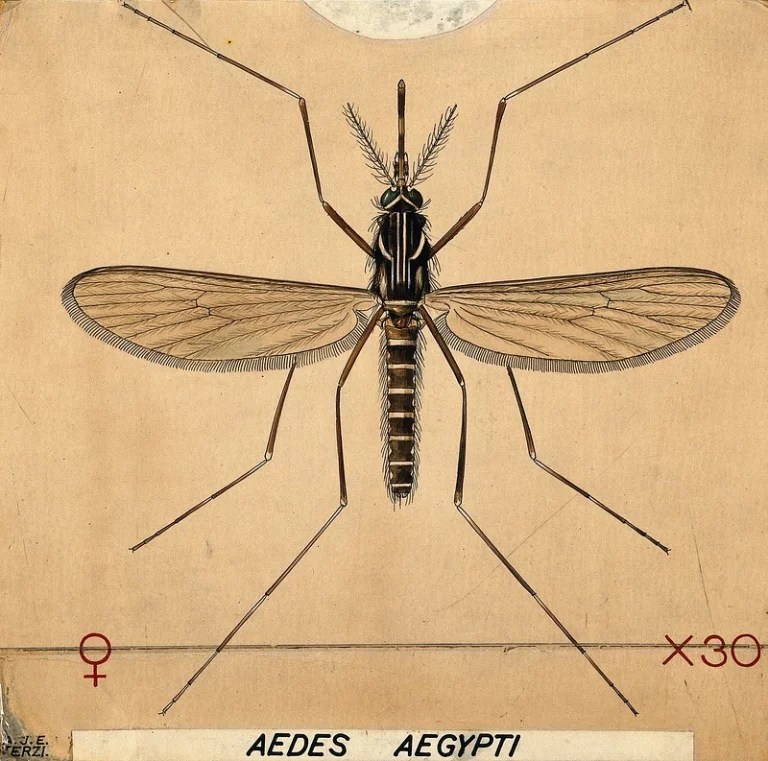Plantes OGM et non OGM : quelle cohabitation ?

La coexistence entre cultures OGM et cultures conventionnelles est une problématique principalement européenne. En effet, dans les principaux pays producteurs d’OGM (Etats-Unis, Argentine, Canada, etc.), le débat n’a pas lieu étant donné que les plantes transgéniques sont considérées comme substantiellement équivalentes, c’est-à-dire identiques, aux plantes conventionnelles. Au contraire, en Europe, les plantes transgéniques sont considérées comme des produits nouveaux porteurs de risques spécifiques, qu’il convient de surveiller et de réglementer ; par ailleurs, l’Union européenne a souhaité donner aux consommateurs la possibilité de choisir entre une alimentation issue d’OGM et une alimentation conventionnelle. Ainsi, que ce soit par l’étiquetage – qui est censé laisser le consommateur libre de choisir – ou par les mesures de coexistence – qui sont censées permettre à des agriculteurs de cultiver ce qu’ils veulent sans interférence avec le champ du voisin – le choix semble renvoyé à l’utilisateur et non pas au producteur. Mais comment assurer ce libre choix ? Est-il réellement possible de cultiver sur un même territoire OGM et non-OGM ? Et si cela est possible, à quelles conditions ? A quel prix ? Qui sera en charge d’éviter la pollution de l’autre ? Qui sera en charge des contrôles ? Qui sera responsable en cas de contamination ?
Le débat sur la coexistence des filières OGM / non-OGM a surgi officiellement en Europe dans le cadre des conditions de la levée du moratoire. Après l’adoption d’une réglementation sur la traçabilité et l’étiquetage1, la Commission européenne a dressé des lignes directrices2 sur les conditions d’une coexistence entre les cultures de plantes conventionnelles et les cultures de plantes transgéniques. Ces recommandations découlent d’un premier rapport3 sur la coexistence, en 2002, commanditée par la Commission européenne. Depuis, le débat traverse toute l’Europe et tous les acteurs.
Pour la Commission, les mesures de coexistence doivent “donner aux exploitants agricoles la possibilité d’opérer un choix effectif entre la production traditionnelle, biologique ou génétiquement modifiée, dans le respect des obligations juridiques en matière d’étiquetage et de pureté”4. Toujours selon cette institution, “les coûts de la coexistence devraient être supportés par ceux qui bénéficient d’une forme particulière de culture. En d’autres termes, la prise en charge de ces coûts reviendrait aux agriculteurs n’utilisant pas d’OGM”5.
Le fait d’envisager le problème de la coexistence comme un strict problème économique a aussitôt fait réagir les associations écologistes pour qui les mesures de coexistence sont surtout fondamentales pour l’environnement. Il s’agit en effet avant tout d’éviter les contaminations, c’est-à-dire de garantir la pureté génétique des variétés cultivées, de définir la prise en charge des coûts et le partage des responsabilités en cas de pollution. D’ailleurs, parmi ces associations, nombreuses sont celles qui estiment qu’il est impossible de faire coexister des cultures conventionnelles et des cultures transgéniques… La coexistence serait ainsi un faux débat. GRAIN décrit la pollution génétique comme “la pierre angulaire des efforts de l’industrie des biotechnologies pour mettre le monde entier devant le fait accompli et obtenir ainsi qu’il accepte les cultures génétiquement modifiées. […] Une telle coexistence conduirait inévitablement à un système à deux vitesses pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde […] avec un même petit nombre de firmes contrôlant les deux niveaux, des semences aux supermarchés”. Pour GRAIN, les mesures de coexistence n’empêchent donc pas les contaminations, elles les légalisent… Plusieurs réponses techniques mais aussi politiques sont formulées par les différents acteurs pour mettre en place les conditions de la coexistence (ou du contrôle des contaminations génétiques). Elles vont de la mise en place de zones tampons à celle de zones sans OGM.
Les premiers cas de contaminations
Aujourd’hui, quatre espèces de plantes transgéniques sont cultivées à grande échelle : soja, maïs, colza et coton. Chacune d’entre elles possède un centre d’origine génétique. Et des cas de contamination de variétés indigènes dans des centres d’origine par des variétés transgéniques ont déjà été notés. C’est le cas du maïs avec le Mexique6. L’origine technique de la contamination n’est pas encore connue. En tout état de cause, elle est liée à une “erreur” humaine ou à un manque de vigilance puisque le Mexique avait décrété en 1998 un moratoire sur les cultures de maïs transgénique afin de protéger la biodiversité des espèces locales. La contamination de centres d’origine génétique est particulièrement préoccupante. En effet, il est important de préserver les variétés anciennes et la diversité génétique des plantes cultivées afin de pouvoir développer des variétés résistantes aux maladies, mauvaises conditions climatiques, etc.
Il existe, certes, des banques de semences, mais celles-ci sont généralement ex-situ, ce qui signifie que ces semences ne sont pas en contact, en co-évolution avec leur milieu naturel, qui lui ne cesse d’évoluer… En outre, les banques de semences ne sont pas elles-mêmes à l’abri des contaminations7. Comme l’explique le biologiste Pierre Henri Gouyon : “il y a énormément d’échanges génétiques entre variétés, et les transgènes persistent à travers les générations”8.
++++
En France, des analyses effectuées par le Ministère de l’agriculture en 2003 ont montré qu’un échantillon de semences importées sur cinq contenaient des OGM, même si “dans la totalité des cas, le taux de présence fortuite observé est inférieur à 0,3%”. Conduites sur 235 échantillons provenant de 12 pays différents, ces mêmes analyses soulignent que la moitié des lots en provenance des États-Unis (21 sur 47) et la totalité des lots en provenance de Turquie (4 sur 4) contiennent des OGM. La proportion est plus faible pour les lots en provenance du Chili (14 sur 77), d’Afrique du Sud (4 sur 15) et de Hongrie (4 sur 61)9. Ainsi la présence fortuite du transgène, comme dans le cas de de Kochko (Cf. encadré ci-dessous), n’est pas toujours liée à une erreur de gestion de l’agriculteur mais à l’achat de semences contaminées… Etant donné que la France n’est pas autosuffisante en semences et en importe de pays où les cultures transgéniques sont relativement importantes en termes de superficie (Canada, Etats-Unis…), la probabilité de présence fortuite d’OGM est élevée. Ce problème de contamination pose la question du contrôle aux frontières de la qualité et la pureté des semences importées, qui devrait être prise en compte dans le cadre du débat sur la coexistence.
Dans le rapport “Gone to Seed” publié par l’Union of Concerned Scientists10, on apprend qu’il est impossible de mettre en place de véritables barrières étanches entre des cultures non OGM et des cultures transgéniques. Ce rapport révèle que plus des deux tiers des 36 types de cultures qui poussent sur le sol américain sont contaminés par des gènes provenant d’organismes transgéniques. Afin de garantir l’approvisionnement en semences garanties sans OGM, les experts recommandent donc au gouvernement américain de faire rapidement des stocks des graines non contaminées.
Les sources de contamination
Afin d’assurer la coexistence, c’est-à-dire éviter les contaminations, une vigilance doit être observée à tous les niveaux de la chaîne de production, “de la fourche à la fourchette”, selon l’expression de la Commission européenne. En effet, les sources de contamination existent à chaque étape de la filière. Au niveau du champ, la contamination peut être due au pollen (transporté par les insectes pollinisateurs, le vent), aux résidus de culture – qui contiennent nécessairement des transgènes, aux repousses et à certaines plantes adventices interfécondes avec l’espèce cultivée. Ensuite, lors de la récolte, du transport et du stockage, les risques de dissémination sont également importants. L’équipe du Pr.Arnaud (Université de Lille) a démontré que le risque de dissémination des OGM est plus grand avec les semences qu’avec le pollen, du fait de leur transport. L’étude a été menée avec l’utilisation de marqueurs moléculaires pour tracer différents types de betteraves, hybrides et sauvages. Les espèces hybrides ont été retrouvées à 1500 mètres de leur champ de culture et se mélangeaient avec les espèces sauvages locales. Le Pr. Arnaud explique cette migration par un transport de terre présente sur le champ de culture ou par transport de poussière avec les betteraves. “Ces résultats sont inattendus puisque toute étude sur la dissémination se focalisait uniquement sur le pollen”, explique-t-il11. La majeure partie des études concernant les contaminations génétiques sont consacrées à la dissémination du pollen et aux distances de sécurité qu’il faut établir entre champs OGM et non OGM afin de garantir une non-pollution d’un type de culture par l’autre. Les flux de gènes dépendent de la variété : par conséquent, seules des études au cas par cas peuvent apporter quelques éclairages pertinents (Cf. encadré ci-dessous).
++++
Un autre facteur de contamination, assez peu évalué, est la diffusion des transgènes via les bactéries et autres microorganismes du sol, et les eaux souterraines. Deux chercheurs, Walter Wildi et John Poté, de l’Institut Forel, en Suisse, montrent qu’une construction génétique peut rester active 4 ans après la destruction de la plante à 0,8 mètres de profondeur dans le sol. Ainsi, écrivent- ils : “Une fois la plante transgénique fauchée, des restes peuvent persister sur le sol. Quand ils se dégradent, avec l’arrivée de la première pluie, ils peuvent soit ruisseler à la surface de la terre, soit s’infiltrer. Dans ce cas-là, on ne s’intéresse plus aux débris de plantes entières mais à l’ADN”12. Or, si une bactérie capable d’intégrer l’ADN rencontre une séquence de gène modifié, elle peut être naturellement transformée, ce qui fera que la séquence d’ADN s’exprimera en elle. De plus, leurs expériences en laboratoire ont montré qu’un gène peut être transporté sur de longues distances en milieu saturé en eau. Les chercheurs, qui ont procédé à l’extraction d’ADN à différentes profondeurs, se sont aperçu que l’ADN des plantes cultivées pouvait se retrouver jusque dans les nappes phréatiques et finir par couler dans les fontaines. Dans leurs échantillons d’eau, ils ont ainsi détecté, entre autres, des gènes de blé, de colza et de vigne. En fonction de la nature du sol, l’ADN a une durée de vie plus ou moins longue. Ceci est corroboré par les études menées par Pascal Simonet et Xavier Nesme13. Ces derniers ont détecté la présence du gène de résistance à la gentamycine dans des échantillons de sol plus d’une année après la récolte de plants de tabac transgéniques.
Des réponses techniques
Les mesures de coexistence cherchent à réduire les facteurs de contamination par des règles de bonne conduite pour rester sous les seuils légaux de pollution. Ces deux éléments sont intimement liés : en effet, on déterminera une série de mesures en fonction du résultat (donc de la contamination) qu’on tolère.Toutes ces mesures augmenteront forcément le nombre de réglementation et de contrôle, et engendreront une “bureaucratie” pour gérer ces filières.
Un bio contaminé
M. De Kochko, agriculteur biologique français, produisait du soja, qu’il vendait ensuite en Allemagne – via un petit organisme stockeur du Gers – où ce soja est transformé en tofu. Or, fin 97, l’acheteur allemand est accusé par le service des fraudes allemandes d’utiliser du soja OGM. Il s’est retourné contre son fournisseur du Gers. Des démarches ont été engagées pour comprendre d’où venait la contamination (à hauteur de 0,1%). De Kochko porte plainte contre X au tribunal d’Auch. “Cette dernière plainte (avril 98) nous a permis d’avoir accès à certains résultats des fraudes françaises qui ont mis en évidence des traces de cet OGM un peu partout et même dans la filière bio et notamment dans les semences traditionnelles certifiées vendues par la Coopérative Biologique et produites par la société ASGROW faisant partie du groupe Monsanto. Depuis la justice française n’a rien fait…”
http://perso.nnx.com/gmarchan/kochko.htm
Comme le note GRAIN14, la coexistence peut entraîner “des systèmes de contrôle très fermés de “préservation de l’identité”, où les agriculteurs cultiveront des variétés particulières sous contrat avec des compagnies imposant les intrants qu’ils devront utiliser. Ces systèmes de préservation de l’identité, que ce soit pour les plantes non génétiquement modifiées ou des cultures d’OGM à “valeur ajoutée”, se feront à partir de semences certifiées. […] Les agriculteurs cultivant à partir de semences conservées à la ferme devront vendre leurs plantes en dehors de la filière des plantes non-OGM, sauf s‘ils arrivent à trouver des marchés locaux informels”. Les mesures de coexistence préconisées dépendront en particulier de la variété en question (probabilité de pollinisation croisée). La première d’entre elles consiste à éloigner les champs d’OGM des champs conventionnels… Cela nécessite de se mettre d’accord sur les données scientifiques. Entre 4,5 km et 16 km, les conséquences en termes de gestion de l’espace agricole sont en effet radicalement différentes.
D’autres mesures sont également proposées : entourer les cultures transgéniques de barrières végétales, telles que des haies ; poser des filets sur les plantes ou des sachets sur les inflorescences15, décaler les semis, créer des “zones tampons”, voire régionaliser les cultures26,…
Des actions doivent également être menées après la récolte : détruire les plantes susceptibles de constituer des relais de dissémination des transgènes, qu’ils s’agissent de plantes de la même espèce ou d’espèces apparentées présentes sur le bord des routes et des champs ; éviter l’enfouissement en profondeur des graines tombées au sol ; assurer le contrôle des repousses. Or, selon la CGB, “ces opérations de gestion et de surveillance concourent, au même titre que les mesures d’isolement, au contrôle de la dissémination involontaire des transgènes”. Dernier élément à prendre en considération, la vigilance au niveau du transport : nettoyer scrupuleusement les équipements, voire en consacrer de spécifiques pour l’une et l’autre filière.
++++
Une dernière catégorie de mesures concerne la modification génétique en temps que telle. L’absence du transgène dans le pollen d’une plante transgénique est l’une des pistes de recherche pour éviter le phénomène de contamination. Certains scientifiques cherchent à introduire le transgène dans les chloroplastes d’une cellule (eux-mêmes présent dans le cytoplasme de la cellule), et non plus dans le noyau. Les chloroplastes sont localisés uniquement dans les cellules composant les organes de la photosynthèse (feuilles, tiges, et un peu dans les racines aériennes). Ces organites ne sont donc en théorie pas présents dans les grains de pollen. Une fréquence de passage d’ADN cytoplasmique vers le noyau, d’une plante sur 16 000, a cependant été détectée par l’équipe du professeur Timmis27, de l’Université d’Adelaïde (Australie).
La technologie GURT – Genetic Use Restriction Technology ou “Terminator” – qui consiste à rendre stérile la descendance des variétés transgéniques, est souvent décrite comme une mesure anti-contamination par les promoteurs des OGM. Encore récemment, la FAO, dans son dernier rapport28 préconisait l’utilisation de Terminator. Mais pour ETC Group, ONG canadienne, “même si la technique Terminator ne posait pas de problème, il est inacceptable et dangereux de faire croire que l’agriculture devrait dépendre de la stérilisation génétique des semences comme méthode pour contenir la pollution génétique en provenance des OGM. […] La sécurité alimentaire des populations démunies ne doit pas être sacrifiée pour résoudre le problème de pollution génétique de l’industrie”29. Et GRAIN précise dans sa lettre ouverte à la FAO30 que ce sont plus de 1,4 milliards de personnes qui dépendent des semences traditionnelles. Enfin, la dernière critique concerne le mode d’obtention des semences stériles. En effet, pour que les plantes soient stériles, les semenciers les traitent avec un produit chimique. Or, ce traitement n’est pas efficace à 100%, et donc des graines vendues comme stériles peuvent ne pas l’être31.
Des transgènes plus ou moins voyageurs
Le pollen peut être transporté soit par le vent (anémophilie), soit par des agents vivants, insectes essentiellement (entomophilie). La pollinisation par le vent concerne environ 10 % des espèces de plantes à graines (maïs, seigle), les espèces forestières des régions tempérées (conifères, chêne, bouleau, hêtre…) et de nombreuses espèces fructifères (noisetier, noyer, olivier, vigne…). Les grains de pollen de certaines plantes anémophiles peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Des grains de pollen de conifères venus d’Italie se retrouvent régulièrement dans l’Est de la France, mais la question qui se pose alors est de connaître leur viabilité. Précisons cependant que la quantité de pollen efficace (capable de polliniser) dépendra de la taille du champ, du vent (vitesse, direction), du paysage (haies, bois, etc.). Quant au flux de pollen chez les plantes entomophiles, la portée dépasse difficilement 2 km. Cependant, les critères varient beaucoup suivant les insectes et suivant les groupes végétaux : ainsi pour une espèce donnée, et pour un insecte donné, les flux de gènes doivent être évalués aux niveaux intraspécifiques, interspecifiques, voire intergénétiques.
Ceci illustre bien la complexité pour évaluer la dissémination pollénique des plantes cultivées… Le maïs a un pollen lourd et ses repousses sont détruites pendant l’hiver (en Europe). Pour cette filière, les pollutions génétiques s’expliquent ainsi essentiellement par des pratiques humaines peu précautionneuses. Selon les biologistes, 85% du pollen de maïs tombe à moins de un mètre, 96% à moins de 8 mètres et 99% à moins de 60 mètres16. D’après Pierre Guy, chercheur retraité de l’INRA, la portée utile du pollen de maïs est de 100 mètres, même si 0,1% du pollen est capable de franchir des distances supérieures à 500 mètres17. Une autre étude, conduite par Arvalis et l’INRA18, conclut que les dix premiers mètres des parcelles de maïs conventionnel sont sujets à contamination due au pollen à hauteur de 1 à 2%. Au-delà, cette même contamination descendrait progressivement sous le taux de 0,9%. Cependant, du pollen viable de maïs en concentration importante a été retrouvé jusqu’à 1800 mètres d’altitude, ce qui laisserait supposer la possibilité de transport sur plusieurs dizaines de km19.
++++
Concernant le colza, les problèmes de contamination sont davantage liés aux flux de graines. En effet, ces dernières sont très légères : d’une part, elles tombent à terre au moment de la récolte et d’autre part, elles sont transportées par les roues des machines agricoles, les chaussures des agriculteurs et le vent. Elles ont aussi une dormance20 très longue. Selon une étude publiée par le Ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA), des repousses peuvent apparaître pendant 16 ans21. En ce qui concerne les distances de sécurité, les résultats divergent. Des scientifiques de l’Université de Worcester22 ont trouvé du pollen de colza génétiquement modifié dans des ruches situées à 4,5 km du site d’expérimentation alors qu’une étude23 publiée par le DEFRA, fin 2003, démontre que le pollen peut être disséminé par les abeilles jusqu’à 16 kilomètres de sa culture d’origine.
Concernant la troisième plante transgénique cultivée au niveau mondial, le soja, les risques de pollinisation croisée sont a priori limités étant donné que la plante est considérée comme autogame (autofécondation). Marc Fellous, président de la Commission du génie biomoléculaire, dans un avis daté du 7 septembre 2000, affirme : “La probabilité d’obtenir des allofécondations [fécondations croisées] est extrêmement faible d’autant que la distance maximale de migration du pollen n’excède pas 10 m. La fréquence d’hybridation croisée est estimée à moins de 1% chez cette espèce”24. Mais certaines études, citées notamment par Dominique Guillet, de l’association Kokopelli, montrent des fécondations croisées plus fréquentes25 : en 1970, Caviness a montré que ce sont les abeilles qui étaient responsables des 7,7% de pollinisations croisées qu’il avait obtenues dans ses parcelles d’expérimentation ; Culter, en 1934, obtint 5% de pollinisations croisées dans des parcelles de soja entourées d’un voile de tulle sur un mètre de hauteur avec une ruche à proximité.
Des seuils et des surcoûts
D’après le rapport32 publié par le Centre Commun de Recherche de la Commission européenne (CCR – JRC) – portant sur différents types de cultures dans des conditions de productions variées – on peut rester sous le seuil de 1% de contamination en changeant les pratiques agricoles, la coopération entre voisins semblant l’une des plus efficaces. Les auteurs estiment par contre que l’objectif de rester sous le seuil de 0,1% est très difficile à atteindre, même avec des changements significatifs dans les pratiques agricoles. Par conséquent, la production biologique ne serait pas possible dans une région de production de plantes transgéniques. Les rapporteurs concluent finalement que la co-existence de cultures GM, conventionnelles et biologiques au niveau de la ferme, même de grande taille, est un scénario irréaliste. Là aussi, ces éléments d’appréciation dépendent du type de culture et de leur propre mode de dissémination.
Par ailleurs, les mesures de coexistence influenceront nécessairement les coûts de production. Pour le CCR, le coût additionnel (changement des pratiques agricoles, système de surveillance, assurance) pour rester sous le seuil de 1% serait de 1 à 9% du prix courant du maïs et de la pomme de terre. Pour la production de semences (seuil légal proposé à 0,3%), le coût additionnel serait de 10 à 41%. Donc, si la co-existence des différents types de production au niveau régional est “techniquement possible, elle reste difficile économiquement en raison des coûts et de la complexité des changements associés”. Les coûts indicatifs d’assurance ont par ailleurs été calculés, sur une base de pertes à court terme. Ils pourraient représenter jusqu’à 16% des coûts additionnels pour le colza, 29% pour le maïs, et 70% pour la pomme de terre. A moyen et long terme, des coûts additionnels pour la gestion des repousses GM, des tests et des contrôles, peuvent survenir. Pour les fermes biologiques, retrouver le statut biologique peut prendre du temps et impliquer de nouvelles pertes de revenu. D’après une étude danoise33, les surcoûts financiers sont estimés de 0 à 2% pour le maïs, pomme de terre et céréales, 3 à 9% pour le colza, les pois, l’herbe et les légumes conventionnels et de 8 à 21% pour ces mêmes produits mais biologiques. Faut-il vraiment que les producteurs non GM supportent ces coûts ?
++++
Quelles solutions juridiques contre les contaminations ?
La Commission européenne a fait le choix de la subsidiarité dans la réglementation de la coexistence34. Il appartient donc à chaque Etat membre de concevoir et de mettre en œuvre des mesures en matière de coexistence. Certains Etats ont pris les devants (Allemagne, Danemark, cf. encadrés pages suivantes) et adopté des mesures dans le cadre de la directive 2001/18 sur la dissémination d’OGM dans l’environnement.
Les organisations écologistes ont encouragé la mise en place de “zones sans OGM”, c’est-à-dire d’un ensemble de parcelles agricoles contiguës, sans OGM ou sans une culture OGM donnée. Mais la légalité de ces zones sans OGM peut poser problème aux regard de la législation européenne qui interdit toute entrave générale à la liberté de circulation des marchandises.
Par ailleurs, la principale lacune du dispositif juridique sur la coexistence et de l’approche proposée par la Commission réside dans l’absence de système commun de responsabilité juridique. Pour les organisations écologistes, l’application du principe de subsidiarité risque d’engendrer un ensemble de législations nationales sur la responsabilité, non harmonisées entre elles.
Coexistence et zones sans OGM
L’Union européenne ne fait pas de discrimination entre les formes d’agriculture et reconnaît la spécificité de chacune d’entre elles : libre aux consommateurs et aux agriculteurs de choisir, grâce à une ségrégation des cultures, contrôlée par la traçabilité et certifiée au final par l’étiquetage.
La notion de coexistence s’inscrit donc dans une politique libérale, tout en laissant aux Etats une marge de manœuvre dans l’interprétation de la libéralisation des échanges. La première conséquence de cette conception de la coexistence est le choix, de la part de l’Union européenne, d’une gestion positive de la coexistence en n’interdisant pas la pratique d’une culture, en l’occurrence celle des OGM. La seconde conséquence est que l’interdiction des cultures d’OGM s’inscrit dans le cadre d’une exception au principe de libre circulation des marchandises et, en tant que telle, cette exception est soumise à toute une panoplie de conditions juridiques.
Pourtant la mise en place de territoires sans production d’OGM est une idée qui progresse au niveau européen. Le 4 novembre 2003, 10 régions35 de 7 Etats membres de l’Union européenne se sont déclarées sans OGM par réaction à la position de la Commission européenne dans ses lignes directrices. Ce mouvement s’est amplifié avec de deux nouvelles régions : l’Ecosse (Royaume-Uni) et Burgenland (Autriche) qui sont venues s’adjoindre lors d’une conférence à Linz le 28 avril 200436. En France, au 1er juillet 2004, ce sont 15 régions sur 22 qui ont pris des engagements pour refuser les OGM sur leur territoire37. Parallèlement, dans les pays membres de l’UE, de plus en plus de collectivités locales se positionnent contre les OGM sur leur territoire.
++++
Un rapport de la Commission “Agriculture et développement rural” du Parlement européen, adopté par le Parlement le 18 décembre 200338, reconnaît les zones sans OGM comme constituant “la mesure la plus efficace et la plus rentable pour garantir la coexistence”. Par ailleurs, lors d’un débat d’orientation, le 28 janvier 2004, la Commission européenne a indiqué que des zones sans OGM étaient possibles si des agriculteurs décidaient de produire sans OGM sur une base volontaire. L’autorité compétente pourrait alors déclarer une interdiction de culture d’OGM pour une durée donnée, renouvelable. Le corollaire à cette possibilité est que des cultivateurs d’OGM puissent également demander la création de “zones de production OGM” dans les mêmes conditions. Les cultures conventionnelles ou biologiques devraient alors s’éloigner de ces zones ou supporter les coûts de ségrégation dus à l’implantation d’une telle zone.
Dans la même logique, des zones sans OGM devraient pouvoir être établies autour des zones de production de semences. La cartographie française des multiplicateurs de semences, élaborée par le Groupement national interprofessionnel des semences et des plants (GNIS), faciliterait ce travail. Cependant, le GNIS est un organisme interprofessionnel et cette cartographie n’est pas un document administratif, et donc non-communicable de droit.
Les zones sans OGM constituent des exceptions au principe de libre circulation. Elles ne pourraient donc être admises que dans la mesure où l’implantation d’un champ OGM porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie des producteurs en agriculture conventionnelle ou biologique. Cette justification a d’ailleurs été validée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, le 24 décembre 2003, dans l’affaire de la commune de Mouchan. Celui-ci a déclaré que “le maire de la commune avait compétence pour prendre un tel arrêté, et que l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ici invoquée
en faveur des producteurs d’OGM est contrebalancée par la protection de la même liberté en faveur des producteurs en biologie”.
Ainsi, seul le préjudice économique potentiel est susceptible d’être pris en compte pour fonder juridiquement les zones sans OGM. En effet, selon les lignes directrices de la Commission européenne, “la coexistence soulève donc le problème de l’impact économique potentiel du mélange de produits agricoles génétiquement modifiés et autres, de l’identification de mesures de gestion praticables pour réduire tout risque de mélange et du coût de ces mesures”. Cette position s’explique par le fait que les mesures de coexistence ne sont envisagées que pour les OGM autorisés. Ainsi, le préjudice environnemental ou sanitaire ne sera jamais réparé. En effet, par définition, les OGM autorisés sont des OGM qui ont fait l’objet d’une évaluation des risques montrant, selon l’UE, qu’ilsne portent atteinte ni à l’environnement ni à la santé. Le préjudice économique va découler de la contamination fortuite (donc d’un déclassement du produit) et/ou de l’adoption de systèmes de surveillances et de mesures visant à réduire les mélanges. Il y aura préjudice économique si ces mesures engendrent des surcoûts par rapport au bénéfice qu’elles pourraient procurer.
L’argument économique a été utilisé pour protéger les systèmes agraires locaux en Italie. Cet argument découle de la Directive 98/95 sur la commercialisation des semences et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes. Lors de sa transposition en droit italien, le législateur a permis d’interdirede commercialiser certains types de semences, OGM ou non, pour protéger un système agraire particulier.
Un régime de responsabilité lacunaire face aux OGM
Les lignes directrices de la Commission sur la coexistence prévoient qu’il revient aux Etats de vérifier si, dans leur droit national, les règles de la responsabilité civile trouvent à s’appliquer aux cas de contamination par des OGM. Le régime de la responsabilité civile français, régi par les articles 1382 et suivants du Code civil, repose sur la démonstration de trois faits : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux précédents. Il existe deux systèmes de responsabilité :
Le système de responsabilité pour faute : la victime doit alors prouver que l’auteur du fait générateur est fautif, c’est-à-dire qu’il connaissait le dommage que son fait allait générer. De la même manière, la personne qui ne se donnerait pas les moyens de connaître les dommages serait fautive.
Le système de responsabilité sans faute (ou sur présomption de faute) : la personne auteur du dommage est présumée fautive, c’est-à-dire avoir connaissance que son fait causerait un dommage, à charge pour elle de se dédouaner.
Le principal problème juridique qui se pose en cas de contamination est de prouver la source de la contamination, et donc le fait générateur, ainsi que la faute commise par l’auteur de la contamination. En effet, comment connaître avec certitude la source de contamination : de quelle plante ? du champ voisin ? d’un camion ? L’adoption d’un régime de responsabilité sans faute pesant sur l’obtenteur semencier permettrait de résoudre ces difficultés juridiques liées à l’administration de la preuve (Cf. encadré ci dessous).
++++
La mise en cause de la responsabilité de l’obtenteur se justifie doublement. En premier lieu, à l’origine de la mise sur le marché de la semence, il est facilement identifiable dans la mesure où il est inscrit au catalogue des semences et que son OGM est référencé grâce au brevet39. Pour se dédouaner, l’obtenteur devra imposer un cahier des charges à destination des utilisateurs de ses semences.
En second lieu, la directive 2001/18 dispose que l’Etat “peut” demander au notifiant un cahier des charges sur les mesures anticontamination. Dans le cadre d’une certification de la filière OGM, le semencier OGM vendrait ses semences avec un cahier des charges le plus strict possible dont le non-respect ouvrirait droit à un recours judiciaire. Mais de nombreuses questions juridiques sont encore en discussion. Par exemple, qui sera responsable du contrôle de l’application de ce cahier des charges et de la transparence de ce contrôle ?
++++
La loi allemande sur le génie génétique vert
Cette loi, adoptée le 18 juin 2004 par le Bundestag, vise à transposer la directive 2001/18 et fixe un cadre juridique pour la coexistence tout en prévoyant un régime de responsabilité strict fondé sur le principe du pollueur payeur.
Coexistence
Introduction des “bonnes pratiques” pour la culture des espèces végétales et des animaux GM : La Loi impose une obligation de précaution à 3 groupes différents : ceux qui cultivent, ceux qui transforment et ceux qui commercialisent. Les “bonnes pratiques” visent les différents modes de contamination : production de semences, ensemencement, récolte, transport et stockage. L’utilisateur d’OGM doit disposer dans son exploitation des moyens et de l’organisation nécessaires pour éviter de porter atteinte de manière importante aux champs voisins par fécondation croisée.
Mise en place d’un cadastre pour la surveillance et la prise en compte des coexistences : La nouvelle loi sur les biotechnologies oblige les Länder (régions fédérales) à la mise en œuvre d’un cadastre des implantations OGM. Lorsqu’un cultivateur envisage une culture d’OGM, il doit en informer ses voisins deux mois avant le semis. Cette manœuvre favorise la concertation mais ne permet pas de s’opposer à la mise en culture d’OGM.
Responsabilité civile
La nouvelle loi introduit de nouvelles dispositions en matière de responsabilité pour compléter la réglementation relative à la coexistence des différents modes de production agricole. Une action civile en vue d’obtenir des mesures de défense et de réparation est possible lorsque l’introduction d’OGM porte atteinte de manière importante à la jouissance d’un bien appartenant à un tiers.
La nature du préjudice : La nouvelle réglementation prend en compte deux types de préjudice : l’atteinte à l’exercice du droit de propriété et le préjudice financier. Par ailleurs, elle définit les cas limités dans lesquels le préjudice est caractérisé.
Le principe du pollueur payeur : La nouvelle loi pose le principe d’un remboursement par le producteur d’OGM des dommages économiques (pertes en valeur) liés au manque à gagner sous condition de bonne foi de l’agriculteur contaminé et si des mesures de précaution pouvaient être prises pour éviter le préjudice. Les analyses de la récolte avant le mélange font partie de ces mesures de précaution. S’il existe plusieurs cultures OGM dans le rayon de dissémination du pollen, ce sont tous les producteurs voisins qui sont responsables collectivement et à parts égales. Les juridictions civiles seront compétentes pour connaître de tels litiges.
Assurance : Les cultures OGM ne sont pas assurables en Allemagne. Les assureurs s’appuient sur le fait que les dédommagements seraient très fréquents et que ces paiements seraient difficilement évaluables. Les grandes compagnies d’assurances disent ne pas pouvoir couvrir ce risque.
Zones “écologiquement sensibles” : Dans les zones écologiquement sensibles, par exemple à proximité de réserves naturelles, les autorisations de dissémination d’OGM seront soumises à l’autorisation des autorités de protection de la nature.
Pour rendre ce contrôle effectif, il est nécessaire qu’une seule personne juridique soit présumée responsable en cas de contamination, à charge pour elle de prouver qu’un autre opérateur est fautif. Ainsi, seul l’obtenteur, identifiable grâce à l’analyse de la construction génétique présente dans la variété conventionnelle, peut porter cette responsabilité.
Enfin, le problème de la réparation des dommages par un système adéquat d’indemnisation est encore en débat. Le GNIS souhaiterait la mise en place d’un système d’indemnisation mixte (réparti pour moitié entre le public et le privé) pour les OGM mais il aurait pour résultat de mutualiser la prise en charge du risque entre le contribuable et l’ensemble des semenciers, et donc de déresponsabiliser les éventuels pollueurs et d’encourager ainsi la pollution systématique. Dans la logique du principe du pollueur payeur, il faudrait au contraire mettre en place un système d’assurance financé à 100% par les obtenteurs d’OGM accompagné d’un strict cahier des charges (Cf. encadré ci-dessous sur la loi danoise).
Le Ministère de l’Agriculture français est en train de préparer un arrêté afin de satisfaire aux obligations communautaires sur la coexistence. Des consultations ont été tenues avec divers organismes impliqués dans le débat. La France aura le choix de calquer ou non son arrêté sur les solutions allemandes et danoises, et de mettre en place un véritable système de responsabilité juridique venant pallier les déficiences des pratiques culturales anti-contaminations. En attendant cet arrêté, donc en l’absence de toute responsabilité, on peut comprendre que certaines communes ou régions prennent les devants en se déclarant “zones sans OGM”. C’est toute l’agriculture non OGM qui est aujourd’hui menacée, tant, nous l’avons vu, cette contamination est inéluctable : peut-on vraiment accepter une technologie qui condamne à jamais d’autres voies ?
++++
La loi danoise
Le Parlement a adopté sa loi sur la coexistence le 4 juin 2004. Elle est basée sur la “Stratégie de coexistence” (juin 2003) et sur un rapport scientifique du “Groupe de travail sur la coexistence” publié le 25 juin 2003. Son but est d’assurer un modèle qui concilie toutes les formes de production agricole.
Les éléments principaux :
formation de deux jours pour les agriculteurs désirant produire des OGM ;
échange d’informations entre les agriculteurs avant la période des semis ;
distances d’isolement obligatoires et établies pour chaque culture ou groupe d’espèce ;
contrôle public des productions OGM par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Pêches (sanctions) ;
accès public via Internet aux informations détaillées sur le type de plantes GM mis en culture chaque saison.
Dédommagement – 2 conditions doivent être réunies :
une culture de plantes OGM de même type doit se trouver en culture à proximité de l’exploitation (distance préconisée d’isolement + 50%) ;
le demandeur ne doit pas être fautif.
Dommages couverts :
contamination des graines ;
pertes dues à de nouvelles périodes de conversion.
Procédure : dispositif institué selon une procédure administrative de dédommagement soumise au “Danish Plant Directorate” ; les producteurs d’OGM cotiseront à un fonds à hauteur de 13 euros par hectare de culture GM.